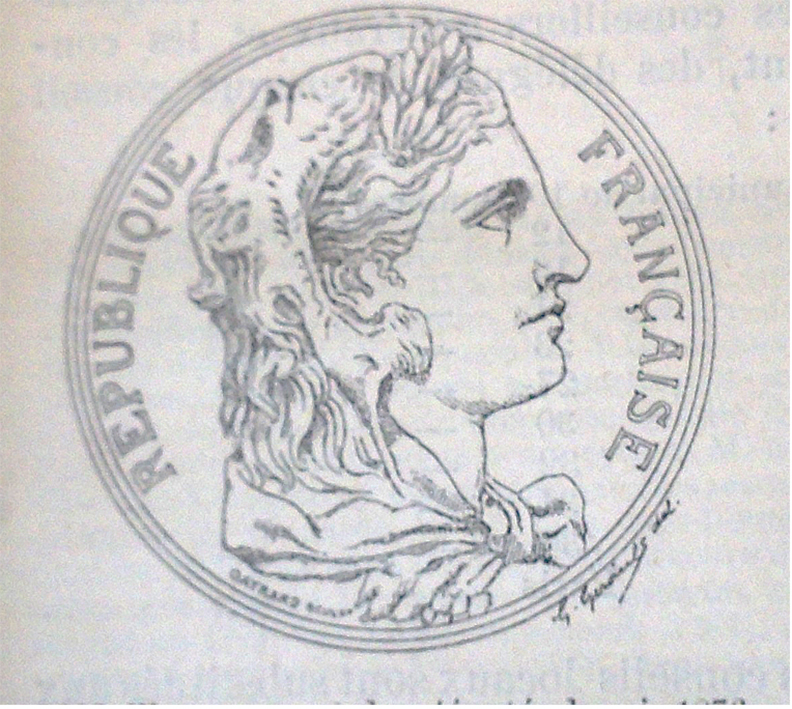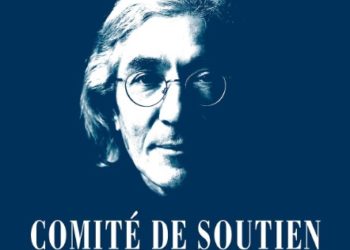A l’occasion des 150 ans de la proclamation de la République, l’Observatoire de la vie politique et parlementaire et le Comité Carnot, avec la participation de l’Observatoire des institutions, administrations et collectivités, ont rédigé un « cahier républicain ». La Revue Politique et Parlementaire a décidé d’en publier les contributions. Aujourd’hui « De l’Empire libéral à la défaite de Sedan – Un empire emporté en six semaines » par Bertrand Marcincal.
Soucieux d’assurer la pérennité de l’Empire Napoléon III était convaincu que le régime, installé après un coup d’État réalisé durant la nuit du 1er au 2 décembre 1851, en souvenir de la victoire d’Austerlitz, devait s’orienter vers une évolution libérale. Afin d’assurer le soutien du peuple il s’efforce de « concilier l’ordre et la liberté » et ses appels se succèdent jusqu’au plébiscite de mai 1870 qui semble le conforter.
Pour Bismarck cependant : « Ce n’est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues, mais par le fer et par le sang. » Depuis 1866 la rivalité entre la France et la Prusse s’est accentuée en vue de conquérir la suprématie européenne. Le conflit devenait inéluctable dès lors que Bismarck regardait la guerre comme une nécessité.
Entraîné dans l’affrontement par son entourage et les mamelouks ou bonapartistes autoritaires, qui estiment que seul un régime fort est le gage de sa durée, Napoléon III, chef suprême théorique d’une armée mal préparée et dont il ne parvient pas à assurer le commandement en chef, allait au-devant de grandes épreuves. En six semaines la fête impériale devait se dissoudre dans la défaite de Sedan et la débâcle.
L’Empire apparemment conforté par son évolution libérale
Après une première période autoritaire Napoléon III fait en 1860 et 1861 à l’opposition libérale, des concessions qu’il poursuit en 1867 sans renoncer à l’essentiel. Les élections législatives des 24 mai et 7 juin 1869 sont un succès pour l’opposition républicaine et orléaniste. L’opposition rassemble 3 300 000 voix et la majorité dans les grandes villes même si les candidats favorables à l’Empire l’emportent avec 4 600 000 voix. Au Corps législatif les bonapartistes autoritaires avec 97 sièges, reculent au profit du Tiers parti, 125 sièges, et des orléanistes de Thiers, 41 sièges ; les républicains obtenant 30 sièges sont divisés entre modérés et révolutionnaires. Avec un total de 216 députés sur 292 la majorité compte 98 gouvernementaux libéraux. À la suite de ces élections, Napoléon III accepte de faire de nouvelles concessions aux centristes car il doit trouver de nouveaux appuis afin d’asseoir sa dynastie en raison d’une santé qui se dégrade.
Par un senatus-consulte du 8 septembre 1869, le Corps législatif reçoit l’initiative des lois et le droit d’interpellation sans restriction. Le Sénat devient une seconde chambre législative. Le cabinet est responsable devant l’empereur. Le cabinet Ollivier est nommé le 2 janvier 1870 et le 20 avril, un sénatus-consulte dispose que les ministres sont désormais responsables devant le Corps législatif, la réforme étant selon Seignobos « une combinaison de la monarchie parlementaire avec des fragments du régime de 1852. »
Les réformes libérales sont soumises au plébiscite aux fins de ratification le 8 mai 1870. L’Empire libéral sort apparemment renforcé par un résultat triomphal : 7 358 000 oui contre 1 530 000 non.
À Paris, toutefois, à la différence du reste du pays, une majorité républicaine se prononce contre le régime.
Ce résultat provoque le découragement des républicains à l’instar d’un Jules Favre qui considère qu’« il n’y a plus rien à faire en politique ».
L’Empire est apparemment conforté mais ce triomphe est bref. Le cabinet est tiraillé entre plusieurs tendances et la majorité devient de plus en plus fragile lorsque survient la menace de guerre.
L’entrée en guerre contre la Prusse
L’entrée en guerre contre la Prusse prélude aux dernières semaines de l’Empire.
Depuis les années 1860, la Prusse mène une politique d’expansion agressive afin d’intégrer des États allemands morcelés en un seul empire unifié. Elle s’est ainsi attaquée au Danemark en 1864 dans la guerre des duchés. Puis en juillet 1866, après avoir prétexté une mauvaise gestion du Holstein par l’Autriche elle l’écrase à la bataille de Sadowa grâce au commandement de Moltke et à la supériorité de son armement.
Conscient des faiblesses de l’armée française Napoléon III entreprend de la réformer afin de la mettre à niveau.
Le ministre de la Guerre, le maréchal Niel, l’un des principaux artisans des victoires de Sébastopol en est chargé. Il institue notamment la garde mobile et décide d’équiper les fantassins en fusils Chassepot supérieurs au Dreyse. « De là ce mot : « Nous sommes prêts ! » Mot répété si souvent, entendu tous les jours sous le maréchal Leboeuf, et qui n’était pas plus vrai sous l’un que sous l’autre », note Adolphe Thiers. La mort de Niel empêche de parachever la modernisation sans avoir pu remédier aux insuffisances de l’artillerie et des effectifs.
Plusieurs revers militaires et diplomatiques contribuent à affaiblir l’Empire. En 1867 la France impériale subit l’échec de la campagne du Mexique marqué par l’exécution de l’empereur Maximilien Ier. La crise luxembourgeoise se solde par le renoncement à tout projet d’acquisition du Grand-Duché par la France, à la signature du traité de Londres le 11 mai 1867. La politique de soutien à l’unité de l’Italie s’avère en outre ambiguë voire contradictoire dans son achèvement. C’est ce qu’illustre la déclaration de Drouyn de Lhuys, à son arrivée au Quai d’Orsay en 1862 : la France désire conserver l’amitié de l’Italie, et souhaite la réconciliation du royaume et du pape, mais elle ne peut accéder aux prétentions du royaume d’Italie sur les États pontificaux.
L’affaire de la dépêche d’Ems
Bismarck estime qu’une guerre contre la France achèvera l’unité allemande, ce qui selon les historiens et la presse terminera inéluctablement un triptyque des guerres d’unification.
En 1870, les tensions entre la France et la Prusse s’intensifient, chacune dénonçant dans la presse l’activisme militaire de l’autre autour de l’attribution du trône d’Espagne. Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin catholique du roi de Prusse, est candidat au trône d’Espagne ce qui fait renaître en France la hantise de l’encerclement par l’Empire comme au temps de Charles Quint. Le 3 juillet la candidature est officialisée. Le roi de Prusse Guillaume Ier garde le silence et ne marque aucune désapprobation tandis que le 6 juillet Napoléon III exige une condamnation sans équivoque.
Interpellé par les chambres, le ministre des Affaires étrangères, le duc de Gramont, que les Prussiens considèrent comme un ennemi, car sa nomination signifiait notamment que la France privilégierait l’alliance autrichienne, annonce au Corps législatif que la France y fait opposition et tient des propos belliqueux : « nous saurions remplir notre devoir, sans hésitation et sans faiblesse. » Le nouveau ministre de la Guerre, le maréchal Leboeuf, assure que l’armée française, « admirable, disciplinée, exercée, vaillante» , est prête à toutes les éventualités.
L’ambassadeur Benedetti, ami personnel de Napoléon III, est envoyé à Ems le 9 juillet, où le roi de Prusse prend les eaux et le prie de demander au prince Hohenzollern de retirer sa candidature. En France la presse est va-t-en guerre. « La Prusse est une nation de proie, lit-on dans La Liberté d’Émile de Girardin, traitons-la en nation de proie. […] A coups de crosse dans le dos, nous la contraindrons à passer le Rhin et à vider la rive gauche. » Or Guillaume Ier intervenu secrètement obtient officiellement ce retrait le 12 juillet.
Cependant le duc de Gramont demande le 13 juillet à Benedetti d’être formellement assuré par le roi qu’il n’y aurait plus d’autre candidature. L’empereur malade cède en effet à son ministre belliciste et aux mamelouks, alors que la menace de guerre est écartée et que Bismarck menace de démissionner. Guillaume Ier considère que l’incident avec la France est clos et refuse de s’engager et d’accorder une nouvelle audience à l’ambassadeur.
Le roi de Prusse fait envoyer par son conseiller diplomatique Heinrich Abeken, un télégramme à Bismarck, qui est à Berlin, en présence du chef d’état-major von Moltke et du ministre de la Guerre Roon, indiquant avoir été arrêté dans sa promenade pour lui « demander finalement, d’une manière très indiscrète, de l’autoriser à télégraphier aussitôt à l’empereur » son engagement à ne plus donner son consentement si les Hohenzollern revenaient sur leur candidature. Il indique qu’il se résout à lui faire dire simplement par un aide de camp qu’il avait reçu du prince confirmation de la nouvelle que Benedetti avait déjà eue de Paris. Il laisse au chancelier Bismarck le soin de décider s’il estime utile de communiquer la nouvelle exigence de Benedetti et le refus qui lui a été opposé.
Mais Bismarck rédige pour tous les ambassadeurs une version « condensée » et durcie du télégramme centrée sur le refus de recevoir une nouvelle fois l’ambassadeur. La dépêche mentionne au surplus, à la suite d’une erreur de traduction, que le roi lui fit dire par l’adjudant de service que Sa Majesté n’avait plus rien à lui communiquer. » La conversation courtoise est ainsi transformée en incident diplomatique dans l’objectif de pousser à la guerre destinée à sceller l’unité allemande.
À Paris, le Conseil des ministres est réuni au palais des Tuileries à midi. L’empereur se range à l’avis d’un vote sur les crédits militaires. Le Conseil devient plutôt favorable à l’apaisement.
Mais le soir le Conseil des ministres réuni une nouvelle fois, incité par une opinion qui appelle à la guerre, bascule pour la guerre.
Le maréchal Leboeuf déclare que nous sommes prêts, que nous ne serons jamais en meilleure situation pour vider notre différend avec la Prusse et que nous pouvons avoir confiance. Il rappelle les réservistes.
Bismarck fait connaître à la Grande-Bretagne qu’il exige des réparations morales de la part de la France. Il écrit à son ambassadeur à Munich qu’il « se verrait obligé de faire la guerre si la France ne donnait pas des garanties de sa bonne conduite pour l’avenir ». Le lendemain, la mobilisation est décrétée par Guillaume Ier.
Le vote des crédits supplémentaires de guerre et la déclaration de guerre
Emile Ollivier, qui n’a pas pris part aux décisions, demande le 15 juillet au Corps législatif le vote des crédits supplémentaires de guerre. Il considère la déclaration lue devant le Corps législatif comme une réponse au « soufflet de Bismarck ». Au cours des débats Thiers rappelle que « le roi de Prusse a déclaré, non pas de sa personne mais par son gouvernement, qu’il connaissait et approuvait le retrait de la candidature du prince de Hohenzollern. » « Pouvez-vous supposer que la candidature du prince de Hohenzollern étant retirée, il n’y ait pas eu une concession de la part du roi de Prusse lui-même ? ». Il affirme « qu’ayant eu gain de cause sur le fond des choses, on en venait à la rupture pour une question de susceptibilité. » Ainsi, répète-t-il « ce n’est pas pour l’intérêt essentiel la France, c’est par la faute du cabinet que nous avons la guerre. » Pour Jules Favre « la question est réduite à celle de savoir si l’honneur de la France a été engagé. » Il demande communication des dépêches diplomatiques.
Dans une atmosphère surchauffée Emile Ollivier déclare imprudemment accepter « une grande responsabilité (…) d’un coeur léger ». Gambetta intervient à plusieurs reprises. En séance de nuit il demande un vote sur la question de guerre et un autre sur les mesures préparatoires à la guerre. « Ne croyez pas, affirme-t-il, qu’il sorte de ma bouche une parole qui puisse jamais servir à l’étranger. » Il demande s’il est « vrai que la dépêche » de Bismarck « a été « expédiée à tous les cabinets de l’Europe ». « S’il est vrai que cette dépêche soit assez grave pour avoir fait prendre ces résolutions, vous avez un devoir, ce n’est pas de la communiquer à la France et à l’Europe ; et si vous ne le faites pas, votre guerre n’est qu’un prétexte dévoilé et elle ne sera pas nationale. »
Neuf parlementaires républicains de gauche dont Arago, Jules Favre, Glais-Bizoin, Jules Grévy, Edouard Pelletan, Picard, de même que Thiers ne votent pas les crédits supplémentaires. D’autres dont Ferry, Gambetta votent pour avec la majorité.
Le 19 juillet la France déclare officiellement la guerre à la Prusse.
« La séance terminée, je rentrai chez moi, avec mes amis, consterné, convaincu que nous marchions aux plus grands malheurs », se souviendra Thiers (déposition devant la Commission d’enquête sur les actes du Gouvernement de la Défense nationale).
Le 28 juillet l’empereur quitte le palais de Saint-Cloud pour prendre le commandement des armées. Mais c’est un homme malade qui confie à son médecin, le docteur Sée, qu’il souffre tellement qu’il ne lui est pas possible de monter à cheval. Maxime Du Camp le décrit comme immobile, muet, ne répondant à personne. L’impératrice Eugénie devient pour la troisième fois régente de l’Empire (elle l’a déjà été en 1859 et en 1865). Elle préside le Conseil des ministres, mais ne peut juridiquement promulguer que les lois dont la discussion est en cours.
L’enchaînement inéluctable des défaites militaires
Napoléon III s’est trompé sur l’attitude des puissances européennes choisissant la neutralité et se trouve sans alliance. Il a surestimé l’état des forces militaires françaises.
La France compte 265 000 hommes, sur un front de 250 kilomètres, de Thionville à Bâle mais leur mobilisation prend du retard. La Prusse et ses alliés d’Allemagne du Sud en alignent près de 600 000 bien organisées, préparées et bien mieux équipées. Trois armées sont placées sous le commandement du comte Helmuth von Moltke, chef du grand état-major.
Le 2 août les troupes françaises lancent une offensive sur Sarrebruck mais sans rien obtenir. Le 3 août Moltke fait avancer ses troupes à la frontière. Le Kronprinz marche avec la IIIe armée en direction de l’Allemagne. Les défaites vont s’enchaîner en raison de la faillite du haut commandement.
Ainsi à Wissembourg le 4 août une bataille inégale s’engage au cours de laquelle 8 bataillons français résistent héroïquement pendant six heures à 31 bataillons allemands. Le maréchal de Mac Mahon qui a reçu le commandement de toute l’Armée du Rhin prend position autour de Frœschwiller-Wœrth dans les Vosges du nord afin de couvrir l’aile droite de toute l’armée, particulièrement les routes de Bitche et Saverne.
Le 6 août 1870 au matin, la IIIe armée prussienne et ses 130 000 hommes entre en contact avec les unités françaises. Mac Mahon ordonne deux charges de cavalerie à Reichshoffen afin de protéger la retraite. L’Alsace est perdue.
Passant outre à l’ordre de l’empereur de s’arrêter à Nancy en vue de s’opposer aux Prussiens Mac Mahon dont les troupes sont épuisées marche difficilement sur le camp de Châlons afin de réorganiser une armée reconstituée, l’armée de Châlons. « C’est la retraite de Russie moins la neige », dit-il. Après la défaite de Forbach-Spicheren c’est alors au tour de la Lorraine d’être perdue. Les batailles des frontières sont ainsi perdues et c’est l’invasion.
L’Impératrice régente et Emile Ollivier convoquent les chambres. Au Corps législatif Jules Favre demande la réorganisation de la Garde nationale et la création d’un comité composé de 15 membres du Corps législatif « investi des pleins pouvoirs de gouvernement pour repousser l’invasion étrangère ». Clément Duvernois, député bonapartiste autoritaire, dépose un ordre du jour : « La Chambre décidée à soutenir un cabinet capable d’organiser la défense du pays ». L’ordre du jour est refusé par Emile Ollivier qui s’estime mis en cause.
Le vote de l’ordre du jour par une coalition des extrêmes conduit Emile Ollivier à démissionner. L’impératrice nomme pour lui succéder, en violation des limites de la Constitution, le général Charles Cousin-Montauban, comte de Palikao, qui s’est illustré dans l’expédition de Chine mettant un terme aux deux guerres de l’opium, et lui confie le portefeuille de la guerre. Il sera le dernier chef de Gouvernement du Second Empire.
Le 10 août les députés républicains Arago et Picard demandent la discussion du projet de loi d’armement de la garde nationale. S’opposant au renvoi du gouvernement, Gambetta en appelle au salut public : « Il faut que nous suscitions aussi une nation armée ». Le 11 c’est à l’unanimité que le Corps législatif adopte le rétablissement de la garde nationale. Gambetta dépose le 12 août une pétition des électeurs de la 3e circonscription de Paris demandant d’armer la capitale.
Le 13 août l’armée allemande encercle Strasbourg et bombarde la ville. Strasbourg se prépare à tenir un long siège qui durera jusqu’au 28 septembre. Napoléon III abandonne son commandement de l’armée du Rhin au maréchal Bazaine et rejoint Châlons le lendemain.
Au Corps législatif où reprend la discussion de la proposition de comité de défense de Jules Favre à laquelle s’oppose Palikao, considérant qu’elle aurait pour conséquence le retrait du gouvernement, Gambetta répond : « Il faut savoir si, ici, nous avons fait notre choix entre le salut de la patrie et le salut d’une dynastie. » Les applaudissements du public dans les tribunes conduisent Schneider, président du Corps législatif, à demander leur évacuation et la droite bonapartiste un comité secret.
Au cours de ce comité secret du samedi 13 août 1870, Jules Favre demande le transfert du pouvoir à la nation, ce qui pose la question du régime.
Gambetta, qui défend l’idée d’un comité de contrôle, va jusqu’à poser la question de suspension de l’exercice du pouvoir du chef de l’État c’est à dire de la survie du régime tout en affirmant qu’il ne prononce pas le mot de déchéance qui a circulé. Il évoque le patriotisme des Alsaciens. Le député de Mulhouse Pierre Tachard souligne le dénuement en armement des Alsaciens abandonnés par l’armée de Mac Mahon battant retraite vers Châlons. Emile de Kératry redoutant une coupure des communications entre Paris et Metz critique les choix stratégiques et la position du corps d’armée placé sous les ordres du maréchal Bazaine.
Le 18 août, le général Louis Trochu, un orléaniste libéral, qui en 1867 avait critiqué l’impréparation de l’armée, est nommé gouverneur de Paris. La capitale doit être protégée par l’armée de Châlons conduite par Mac Mahon. Napoléon III souhaite rejoindre Paris, mais l’Impératrice Eugénie et Cousin-Montauban s’y opposent ayant envoyé Rouher à Châlons pour le convaincre d’y renoncer.
A Saint-Privat et Gravelotte le combat sanglant entre 190 000 Prussiens et 115 000 Français se solde par une défaite française. Le maréchal Bazaine se laisse assiéger dans Metz à partir du 20 août 1870 avec 180 000 hommes. Bien qu’il y ait moins de pertes du côté français que du côté prussien, c’est une défaite cuisante de la France.
Le lendemain l’empereur rejoint Mac Mahon au camp retranché de Châlons afin de venir en aide à Bazaine et éviter que n’éclate une révolution à Paris. Gambetta, Favre, Ferry et Thiers soulignent l’insuffisance de la défense de Paris et de de la garde nationale. Gambetta dénonce l’absence d’informations communiquées par le gouvernement sur la bataille de Saint-Privat. Il demande une réunion en comité secret en présence du général Trochu dont la nomination au poste de gouverneur de Paris a été mise en cause par les ministres proches de l’impératrice régente. Au cours du comité secret du 25 août sont évoquées l’insuffisance de l’équipement et de l’armement notamment de la garde mobile et l’accumulation des défaites. Emile de Kératry suggère de décentraliser l’effort de guerre en accordant l’initiative aux communes.
Le comité secret du 26 août demandé par l’ensemble du Corps législatif est consacré à la défense de Paris. Jules Favre y affirme que « Paris doit se défendre jusqu’à la dernière extrémité ». Il interroge le ministre de l’Intérieur sur la situation de désarmement des Parisiens accusant même le cabinet de trahison. La question est celle de l’armement de la garde nationale déjà évoquée par François Raspail le 10 août dénonçant que l’on ait davantage peur de la garde nationale que des Prussiens.
Le désastre de Sedan et la capitulation : la débâcle
L’armée de Châlons conduite Mac Mahon et Napoléon III tente de délivrer Bazaine à Metz. L’empereur y a installé son grand quartier-général où il est enveloppé, dit-on, dans une somnolence perpétuelle. Mais elle est encerclée par Moltke à Sedan dans un méandre de la Meuse. Mac Mahon gravement blessé est remplacé par le général Ducrot puis par le général de Wimpffen tous deux dans l’incapacité de coordonner des percées comme prévu.
Les Français sont écrasés par les canons prussiens placés sur les collines au-dessus de Sedan. La charge de la cavalerie française à Floing s’avère inutile face armes prussiennes. Le 1er septembre 1870, une division d’infanterie de marine française réfugiée dans une auberge à Bazeilles fait face aux Bavarois qui ne parviennent pas à la prendre. Les Bavarois s’acharnent sur les populations civiles. Les soldats français encerclés par les envahisseurs prussiens se battent jusqu’aux dernières cartouches. L’on dénombre à Sedan dans le camp français 20 000 tués, blessés ou prisonniers.
Napoléon III fait hisser le drapeau blanc. Il fait porter un message au roi Guillaume : « Monsieur mon frère, n’ayant pu mourir à la tête de mes troupes, il ne me reste qu’à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. » C’est l’échec d’une guerre engagée à la légère.
A Paris alors que déjà la bataille de Sedan était engagée et désespérée, l’impératrice régente fait demander à Thiers par l’entremise de Daru s’il consentirait à devenir président du Conseil des ministres, ce qu’il refuse.
Le 2 septembre l’empereur, acceptant le désastre, va au-devant de l’état-major allemand pour se constituer prisonnier.
Il est reçu dans une modeste maison par le chancelier Bismarck qui l’informe qu’il ne pourra rencontrer le roi Guillaume Ier qu’après avoir signé l’acte de reddition. L’acte de capitulation est signé au château de Bellevue, sur une hauteur à quelques kilomètres de Sedan, et où les deux souverains se rencontrent en secret. Les officiers qui donneront leur parole de ne plus combattre les Allemands pendant la durée de la guerre seront libérés. Ceux qui ne veulent pas abandonner leurs hommes conserveront armes et effets personnels. L’empereur sera détenu près de Cassel, au château Wilhelmshöhe où il restera emprisonné jusqu’au 19 mars 1871.
La route de Paris est bientôt ouverte. Six semaines auront suffi pour écraser l’Empire et provoquer la débâcle.
Bertrand Marcincal
Conseiller de l’Assemblée nationale
Ancien chef de la division des Archives à l’Assemblée nationale
Chargé de cours à l’UCL