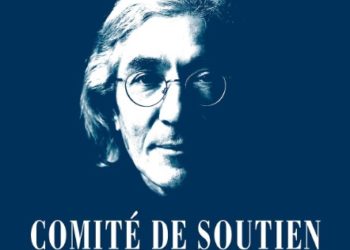Dans cette période de crises et de doutes, il est urgent, pour Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et députée du Pas-de-Calais, de s’inspirer de l’héritage de Charles de Gaulle, de son message et de sa vision de la France.
Dans la préface d’un recueil de poésies, Chateaubriand constatait « nous avions nos trois ordres intellectuels, le génie politique, le génie militaire, le génie littéraire, comme nous avions nos trois ordres politiques, le clergé, la noblesse et le tiers état. »
Il concluait qu’il était de principe impossible que ces trois ordres intellectuels puissent se retrouver réunis dans la même tête.
Peut-être, rappelant les grands talents politiques et militaires de la Grèce ou de l’Italie anciennes qui furent souvent de grands talents littéraires, la stature du général de Gaulle, militaire, homme d’État et homme de lettres, vient servir de contre-exemple à l’affirmation de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe.
Il est vrai qu’avec Charles de Gaulle, l’histoire nous met en présence d’une personnalité hors norme telle que le tumulte des événements et les situations exceptionnelles savent les enfanter à peine une fois par siècle : sans la Révolution, pas de Napoléon, sans la Guerre, pas de de Gaulle.
L’année des trois anniversaires de sa naissance, de sa mort et de son fameux Appel du 18 juin 40, quel héritage laisse le grand homme dont l’ombre jaillit dès que la lumière, sur le pays, pâlit ?
Avec le temps, les controverses sont apaisées. Les remous qui sont le propre des temps tourmentés et des impératifs de la raison d’État n’ont contrarié ni la direction, ni la puissance du fleuve. L’Histoire a tranché. L’homme appartient à notre histoire nationale et son héritage appartient à tous les enfants de France et en ces périodes de doutes, doit les inspirer.
Dans l’esprit du peuple français, sans souvent le savoir, c’est en effet son idée de la France qui a triomphé et avec elle sa conception de l’État.
Comme le constate François Mauriac, de la politique, de Gaulle « ne consent à en épouser que la grandeur » avec la conscience que seul ce qui est élevé rassemble.
De cette époque d’un siècle qui s’éloigne et dont les témoins directs disparaissent, il reste le souvenir, souvent en noir et blanc, d’une France insouciante et souriante, celle des années 60 qui s’encanaillait avec le déhanchement licencieux des yéyés, celle qui prenait les visages éblouissants de Brigitte Bardot et d’Alain Delon et se retrouvait autour de joies simples à acclamer le tour de France cycliste. Cette France, sans le mesurer, vivait rassurée par une relative opulence, une tranquillité intérieure, une puissance militaire redevenue dissuasive et un apaisant rayonnement international.
Les patriotes voient dans l’épopée chevaleresque d’un insoumis impénitent, qui cloua le cercueil de deux républiques défaillantes et redonna à la France le goût de la grandeur, la puissance d’une œuvre qui convergea invariablement vers le même point haut : la patrie.
Deux mots qu’il aimait utiliser, parce qu’ils sont le secret de la vie, résument son existence et son action : l’ordre et le mouvement.
La France qui, entre dans le IIIe millénaire avec les hésitations d’une puissance déclinante, peut puiser dans l’œuvre une sorte de discours de la méthode politique. Il serait urgent au pays de s’inspirer de l’homme et de sa vision.
Un homme d’ordre et de mouvement
Le personnage de Gaulle, c’est un immense comédien qui a conscience de jouer un rôle, un rôle historique en incarnant l’homme providentiel, un rôle institutionnel en incarnant l’État, un rôle politique en incarnant la France.
L’homme de Gaulle, c’est une alchimie particulière : un caractère, « cette vertu des temps difficiles » ; un physique – important en politique – qui par sa seule prestance impose le respect ; une voix qui porte avec emphase un sens inné de la formule ; un geste qui pose le verbe ; un esprit taquin jusqu’à l’ironie qui mord et parfois assassine.
Mais autant l’homme public savait se mettre en scène par devoir de représentation et se tenait à un apparat républicain exigeant qu’il devait à « la majesté du peuple français » et au prestige de l’État, autant l’homme privé s’était choisi une vie simple et discrète. Il se sentait même prisonnier de l’Élysée. Le Président de Gaulle n’acceptait que les honneurs dus à sa fonction.
Ses dernières volontés réclamèrent des obsèques humbles, entourées de sa famille et de simples citoyens français. Il y récuse par avance le moindre honneur posthume. Nul doute qu’aujourd’hui il s’étonnerait de voir donner son nom à tout, aux aéroports, aux bateaux, aux ronds-points, en violation de ses dernières volontés.
Inutile de rechercher un quelconque paradoxe entre la solennité de l’homme public et la sobriété du citoyen, l’immodestie apparente et la pudeur non feinte, là où préside une vision d’ordre.
L’intelligence et l’instinct
Une personnalité n’est jamais dissociable et l’histoire d’un homme est un tout.
Les visions stratégiques du soldat avec son essai Vers l’armée de métier, ses pensées politiques contenues dans ses « discours et messages » ou les élans littéraires de ses Mémoires, procèdent d’une même intelligence, celle d’un homme habité par la puissance de l’ordre et du mouvement, de l’idée au service de la mobilité.
C’est la parfaite connaissance de l’histoire qui avait donné à cet érudit la conscience du rôle des hommes dans la conduite et l’orientation des événements.
« On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l’avoir voulu » affirmait-il pour rappeler le rôle de la volonté en politique. Il ajoutait pour souligner l’importance irremplaçable de la valeur des chefs : « Ce que l’infirmité du chef a, en soi, d’irrémédiable ne saurait être compensé par la valeur de l’institution ».
Attaché à la transmission des valeurs et des savoirs, il attribuait aux humanités, à la culture générale la qualité du commandement et au goût de l’initiative la vertu de l’encadrement.
Dès 1926, il recommandait pour l’École de guerre une pédagogie militaire dynamique : « Favoriser le développement des personnalités en exerçant avec méthode la réflexion, le jugement, la faculté de décision, telle doit être la seule loi de l’enseignement donné à l’École. »
Très tôt, également, dans le Fil de l’Epée, il définissait les qualités du chef militaire dont on devine qu’il les attendait de l’homme d’État.
Il savait que forgée par l’expérience des siècles, la pensée de l’homme de caractère ne devait pas se brider dans d’asséchantes et anachroniques doctrines, mais devait laisser s’exprimer l’instinct de décision dont le for intérieur est la matrice lorsqu’elle s’appuie sur la méditation solitaire.
« Toujours le chef est seul en face du mauvais destin » avertissait celui qui, comme les grands hommes, connaissait la solitude des sommets.
Au prestige qui confère l’autorité au chef, il ajoutait la sobriété de parole et le mystère qui le distingue des autres mortels, des verbeux, des mesquins.
« Viser haut, voir grand, juger large, tranchant ainsi sur le commun qui se débat dans d’étroites lisières » enseignait le commandant de Gaulle dès les années 30.
Dans une société moderne qui s’extasie devant le clinquant, qui se rabougrit dans le facile et s’atrophie dans le prêt à penser, cet inspirant rappel sonne pour nos élites comme un rappel à l’ordre.
Agir
Le courage, physique et moral, est l’âme de l’épée, il est aussi celle de l’autorité.
De son baptême du feu dès les premiers jours de la Grande Guerre en Belgique à l’enfer de Verdun où il fut fait prisonnier, son engagement au combat valut au jeune officier de Gaulle trois blessures de guerre. Mais la plus douloureuse fut l’invisible blessure de l’âme, celle de la captivité qu’il décrit, malgré cinq tentatives d’évasion, comme un « lamentable exil ». Il mettra à profit cette période d’immobilité imposée pour méditer sur la France.
Près de vingt-cinq ans plus tard, colonel à la tête de son régiment de cuirassés, il mène à Montcornet, le 17 mai 40, une contre-offensive désespérée face à la puissance mécanique allemande, l’alliance dynamique de combat du char et de l’avion, cette guerre mécanisée dont il avait théorisé la pertinence durant l’entre-deux-guerres.
Le mois suivant, devenu général « à titre provisoire », on le retrouve à Londres derrière un micro, exhortant un pays qui déposait les armes pour ne plus avoir à les porter, appelant son peuple à rester debout et à poursuivre le combat.
Derrière l’impétuosité et l’inoxydable esprit de résistance, pointe toujours chez de Gaulle l’exigence du mouvement allié à une vision haute.
Et quand viendront les confrontations avec l’amiral Darlan, le général Girault, le maréchal Pétain ou le « quarteron de généraux en retraite » d’Alger, c’est cette vélocité de pensée et de réaction qui fera la différence au bénéfice d’un de Gaulle finalement plus politique que militaire.
Le rebelle
La capacité de synthèse qui hiérarchise les données, la capacité d’adaptation au terrain qui déroute l’ennemi, l’esprit créatif qui invente les solutions, tout, chez Charles de Gaulle se résume également dans l’ordre et le mouvement de la pensée, une pensée libre qui peut glisser jusqu’à la dissidence et même, lorsque l’éthique le commande, la désobéissance.
Chercher à s’évader quand on est prisonnier, se rebeller quand l’honneur le commande, reconnaître la Chine quand une logique des blocs l’interdisait, bousculer les féodalités pour donner à la France des institutions à sa mesure, clamer du haut d’un balcon « vive le Québec libre » pour soutenir la cause de descendants de Français opprimés… la vie de Charles de Gaulle témoigne d’une vivifiante et entraînante indépendance. Être neutre, c’est déjà être soumis. Cette insoumission pour éviter la soumission lui vaudra une condamnation à mort.
Oser dire « non » lorsque tout, le confort, la reconnaissance, les honneurs vous incitent à acquiescer est une qualité rare. Accepter de payer le prix de son opposition par la diffamation, la relégation inique et la condamnation injuste est la marque d’une grande noblesse. Nombre de ceux qui ont ouvert les voies de la vérité en connaissent le prix.
Le visionnaire
La grandeur se conquiert
Sans être un idéologue de la décadence, le général de Gaulle était, à juste titre, hanté par l’idée du déclin de la France. Il est toujours plus simple de descendre vers l’abîme que de monter vers les sommets.
Homme de vision haute, il n’ignorait pas que la liberté des peuples, la vie des Nations, la grandeur des États ne sont jamais acquises mais procèdent d’une lutte permanente.
Sa culture lui avait enseigné que la liberté comme la souveraineté des nations ne sont pas intangibles mais relèvent d’un équilibre toujours remis en cause que seul le génie des peuples, mais aussi parfois l’action salvatrice d’un seul, doivent préserver ou rétablir.
Les civilisations comme les nations, même les plus brillantes, doivent avoir conscience que la grandeur n’est jamais définitive.
Patriote par raison et par sentiment, il savait que la France, « Notre dame la France » comme il la nommait par affection charnelle, puisait ses racines dans une histoire millénaire, mais qu’elle n’en n’était pas moins fragile. Il est des chênes qu’on abat.
Comment s’étonner qu’il ait théorisé avec lyrisme le mouvement qui conduisait la France « allant et venant de la grandeur au déclin ». Jamais pourtant, il ne dissimula sa crainte que le balancier, un jour, ne s’arrêtât et que la France sorte de l’histoire par la disparition ou l’effacement.
Face aux bouleversements du moment, aux convulsions du monde, il nous rappelle que quand un peuple n’écrit pas l’histoire, il la subit.
À des Français enclins au fatalisme du déclin et au confort du laisser-aller, il enseigna que « les exigences d’un grand peuple sont à l’échelle de ses malheurs. »
Comme une leçon d’optimisme et de vie, il est aussi venu montrer qu’on pouvait croire contre toute espérance.
Dans une société où le confort de vie est souvent donné comme un droit immuable, en un temps où l’éphémère et le frivole triomphent sur le durable et le solide, où la culture se réduit souvent à une communication clinquante, cette conscience du combat perpétuel pour s’élever reste un utile rappel.
Pour la vie des Nations et pour la France, elle demeure une règle d’airain.
Comprendre l’alchimie de la France
De Gaulle n’est pas issu de nulle part. De Gaulle est de France.
La France ne se résume pas, pour « le plus illustre des Français » ni à un régime, ni même à une génération. Elle est une réalité affective et vivante qui trouve son âme dans son histoire et dans son génie les moyens de perdurer dans son intégrité et sa souveraineté mais toujours dans le respect des autres peuples.
Admirateur de Richelieu, il sait que l’histoire de France raconte la lutte multiséculaire de la Nation et de son bras armé l’État contre les féodalités aristocratiques, oligarchiques ou même partisanes.
Jean-Pierre Chevènement, gaulliste croyant mais publiquement non pratiquant, nous rappelle très justement que « De Gaulle nous a légué une conception sacerdotale de l’État, du service de la chose publique. »
L’État n’est pas une fin en soi mais « répond de la France, et est en charge, à la fois de son héritage d’hier, de ses intérêts d’aujourd’hui, de ses espoirs de demain » (Mémoires). Depuis Colbert, son rôle est central dans la mise en place des protections immédiates et de celles du long terme. L’État ne doit jamais être neutre quand il s’agit de la France ; la vision qu’il soutient au nom de la France tant pour ses grands projets industriels, la puissance militaire, l’affirmation de son identité dans le concert des nations est naturellement patriotique.
Lorsque l’État, comme à l’heure actuelle, se met à fonctionner pour lui-même et joue contre la Nation, c’est le signe d’un profond dérèglement. Pour son Chef en charge de « l’essentiel », qui incarne la continuité au-dessus des contingences, ce pilier institutionnel qui est l’homme de la Nation, la restauration de l’État, de son autorité, de ses moyens d’intervention devient alors une priorité absolue. C’est ce que fit le Général en clôturant la triste expérience de la IVe République.
Républicain et capétien
Politiquement, loin de la vision impériale qui aurait une vocation naturelle à l’expansionnisme, de Gaulle concilie l’héritage capétien et la légitimité républicaine dans une pensée synthétique exprimée dans le discours fondateur du 4 septembre 1958 :
« Jusqu’alors, au long des siècles, l’Ancien Régime avait réalisé l’unité et maintenu l’intégrité de la France. Mais, tandis qu’une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il se montrait hors d’état de s’adapter à un monde nouveau… C’est alors qu’au milieu de la tourmente nationale et de la guerre étrangère apparut la République ! Elle était la souveraineté du peuple, l’appel de la liberté, l’espérance de la justice. »
Loin d’opposer la Monarchie à la République, qui est le propre des esprits superficiels, il les réconcilie dans une vision historique large et élevée dans laquelle la Nation, le peuple et l’État retrouvent chacun leur place et leurs prérogatives.
La Constitution de 1958 sera l’expression institutionnelle de cette conception synthétique, une république monarchique où l’ordre procède de la stabilité et de la durée du système politique et le mouvement de sa capacité d’action. Enfin, au bonapartisme rétif au jeu parlementaire et à l’intervention des corps intermédiaires, il empruntera la dimension référendaire et même, pour ce qui le concerne, plébiscitaire. Cette logique le conduira à démissionner après le référendum perdu de 1969. C’est dire s’il aurait condamné ses prétendus héritiers de passer le référendum de 2005 à la trappe par un tour de passe-passe juridique qui s’apparente à un véritable coup d’État.
Son père ne reconnaîtrait plus la Ve république
Bien que se réclamant de lui, ses successeurs n’ont pu s’empêcher par mimétisme étranger, convenances politiciennes ou incompréhension des institutions léguées par les constitutionnalistes de 1958, de dénaturer profondément les institutions de la Ve République. Le quinquennat avec son corollaire, la campagne présidentielle permanente, l’effacement du Premier ministre, la montée des contrepouvoirs notamment judiciaires sans légitimité populaire et l’abandon des référendums en ont altéré la logique et l’équilibre profonds.
Sans qu’il soit besoin d’une grandiloquente VIe république, la Ve est aujourd’hui à restaurer, notamment par deux réformes essentielles : le septennat non renouvelable, l’extension du référendum.
Une doctrine – Trois piliers
La doctrine gaulliste repose sur trois piliers que beaucoup qui s’en réclament oublient volontiers dans leur projet européiste ou atlantiste : la souveraineté qui interdit de confier à des instances étrangères nos intérêts, l’indépendance qui exclut la vassalisation de nos positions et moyens, l’unité qui est la condition indispensable de la grandeur.
Économiquement, le gaullisme véritable est difficilement classable ; ce qui en fait une doctrine d’avant-garde c’est de n’être ni de droite ni de gauche ou plutôt d’être « et de droite et de gauche », de croire dans l’économie de marché tout en plaçant l’économie au service de la Nation et non comme une fin en soi ; de protéger les entreprises mais d’y mettre en œuvre la participation des salariés ; d’adhérer à la liberté d’entreprendre mais de s’ouvrir la possibilité de nationaliser si l’intérêt national l’exige.
Sur l’échiquier politique, aujourd’hui, seul le Rassemblement national défend cette ligne.
Comprendre le mouvement du monde
Fort d’une pensée ordonnée, le gaullisme se conçoit comme une force qui croit et donc accompagne le mouvement du monde. Les exemples de décisions d’avant-garde sont nombreuses : la réforme monétaire, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, la décolonisation, la reconnaissance de la Chine, l’ouverture des grandes filières industrielles ou de puissance (le nucléaire civil et militaire, la communication, la conquête de l’espace, les trains à grande vitesse…), les CHU, la sortie du commandement intégré de l’Otan, la construction européenne sur le modèle d’une Europe des Nations, le rapprochement avec la Russie éternelle, alliée naturelle de la France….
Force est de constater que la France du XXIe siècle a perdu l’avance technologique, industrielle, militaire et diplomatique qui constituait les acquis de cette politique exclusivement dictée par l’intérêt national.
De la même manière, la crise sanitaire que connaît la France fournit matière à réflexion.
Si beaucoup ont comparé la crise du coronavirus et ses conséquences économiques prévisibles à une déflagration de guerre, la gestion de la crise ressemble au désastre de 1870 ou de 1940 : une armée mal préparée, une logistique défaillante, une stratégie incertaine, des chefs sans vision haute… À moins qu’il ne s’agisse d’un naufrage plus lent tel que l’a connu la France, enlisée dans la guerre d’Algérie avec une IVe République agonisante.
C’est pourquoi, le 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin prend cette année un relief particulier dans une France qui a le sentiment d’être assiégée par un ennemi invisible, dominée par les événements, ballotée par l’indécision.
C’est dans les moments de tensions que les failles s’élargissent, les maillons faibles s’étirent, les étais de contrefaçon plient. C’est le moment aussi où la léthargie s’exprime, la pusillanimité devient contagieuse et les incompétences donnent la pleine mesure de leur nuisance.
La France a même de quoi se sentir humiliée par les trop nombreuses et impardonnables défaillances : affaissement du pouvoir exécutif, léthargie d’une bureaucratie qui paralyse des responsables politiques irrésolus, infirmité des corps intermédiaires… La France paye un lourd tribut humain à la perte de sa souveraineté industrielle, notamment en matière sanitaire et médicale.
Mais pour ceux qui savent regarder, pour ceux qui ne se contentent pas d’un « j’ai vécu » fataliste, ces situations de crise alertent plus largement sur l’état général du pays. Après la phase de glissement qui aura duré trente ans, c’est maintenant que se produit le décrochage, brutal, inexorable, meurtrier.
Cette crise sanitaire et sa calamiteuse gestion sonnent l’alarme, celle du déclin et, si rien n’est fait, de la déchéance.
Comme en écho avec la pensée gaulliste, la philosophe Simone Weil, membre de la France Libre, déclarait en 1943 dans L’enracinement :
« L’unique source de salut et de grandeur pour la France, c’est de reprendre contact avec son génie au fond de son malheur ».
Encore une fois, il appartient à une génération de Français de se lever pour empêcher le balancier de s’arrêter.
Plus que jamais, le message comme l’héritage du général de Gaulle doivent nous inspirer.
Marine Le Pen
Présidente du Rassemblement national
Députée du Pas-de-Calais