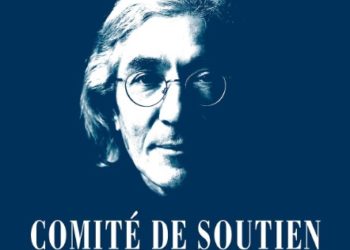Le débat sur les frontières, la gouvernance, l’organisation territoriale de Paris et de sa banlieue a connu une accélération exceptionnelle durant la dernière décennie : lancement des ateliers internationaux d’architecture (2009), création de la société du Grand Paris pour construire d’un nouveau métro automatique (2010), naissance de la métropole du Grand Paris (2016). Surtout lorsque l’on replace ces décisions dans le contexte historique des nombreux et anciens débats autour de l’avenir de Paris et sa banlieue.
L’annexion des communes suburbaines
Remontons 180 ans plus tôt, lors du débat parlementaire de 1840 sur la défense de Paris, où le gouvernement adopte le parti des forts avancés. L’opposition républicaine soupçonne la possibilité, pour l’artillerie, de se retourner contre les Parisiens, et réclame des remparts à l’ancienne ne protégeant la capitale que d’un péril extérieur. Ceci aussi, afin de permettre au peuple en arme de défendre les remparts. Un compromis sera trouvé pour que la ville soit entourée, dans ses faubourgs, d’une enceinte bastionnée, les fortifications et d’une quinzaine de forts, bouclant Paris aux trois quarts, de Saint-Denis à Issy-les-Moulineaux, la Seine fournissant une ligne de défense naturelle à l’ouest, renforcée par le fort du Mont-Valérien. L’enceinte dite « de Thiers » est bel et bien créée entre 1841 et 1844 autour de Paris. Cette approbation donnée en 1840 par le gouvernement, à la loi déposée par Adolphe Thiers, alors député de l’opposition, constitue une étape clé dans l’histoire du Grand Paris. Englobant la totalité de la capitale, soit près de 80 km2, l’enceinte de Thiers se situe alors entre les actuels boulevards des Maréchaux appelés à l’origine « rue Militaire », et le futur emplacement du périphérique. Auparavant Paris s’est agrandie en tâche d’huile, chaque nouvelle enceinte entérinant après coup le débordement de la précédente.
Les années 1840 consacrent un Paris « intra-muros » et sa banlieue.
Pendant le second Empire, la capitale s’étend jusqu’aux fortifications : à partir de 1860, usines et ouvriers sont envoyés de l’autre côté des fortifs, superposant aux fortifications un « mur de l’argent », assumé par le Préfet Haussmann dans une lettre à Napoléon III dès 1857 :
« ll n’est nul besoin que Paris, capitale de la France, métropole du monde civilisé, but préféré de tous les voyageurs de loisir, renferme des manufactures et des ateliers. Que Paris ne puisse être seulement une ville de luxe, je l’accorde. Ce doit être un foyer de l’activité intellectuelle et artistique, le centre du mouvement financier et commercial du pays en même temps que le siège de son gouvernement ; cela suffit à sa grandeur et à sa prospérité. Dans cet ordre d’idées, il faut donc non seulement poursuivre mais encore hâter l’accomplissement des grands travaux de voirie conçus par sa Majesté, faire tomber les hautes cheminées, bouleverser les fourmilières où s’agite la misère envieuse, et au lieu de s’épuiser à résoudre le problème qui paraît de plus en plus insoluble de la vie parisienne bon marché, accepter dans une juste mesure la cherté des loyers et des vivres qui est inévitable dans tout grand centre de la population, comme auxilliaire utile pour défendre Paris contre l’invasion croissante des ouvriers de la province. »
Des mots visionnaires, qui font encore sens 150 ans plus tard…
Un déséquilibre démocratique croissant
Sous la IIIe République, Paris « s’étend » entre les fortifications et la ligne des forts, cimetières, incinérateurs, usines d’assainissement, usines à gaz et centrales électriques. Paris semble sur le point d’annexer sa proche banlieue, mais de façon inattendue en 1930, l’élargissement de Paris jusqu’à la ligne des forts rentre en balance avec une autre hypothèse : l’absorption par la capitale du département de la Seine tout entier !
Car en 1930, si la commune administrative de Paris comprend, en plus de Paris intra-muros, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, le département de la Seine lui n’est finalement qu’un faux-nez, « son » conseil général, un conseil municipal à peine élargi. En ce début du XXe siècle, un conseiller général et municipal élu à Paris représente ainsi un peu plus de 36 000 habitants, un conseiller général de Seine-banlieue 57 000. Un déséquilibre démocratique entre Paris et sa banlieue, qui ne fera que grandir dans les décennies qui suivront.
Les socialistes de la SFIO auront beau réclamer sans relâche la réorganisation administrative du département de la Seine : création d’une assemblée départementale autonome, issue d’un scrutin équitable où tous, qu’ils soient de Paris ou de banlieue, auront les mêmes droits. « Gouvernement d’agglomération », « supercommune » les expressions varient mais le département de la Seine constitue l’horizon du futur Paris. Mais si le débat sur la gouvernance ne fait que commencer, celui des frontières est bientôt clos. En 1920, c’est encore le socialiste Henri Sellier, maire de Suresnes et président de l’Office départemental d’habitations à bon marché, qui propose bien de déclasser la deuxième ligne de défense de Paris, occasion unique de Paris de réserver mille hectares en espaces libres, repartis sur 18 points de la banlieue.
Sans lendemain.
Clin d’œil de l’histoire, 80 ans avant le métro automatique, c’est par le développement du nouveau réseau de métro, dans la limite de la première couronne des communes limitrophes, que Paris va rayonner. Au sein d’un conseil général de la Seine dominé par les élus parisiens, il est décidé en 1928 que 15 lignes de métro seront prolongées. Les transports avant tout, depuis Paris vers sa banlieue limitrophe. Sept lignes seront réalisées avant 1939. En 1936, le Front populaire avait demandé aux maires de Suresnes, Henri Sellier, et de Boulogne, André Morizet, de faire un rapport sur le sujet. Leurs conclusions favorables au rééquilibrage Paris-banlieue se sont enlisées dans la déclaration de guerre de septembre 1939. Occasion manquée.
La Ve république abandonne le projet de ceinture verte, au profit d’un boulevard périphérique qui sépare Paris et sa banlieue de manière plus efficace que l’ancienne enceinte militaire.
En 1964, plutôt que d’élargir Paris au département de la Seine, elle replie le département sur Paris intro-muros. De l’ancienne Seine-banlieue, elle fait trois nouveaux départements : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Paris retrouve ainsi des frontières antérieures d’un siècle. « Une métropole du Grand Paris », joignant à la capitale les trois départements de 1964, peine à se concrétiser, occasion manquée.
Deux horizons perdus d’un Grand Paris qui ne s’est pas fait, la ligne des forts et la limite départementale de la Seine-banlieue, ce dernier trop vaste… Mais au critère de l’étendue, il faut rajouter le Grand Paris « des hautes cheminées », dont l’emblèmatique Plaine Saint-Denis qui fut, jusqu’à la décentralisation et au choc pétrolier, l’une des plus grandes zones industrielles d’Europe à l’égale de la Ruhr ou de Manchester ! Cette réalité humaine, économique, sociale, ouvrière et politique trouve son vote : le Front populaire ! Aux élections législatives d’avril-mai 1936, sur les 29 communes jouxtant Paris, seules Neuilly d’un côté et Vincennes-Saint Mandé de l’autre, y ont élu un député de droite ! La banlieue de Paris passe au rouge, et pour plusieurs décennies. Le découpage de 1964, séparant Paris de la banlieue n’est pas totalement étranger à cette réalité sociologique et électorale.
Imaginer le grand paris de demain
Il faudra attendre 1983 pour que le président de la République François Mitterrand, confie à Roland Castro et Michel Cantal-Dupart le projet « Banlieues 89 » avec un volet Grand Paris. Prémonitoire, s’adressant en 1985 à Enghien-les-Bains aux maires de banlieue, il les invite à transmettre le message :
« Donc, faites quelque chose d’assez solide pour que, en dépit de toutes les variations d’humeur, tous les changements de mode, vous ayez conscience d’avoir créé un tel outil que les autres voudront s’en servir. »
Mais l’héritage de François Mitterrand pour les territoires franciliens, ce sera la décentralisation qui soutient la commune, renforce le département et fait émerger la région. L’intercommunalité et le fait métropolitain attendront encore car sur ces sujets, c’est la politique des petits pas qui va l’emporter. Du moins jusque l’élection de Nicolas Sarkozy.
Inaugurant un terminal de l’aéroport Charles-de-Gaulle en 2007, le nouveau président de la République affirme qu’il faudrait créer « une communauté urbaine » du Grand Paris, on sent poindre alors comme une envie de bousculer les évènements. Par le lancement de « la consultation le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne » en juin 2008, le champ lexical présidentiel éclaire un chemin : « l’aménagement global du Grand Paris », « la réflexion sur le Grand Paris », « le chantier du Grand Paris ». Avec cette consultation, il a repris une idée que lui souffle Jean Nouvel, annonçant les dix équipes d’architectes, de réputation internationale, qui seront mobilisées pour proposer des projets. Sans programme, sans directive, ils doivent imaginer un Grand Paris de demain. Leur savoir-faire entraîne à plancher plus de 500 personnes de disciplines complémentaires, professionnels de l’urbanisme, universitaires et chercheurs. Ce travail se concrétise avec la mise en place de l’Atelier international du Grand Paris. Plusieurs constats font consensus :
- L’attractivité de la capitale et la variété des transports entraînent une métropolisation qui étend l’influence de cette ville-monde. Les villes, à une heure de Paris par TGV cadencé, participent de cette métropole. Les villes à deux heures en profitent, Lyon, Bruxelles, Nantes et demain Bordeaux. Manque à l’appel le dialogue indispensable entre Londres et Paris. Dans les équipes, nombre d’entre elles ont traité de ces territoires mais c’est celle d’Antoine Grumbach qui, suivant le cours de la Seine, cherche une conurbation Paris-Rouen-Le Havre. Ce corridor aurait pu être étoilé et prendre en compte la Seine amont jusqu’à Monterault-Fault-Yonne, la Marne jusqu’à Reims, l’Oise et le canal Seine Nord dont l’ouverture reliera le port de Paris à ceux de la mer du Nord et par Rhin et Danube aux grandes villes de la Middle Europa.
- La démarche doit intégrer les préconisations du sommet de Kyoto en matière d’économie d’énergie. Déjà.
- Il faut de grands aéroports, des universités hors les murs, avec ces cinq villes nouvelles créant l’armature d’une agglomération parisienne qui ne trouve pas son équilibre.
- Un réseau de transports en commun qui ne sait que converger vers Paris, soumis à la concurrence de la SNCF et de la RATP et dont les pannes et retards sont le quotidien des Franciliens.
- Rejeté dans des délaissés, un parc d’habitat social concentre toutes les stigmates des quartiers d’exclusion, plus de chômage, plus de délinquance, plus de jeunes ! Pompeusement désignées en tant que Zones urbaines sensibles (ZUS) par l’Agence nationale de rénovation urbaine. Les investissements de cette agence en région parisienne ont peu d’effets visibles. Vu d’avion le grand Paris des ZUS ressemble à une peau de léopard.
En huit mois, dix projets préconisent des principes d’aménagement touchant l’harmonie de ce que le général de Gaulle nommait « un bordel » en sommant Paul Delouvrier d’y mettre un peu d’ordre.
Une organisation institutionnelle qui peine à exister
Et les élus locaux dans tout cela ? Depuis le changement de municipalité dans le « petit Paris », la ville sait regarder au-delà de ses limites communales. En 2001, Bertrand Delanoë désigne Pierre Mansat comme adjoint au maire en charge des relations avec les collectivités territoriales d’Île-de-France. Pierre Mansat entame une tournée des villes de la proche banlieue, soutient des travaux d’historiens et de sociologues. Ce travail aboutit en 2006 à la mise en place d’une « conférence métropolitaine », club d’élus réunissant des maires de banlieue, à droite comme Philippe Laurent (Sceaux), Jacques J.P. Martin (Nogent-sur-Marne), Laurent Lafon (Vincennes) ou Bertrand Gauducheau (Vanves) et bien entendu à gauche Jean-Yves Le Bouillonnec (Cachan), Bertrand Kern (Pantin), Patrick Braouzec (Plaine Commune) etc. Mais la démarche va toucher ses limites, car si Paris s’avance trop, le fantasme de l’écrasement des petits par le gros va tout bloquer. Il faut repousser le moment d’entrer dans des décisions politiques, qui risque de faire voler en éclats de fragiles équilibres. Et avant cela, faire exister la réalité du destin commun des Parisiens et des villes de banlieue encore méfiantes.
En 2008, la conférence métropolitaine devient Paris Métropole, syndicat mixte d’études regroupant une centaine de collectivités de la métropole. Les maires UMP adhèrent enfin en masse. Le principe est archi-égalitaire : une collectivité, une voix. Le Pré-Saint-Gervais (17 200 habitants) égale Paris (221 1000 habitants). Dans un système comme celui-là, la recherche du consensus est obligatoire. La philosophie même de Paris Métropole empêche les postures autoritaires. Consensuel autant que possible, le syndicat entérine que la métropole sera multipolaire, s’appuiera sur plusieurs centres, même si ce schéma ne fait pas l’unanimité.
Si un fragile équilibre se dessine autour de la reconnaissance du fait métropolitain, cet élan est loin de susciter l’adhésion des maires.
Surtout, le débat entre les tenants d’une métropole intégrée (Philippe Dallier), multipolaire ou régionale n’est pas tranché.
Dans ces années 2008-2010, tout semble mûr pour réfléchir à une gouvernance du Grand Paris, allant dans le sens des toutes premières déclarations du président de la République. Et pourtant, le lendemain de l’annonce des projets issus de l’Atelier international du Grand Paris, la signalétique est décollée et le trousseau des clés attribué aux services compétents de l’État. Périodiquement, environ une fois par mois, les dix équipes se réunissent encore, bénévolement, espérant une commande qui valorise leur stratégie. De leur coté, les élus locaux sont désormais organisés pour peser avec Paris Métropole, car ils veulent un Grand Paris pour le plus grand nombre. Il faut donc instaurer des phases d’élaboration conjointe entre l’ambition d’État et les préoccupations quotidiennes. L’État, au-delà de sa préfectorale, met en place des Établissements publics, petite entorse nécessaire à la loi de décentralisation.
Passée un peu inaperçue en mars 2008, l’installation d’un secrétariat d’État au Développement de la région capitale indique clairement que l’État a l’intention de piloter le sujet. Le titulaire du poste est à l’avenant, un super-préfet du Grand Paris, qui travaille sans et parfois contre les élus locaux, notamment le président de la région Île-de-France, le socialiste Jean-Paul Huchon.
En juin 2009, le discours de Nicolas Sarkozy confirme la vision « transports et aménagement » du futur Grand Paris, portée par l’État. Celle aussi défendue avec ardeur et parfois brutalité par Christian Blanc. En 2010, le projet que livre Christian Blanc ressemble à un oukase : l’État va créer un nouveau réseau de métro de 200 kilomètres (parce que l’actuel est saturé), sans les collectivités locales, pour relier dix « clusters » de développement économique entre eux (parce que la croissance est la priorité). Le réseau passe aussi par Clichy et Montfermeil, communes symboles de la pauvreté. En 2010, le débat parlementaire sur la loi Grand Paris est mené tambour battant. La société du Grand Paris est créée au forceps pour construire le futur métro automatique. Le très raide Christian Blanc est évacué en 2010, au profit du plus rond Maurice Leroy qui prend un temps pour négocier avec la région Île-de-France un plan de mobilisation pour les transports. En échange, de quoi « un deal historique » est signé entre le gouvernement et la région Île-de-France sur le tracé du grand métro automatique, qui est aujourd’hui lancé. Mais de métropole pour le Grand Paris, il n’est toujours pas question. Occasion manquée.
Lors de l’examen de la loi Maptam en 2013 au Sénat, une alliance sénatoriale PC-UMP supprime, presque par accident, les articles concernant la métropole du Grand Paris. La ministre Lebranchu reprenait dans un premier temps les préconisations du syndicat Paris métropole, pour écrire le chapitre parisien de cette loi Maptam sur les métropoles en France. Mais faute de texte adopté par le Sénat et sur lequel débattre, l’Assemblée nationale repart d’une page blanche. Un groupe de députés PS, emmené par l’élu des Hauts-de-Seine Alexis Bachelay, avec le soutien de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, dessine une métropole centralisée de six millions d’habitants, régnant sur des territoires sans autonomie fiscale, après dissolution des intercommunalités existantes. La métropole redistribuera ainsi les fruits de la croissance. Le gouvernement accepte et le texte portant création d’une métropole intégrée qui absorbe les intercommunalités, et à terme fera disparaître les conseils généraux, est adopté.
Patrick Braouezec, président Front de gauche de la communauté d’agglomération Plaine Commune, mène la fronde des élus locaux. La métropole du Grand Paris va devoir « gérer les crèches », soupire de son côté Patrick Devedjian, le président UMP du conseil général des Hauts-de-Seine, qui redoute la suppression de « son » institution. Après des mois de discussion, le gouvernement fait machine arrière, amende la loi Maptam : exit la suppression des conseils généraux et des intercommunalités, mais maintien du cap sur la création d’une métropole multipolaire. Cette concession satisfait à moitié les élus. En effet, elle ajoute une couche supplémentaire au mille-feuille territorial !
Là, le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris entre en fonction, regroupant les 124 communes des quatre départements centraux d’Île-de-France, plus cinq communes limitrophes qui ont choisi d’y adhérer.
Les 340 conseillers métropolitains, issus des conseils municipaux des communes, désigneront alors le premier exécutif de la métropole avec président(e) et vice-présidences. Avec l’accord tacite de la maire de Paris Anne Hidalgo, Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, devient le premier président du Grand Paris.
Assiégée par les conseils généraux et la région Île-de-France, peu soutenue par des maires soucieux de leurs prérogatives, l’avenir de cette métropole est incertain. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, sa disparition a été annoncée à plusieurs reprises. Sans lendemain.
Nous avons voulu montrer que l’imaginaire du Grand Paris est un chantier très ancien et en construction permanente. Pour le moment, un nombre limité d’acteurs politiques et économiques le bâtissent.
Y aura-t-il un jour un récit collectif, porté par les métropolitains eux-mêmes, ces grands absents ? Y aura-t-il un jour un maire du Grand Paris, élu directement par les citoyens ? Reste la question de l’argent. La redistribution du produit des impôts économiques sur les territoires de la métropole parviendra-t-elle à combler le fossé qui sépare Clichy-sous-Bois et Neuilly-sur-Seine ? Voilà quelques-uns des impératifs catégoriques que le président Macron pourrait se fixer comme défis politiques de son action parisienne. Ils précèdent même les grands choix structurels qu’il faut faire. Quel est le territoire pertinent de la métropole ? Quelles compétences donner à ses institutions ? Comment accorder, ensemble, le projet stratégique, l’identité citoyenne et l’efflorescence de la démocratie locale ?
Depuis 180 ans, l’histoire de Paris, des relations avec sa banlieue et donc, du Grand Paris n’en finit pas de rebondir.
Michel Cantal-Dupart
Architecte-Urbaniste
Et
Alexis Bachelay
Entrepreneur
Ancien Député des Hauts-de-Seine