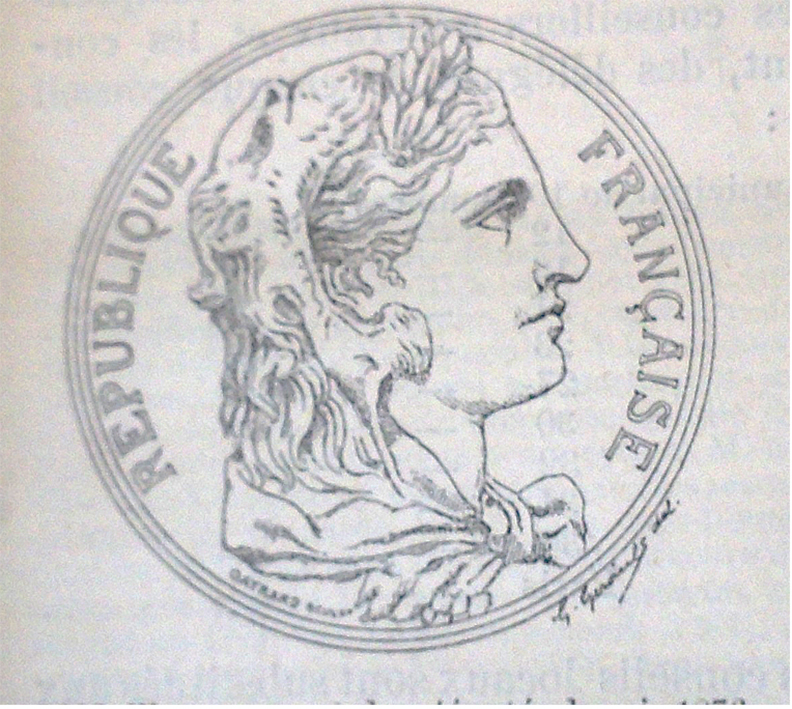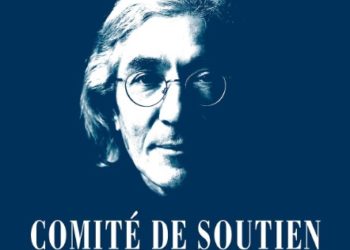A l’occasion des 150 ans de la proclamation de la République, l’Observatoire de la vie politique et parlementaire et le Comité Carnot, avec la participation de l’Observatoire des institutions, administrations et collectivités, ont rédigé un « cahier républicain ». La Revue Politique et Parlementaire a décidé d’en publier les contributions. Aujourd’hui « L’Europe est-elle républicaine ? » par Danièle Lamarque.
L’espace européen constitue depuis longtemps un lieu privilégié de circulation des idées républicaines : échanges entre intellectuels, influence de la Révolution française, Printemps des peuples des années 1848, construction de l’Union européenne… Cette acculturation a connu -et connaît encore- des avancées et des reculs et ne se confond pas avec la conception française de la République. Qu’en est-il de l’idée républicaine dans l’Union européenne d’aujourd’hui ? Comment s’incarne-t-elle dans les normes et les pratiques ?
La construction européenne n’a pas fondé une Europe des républiques : sur les 27 États membres, 19 sont des républiques ; 5 sont des monarchies constitutionnelles, le Luxembourg est un Grand-Duché.
Pas d’unité de régime donc, ni de constitution commune : le projet de constitution européenne s’est fracassé en 2005 sur l’attachement aux souverainetés nationales. On peut même noter que pour beaucoup de pays, et notamment ceux qui se sont détachés de l’empire soviétique, l’adhésion à l’Union s’est traduite par une affirmation nationaliste renforcée.
C’est bien pourtant sur la base de principes très proches de l’idéologie républicaine que se fonde l’état de droit de l’Union. Cet ensemble de normes inscrit dans plus de 80 000 pages de Traités, actes, accords et résolutions constitue l’acquis communautaire qui engage l’Union et ses Etats membres. Plus précisément, la Charte des droits fondamentaux incorporée au Traité en 2007 par le Traité de Lisbonne énonce des droits attachés aux valeurs de dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice. Dans une sorte de synthèse de nos textes de 1789 et 1946, elle proclame des droits civils et politiques (liberté d’expression ou de réunion) mais aussi des droits économiques et sociaux (droit à l’éducation, droit de travailler, droits des enfants, des personnes âgées et des handicapés) ; elle affirme aussi des principes que l’on pourrait qualifier de « nécessaires à notre temps » relatifs à la bioéthique, à l’égalité hommes-femmes, à la protection des données personnelles ou à l’environnement.
Au terme d’une évolution engagée dès les années 1970 en liaison avec la Cour européenne des droits de l’homme, la Charte formule ainsi un droit européen des droits de l’homme dont il est possible de se prévaloir, sous la garantie de la Cour de justice de l’Union.
Si un régime républicain offre un cadre approprié pour la protection des droits et des libertés publiques et l’exercice de la démocratie, les principes républicains peuvent donc aussi s’incarner dans d’autres régimes : on peut aller jusqu’à dire, comme Jean-Jacques Rousseau, que « tout gouvernement légitime est républicain ». L’idée républicaine, telle que l’a analysée Claude Nicolet, transcende la forme des gouvernements et des institutions. On peut donc être républicain sans vivre en république ; ou l’inverse. L’Europe, dans sa construction et dans sa forme actuelle, illustre bien les deux faces du paradoxe.
L’affirmation de principes et de droits, même assortis de sanctions, ne suffit pas en effet à inscrire dans les pratiques les valeurs reconnues comme républicaines. La Charte européenne des droits fondamentaux ne s’impose aux États membres que pour autant que leurs actes entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. A cette limite s’ajoute la difficulté de la Commission à garantir le
respect de l’état de droit, dans la mise en œuvre de ses politiques, et à mettre en œuvre l’article 7 du Traité qui sanctionne sa violation : malgré les pressions de nombreux pays, dont la France, elle peine à installer un régime de sanction lorsqu’un État membre, – fût-il une république -, viole ces principes ; la conclusion du plan de relance européen a montré combien il reste difficile de conditionner les aides financières au respect de l’état de droit.
Les dérives hongroise et polonaise sont inquiétantes en cela qu’elles s’inscrivent dans une contestation plus radicale de l’état de droit européen : la notion de « démocratie illibérale » revendiquée par Viktor Orban instaure le nationalisme comme première source de légitimité politique. Ces deux pays ne sont pas les seuls exemples de contestation des fondements de la démocratie libérale, au nom de l’affirmation nationale, de la revendication identitaire ou, à l’inverse, de la primauté de l’individu.
La république ne peut donc véritablement se perpétuer que si l’état de droit qu’elle instaure s’assortit d’une morale républicaine.
Malgré ses faiblesses, la revendication européenne en faveur du respect de l’acquis communautaire et des droits fondamentaux de l’Union est un message fort à l’adresse tant de ses membres, que de ses partenaires. De nombreux exemples en Europe montrent aussi à quel point la vitalité du modèle républicain au plan national repose sur un équilibre, toujours fragile, entre Etat, nation et démocratie. C’est la force du modèle français de tendre à réussir cet assemblage, et son défi de continuer à le faire dans un monde en proie au relativisme, aux croyances et au doute.
Danièle Lamarque
Présidente du Comité Carnot
Présidente de la Société européenne d’évaluation