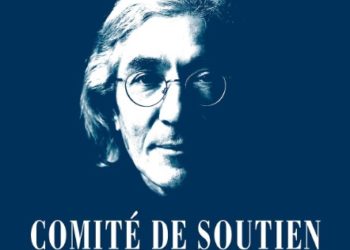Le bicentenaire de la mort de Napoléon constitue un événement mémoriel qui interpelle le politique. La mémoire de l’Empereur est aujourd’hui, comme elle le fut par le passé, l’objet de débats. Que reste t-il de son legs ? Quels en sont les enseignements ? Qu’est-ce que cette histoire nous révèle de nos fractures présentes et passées ? Comment les politiques s’approprient ou non cette dernière ? Il nous a semblé utile de les interroger. D’aucuns n’ont pas souhaité répondre, d’autres se sont prêtés à l’exercice. Ce sont leurs contributions que nous livrons à nos lectrices et à nos lecteurs. Un numéro à venir comportant les analyses de quelques-uns des meilleurs spécialistes du sujet sera par ailleurs publié prochainement.
Revue Politique et Parlementaire – Lorsque vous pensez à Napoléon, quels aspects positifs et négatifs vous viennent à l’esprit ?
Sandrine Rousseau – Je n’ai pas le même enthousiasme que beaucoup sur Napoléon. Sa volonté de conquête, la manière dont est écrit le Code civil sur la place des femmes, la nature, et même pour ce que d’autres voient très positivement, comme son héritage sur l’administration française, je serais plus nuancée. Nous héritons d’un État extrêmement centralisé, très contrôlé par des grands corps. Cet État est certes très stable et organisé, mais il manque d’agilité, d’innovation et d’humanité face aux crises. Il pose également des enjeux démocratiques forts et de justice sociale.
RPP – Comment définiriez-vous le bilan de l’action de Napoléon pour les peuples européens ?
Sandrine Rousseau – La conquête de l’Europe s’est faite dans le sang. En France, il fait partie de ces quelques figures titulaires exaltées, uniquement masculines rappelons-le, qui laissent peu de place à la nuance.
Critiquer Napoléon, c’est risquer de se mettre au ban de la patrie…
Le premier bilan qui me vient en tête, c’est bien sûr le bilan humain de l’impérialisme militaire : entre 2,5 millions et 3,5 millions de pertes militaires, et entre 750 000 et 3 millions de pertes civiles. Rien ne peut justifier une telle barbarie.
RPP – Quels furent, selon vous, ses principales qualités et/ou défauts personnels ?
Sandrine Rousseau – S’interroger sur sa personnalité c’est renvoyer à une sorte d’affect politique qui est assez contradictoire avec ce qu’il a voulu laisser comme trace dans l’histoire : celle d’un personnage stratège, dénué d’empathie et précisément d’affect.
RPP – Quelles ont été les mesures prises par Napoléon pour l’Etat, la société française et les arts les plus notables pour vous ?
Sandrine Rousseau – Je mentionnais cette emprise des grands corps d’Etat sur notre pays. Bien sûr, j’y ajoute le Code civil. C’est une avancée pour le droit, car l’adoption de règles communes évite le recours à l’arbitraire, et ancre l’égalité des citoyens, hommes, devant la loi. En revanche, avec le Code civil, la domination du père et de l’époux est restaurée au sein de la famille. Le fameux article 324 qualifie « d’excusable » le meurtre commis par un mari sur son épouse en cas d’adultère. C’est un tournant réactionnaire pour les femmes. Pour ce qui concerne la nature, le Code civil constitue aussi un tournant. Les animaux y sont qualifiés de « meubles par destination ». C’est la consécration de la propriété privée de la nature. Historiquement cela marque la possibilité d’exploitation de celle-ci comme un quelconque bien marchand.
RPP – Estimez-vous que Napoléon a été le continuateur ou le liquidateur des idéaux et acquis de la Révolution française ?
Sandrine Rousseau – N’étant pas historienne, je me garde de me prononcer sur ce genre de débat. Le Code civil est cependant un bon exemple de nuance : il s’inscrit dans l’effort engagé pendant la Révolution pour unifier le droit français et abolir les privilèges, mais il est également empreint d’un fort conservatisme social. Par ailleurs, l’abrogation de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises est une faute indélébile tout comme l’assimilation à marche forcée des Juifs.
RPP – Quels personnages historiques ou personnalités politiques actuelles sont pour vous dans sa filiation, celle du bonapartisme ?
Sandrine Rousseau – Je vais rester dans les personnalités actuelles car il faut éviter que ces filiations engendrent le même bilan. Il me vient très rapidement à l’esprit Vladimir Poutine. Cette soif de pouvoir, de contrôle et de retrouver une grandeur de l’empire russe en annexant des parties de l’Europe comme cela a été fait avec la Crimée.
Et j’ajouterai Emmanuel Macron en France. Il est bien loin de la belligérance de Napoléon ou Poutine, mais cette façon de gouverner violente, sans écouter la base de la population, seul, ce trait jupitérien, me fait penser à cet héritage.
RPP – Vous-même, vous retrouvez-vous ou non dans la tradition politique bonapartiste ? Si oui en quoi ?
Sandrine Rousseau – Ma philosophie politique ne trouve pas beaucoup sa source dans la tradition politique bonapartiste au contraire, elle a même quelque chose du contre modèle.
RPP – Estimez-vous que la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon soit plutôt une bonne ou une mauvaise chose ? Pourquoi ?
Sandrine Rousseau – Je me permets de reprendre la phrase de Churchill : « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Commémorer n’est pas aduler. Nous commémorons la Révolution française et les deux guerres mondiales avec nuance, finesse, en mettant aussi la lumière sur les parts d’ombre de notre Histoire. J’aimerais qu’il en soit de même pour tous les événements qui ont traversé notre longue histoire, plutôt que d’en instrumentaliser certains dans un récit national loin de la vérité historique.
RPP – Concernant cette commémoration, pensez-vous que les autorités françaises en font trop, pas assez ou comme il faut ?
Sandrine Rousseau – La crise sanitaire vient nécessairement percuter un certain nombre d’actions prévues. Encore une fois ça n’est pas tant l’intensité de la commémoration que son angle « éditorial » qui m’inquiète. Choisir de commémorer davantage tel événement plutôt que tel autre dans la vie d’un personnage historique dit aussi quelque chose de notre conscience collective et des choix du pouvoir en place.
RPP – Selon vous, l’empreinte de Napoléon sur la France est-elle durable ou éphémère ?
Sandrine Rousseau – Son empreinte reste durable à travers le Code civil et l’organisation étatique française. Les deux sont extrêmement difficiles à réformer, et restent parfois insensibles aux aspirations démocratiques.
RPP – Si des activistes déboulonnaient des statues de Napoléon, les comprendriez-vous ou les condamneriez-vous ?
Sandrine Rousseau – Cette question s’est déjà posée en 1871, il y a 150 ans. La Commune de Paris avait alors choisi de démolir la colonne Vendôme, à la gloire de la Grande Armée et de Napoléon : « La Commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète : Article unique – La colonne Vendôme sera démolie. »
Je comprends les débats actuels, parce que les commémorations et les hommages ne sont jamais neutres.
Qu’il puisse y avoir une avenue Bugeaud à Paris n’est pas anodin sur notre manière de regarder en face notre passé colonial par exemple. Et il n’est pas possible de balayer ces débats d’un revers de la main : ils sont éminemment politiques, et doivent être tranchés démocratiquement. Au-delà des statues, c’est la plaque explicative qui y est accolée qui est importante et souvent ces plaques manquent de nuances.
Sandrine Rousseau
Candidate à la primaire écologistes pour la présidentielle 2022
Propos recueillis par Arnaud Benedetti