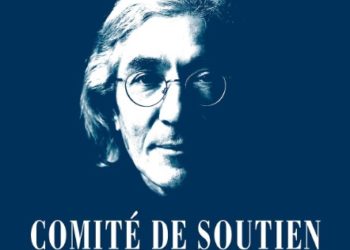Alors que le confinement a été décrété il y a un mois, Matthieu Creson, enseignant chercheur, s’interroge sur son efficacité. Il dénonce par ailleurs, à l’instar de Didier Raoult, l’intrusion grandissante du politique dans la pratique de la médecine.
Partout depuis un mois, nous entendons que la seule solution à la crise sanitaire actuelle réside dans le respect du confinement général. Pas un jour ne se passe sans que nos médecins, politiques, journalistes, vedettes télévisées et artistes de variétés nous rappellent continuellement dans les médias ou sur les réseaux sociaux le même mot d’ordre : « restez chez vous ! » À l’interdiction prononcée par le gouvernement de quitter son domicile (hormis pour faire ses courses, travailler ou s’aérer) s’ajoute la stigmatisation sociale du « contrevenant » (le jogger interdit de courir dans Paris et sa région entre 10h et 19h, le promeneur pointé du doigt s’il ose sortir pour profiter du beau temps, etc.) – stigmatisation d’ailleurs peut-être plus efficace que la sanction elle-même : au nom du bien collectif et de la « solidarité », on somme les individus de dépasser leur « petit égoïsme primaire » en restant soigneusement calfeutrés chez eux. Et lorsque le directeur général de la santé Jérôme Salomon déclare qu’« une vie est sauvée toutes les huit minutes en restant chez soi », comment le supposé « Gaulois réfractaire » pourrait-il persister dans sa propension à contester les ordres intimés par le pouvoir en place, lesquels sont en fait aujourd’hui largement intériorisés par une majorité de la population ?
On le voit, derrière ces messages se cache une vieille tendance propre à l’ensemble de notre classe politique : celle qui consiste à ne voir dans les individus que les membres interdépendants du corps social, dont la cohésion « solidaire » est exaltée en tant que valeur suprême.
Or l’appel à l’unité nationale ne doit pas pour autant conduire les citoyens à s’abstenir de juger par eux-mêmes la politique gouvernementale mise en œuvre pour tenter de résorber la crise sanitaire.
C’est donc déjà l’hypothèse même du bien-fondé et de l’efficacité des politiques de confinement massif, politiques appliquées par des pays comme l’Italie, la France et l’Espagne, qui mérite d’être discutée en premier lieu, notamment à l’aune des résultats enregistrés par d’autres pays qui n’ont pas appliqué la même stratégie.
L’efficacité du confinement : dogme ou réalité ?
Ce que l’on nous a présenté au départ comme la seule solution possible à la crise sanitaire – le confinement strict – a finalement fait l’objet d’un sérieux doute : n’avions-nous pas opté pour le confinement, non pas parce que nous étions convaincus qu’il s’agissait de la meilleure stratégie, mais parce que nous nous sommes rendus compte que c’était prétendument la seule, vu la pénurie criante de matériel réputé nécessaire à l’endiguement de cette crise – tests, masques, gel hydroalcoolique, surblouses, respirateurs artificiels, etc. ? En effet, à mesure que l’on comprenait mieux comment d’autres pays, notamment les Tigres asiatiques, s’y étaient pris pour lutter contre l’épidémie – grâce notamment à l’application massive d’une politique de dépistage des sujets porteurs du virus -, l’idée qu’il existât une stratégie autre que le confinement strict commença à faire son chemin. D’autant que cette stratégie, contrairement à la nôtre, n’a pas eu pour conséquence l’arrêt brutal de l’activité économique, la mise au chômage d’une large part de la population, ni la privation de la liberté de circuler. Nous savons aujourd’hui que des pays comme la Corée du Sud ont tiré les leçons des crises sanitaires qui les avaient durement touchés par le passé, comme le SRAS en 2003 ou H1N1 en 2009/2010. Espérons donc que cette période de confinement imposé, si dramatiques qu’en soient déjà les conséquences subies (économiques, sociales et même sanitaires comme on l’a souligné à juste titre ces derniers jours), nous servira aussi d’expérience pour ne plus avoir à l’avenir à décréter des mesures aussi lourdes de conséquences.
L’un des premiers en France à avoir exprimé son scepticisme sur les chances de réussite du confinement est Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée de Marseille, épidémiologiste de renommée internationale, et désormais bien connu du grand public pour sa prise de position en faveur de l’efficacité thérapeutique de la chloroquine contre le Covid-19. Il rappelle ainsi qu’un bon exemple de l’échec du confinement indifférencié nous est fourni par le cas du « Celebrity Diamond », paquebot transportant quelque 3 700 passagers, et maintenu en confinement par les autorités japonaises dans le port de Yokohama après qu’un cas de Covid-19 fut détecté à bord. Résultat de l’opération : ce sont finalement 619 passagers contaminés qui ont été comptabilisés lorsque la quarantaine fut levée, le 19 février. Joacim Rocklöv, épidémiologiste à l’université d’Uméå, considère que si l’on avait appliqué la stratégie du dépistage et si l’on avait isolé les seules personnes testées positives, ce sont 70 personnes seulement qui auraient été contaminées (contre 619, donc, à l’issue du confinement)
Les effets contreproductifs du confinement aveugle
D’autres voix quelque peu discordantes, issues ou non du corps médical, se sont elles aussi fait entendre dernièrement pour mettre en question non pas seulement l’efficacité du confinement, mais ses dérives contreproductives. C’est notamment le cas de Michaël Peyromaure, chef du service d’urologie de l’hôpital à Paris, pour qui le confinement a pu se justifier, mais seulement au début. Mettant en avant les conséquences négatives y compris sanitaires que le maintien de la politique de confinement fait courir aux patients atteints d’autres maladies graves que le Covid-19, il considère que le gouvernement devrait aujourd’hui s’attacher à lever progressivement le confinement, non à le maintenir encore trois semaines, comme cela vient d’être annoncé. À l’instar de ce qui se passe actuellement en Autriche et en Allemagne, nous aurions dû décider dès à présent un déconfinement intelligent, fondé sur la protection, c’est-à-dire la mise à l’abri des personnes les plus vulnérables – personnes âgées, en surpoids ou atteintes de maladies chroniques -, celles-là mêmes qui sont donc les plus susceptibles de développer des formes graves en cas de contamination.
L’avocat Alain Jakubowicz va dans le même sens, soulignant sur la chaîne d’information CNews l’ampleur des méfaits du confinement : cancers non diagnostiqués, opérations chirurgicales reportées… Le confinement, poursuit-il, risque donc lui aussi de faire des milliers victimes. Or rappelons que ces victimes-là, nous ne les voyons pas, puisque par définition elles ne sont pas comptabilisées chaque soir comme le sont depuis maintenant plus d’un mois celles du Covid-19.
À force d’avoir polarisé notre attention sur le seul Coronavirus, nous risquons donc de desservir le droit des autres patients à être soignés, notamment ceux d’entre eux qui souffrent de maladies graves.
À cet égard, il convient de rappeler le signal d’alarme qu’a tiré Pierre Amarenco, chef du service de neurologie de l’hôpital Bichat à Paris, concernant la réalité que cache l’apparente chute libre des cas d’AVC actuellement constatés : nombre de personnes qui auront été victimes d’un AVC durant le confinement n’auront en fait pas osé appeler le SAMU de peur de croiser des personnes atteintes du Covid-19 à l’hôpital. (Alors même que l’hôpital a conçu un parcours spécifique pour éviter aux personnes non infectées de rencontrer des malades du Covid-19.) C’est là, pourrions-nous dire, l’un des effets pervers de l’hypermédiatisation de l’épidémie : de la peur panique que cette hypermédiatisation à contribué à implanter et à diffuser au sein de la population naissent ainsi des comportements défiant parfois la rationalité et le bon sens les plus élémentaires. De sérieux risques de séquelles sont donc à craindre pour les personnes atteintes d’AVC qui auront préféré ne pas se manifester auprès des services de santé, chose qu’elles auraient fait en temps normal. Rappelons en outre que 150 000 personnes sont victimes chaque année d’un AVC en France, dont 30 000 décèdent. A-t-on donc bien mesuré cette conséquence du confinement, à savoir, comme le dit fort justement Pierre Amarenco, le risque d’une surmortalité à domicile chez des personnes ayant été victimes d’un AVC ? La même hésitation à appeler en ce moment le SAMU semble également se vérifier pour les personnes qui ont fait un infarctus du myocarde, dont le nombre de cas recensés est lui aussi anormalement bas. D’après l’Inserm, 80 000 personnes sont concernées chaque année en France par l’infarctus du myocarde, dont 12 000 décèdent. Faudra-t-il alors faire un jour, à l’instar de la comptabilité journalière des décès du Covid-19, le sinistre bilan de cette surmortalité potentiellement imputable au confinement, à l’emballement médiatique généralisé et à cette civilisation de l’ultra-communication que nous avons nous-mêmes bâtie, lesquels ont joué un rôle majeur dans la cristallisation d’une psychose collective.
Didier Raoult, critique de l’intrusion grantissante de l’Etat dans la pratique de la médecine
Constatant l’efficacité de la stratégie adoptée dans des pays comme la Corée du Sud, et partant d’études chinoises ayant montré l’efficacité de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, Didier Raoult a donc mis en place à l’IHU Méditerranée une stratégie qui peut être considérée comme l’exacte antithèse de celle prônée par le Conseil scientifique et appliquée par le gouvernement : en effet, plutôt que d’opter pour un confinement aveugle, qui risque de se révéler non seulement peu efficace mais même contre-productif, Didier Raoult poursuit une stratégie qui tient, comme il l’a souligné, en trois mots : dépistage, diagnostic, traitement. Les sérieux doutes que l’on peut avoir sur l’opportunité d’une politique de confinement global reposent d’ailleurs sur le constat de l’inefficacité des quarantaines aveugles pour venir à bout d’épidémies passées, comme celle du choléra dans les années 1830, qui causa la mort de 100 000 personnes en France. (On prendra le soin de bien distinguer les quarantaines aveugles des quarantaines biologiques, auxquelles Didier Raoult est favorable, et qui sont fondées quant à elles sur la distinction entre les personnes contaminées et celles qui ne le sont pas, et sur l’isolement des seuls malades.) L’épidémiologiste du XXIe siècle, ajoute Didier Raoult, ne doit pas appliquer des méthodes mises en œuvre il y a deux siècles, voire au Moyen Âge : il doit au contraire pratiquer une médecine résolument moderne, fondée en l’espèce sur le dépistage systématique des cas de contamination, leur mise à l’écart, et l’administration d’un traitement efficace.
Il sera essentiel de pouvoir comparer un jour les résultats obtenus à l’IHU Méditerranée avec ceux enregistrés ailleurs en France. On peut penser néanmoins que si les bons résultats se confirment à Marseille, les détracteurs de Didier Raoult n’y verront probablement pas pour autant la preuve de l’efficacité du traitement qu’il préconise. Reste qu’il faudra pouvoir faire la lumière rétrospectivement sur la question de savoir si nous aurions dû permettre aux médecins de ville, sur l’ensemble du territoire national, de prescrire l’hydroxychloroquine à leurs patients diagnostiqués, plutôt que de réserver ce traitement aux cas graves qui arrivent en réanimation, et pour qui il est déjà trop tard, comme Didier Raoult et d’autres l’ont rappelé ces derniers temps.
Je ne m’étendrai pas ici sur la question de savoir si tous les patients diagnostiqués de Covid-19 (mis à part ceux qui peuvent présenter des problèmes cardiaques, pour lesquels le médecin pourra choisir de ne pas prendre de risques) doivent oui ou non se voir prescrire le traitement en question : en effet, vu que 98% environ de la population infectée semble guérir spontanément quelques jours après l’apparition des premiers symptômes, on peut légitimement s’interroger sur l’opportunité de la généralisation du traitement à l’ensemble des cas diagnostiqués. Ajoutons simplement – le propos mériterait en fait un développement tout entier – que le patient, préalablement informé, devrait pouvoir choisir de prendre ou de ne pas prendre le traitement que lui propose son médecin, ce qui supposerait donc que le médecin soit déjà en mesure de prescrire librement ce même traitement. Or comme le précise un décret paru au Journal officiel le 27 mars dernier, il ne sera possible aux pharmaciens de délivrer du Plaquenil – nom sous lequel l’hydroxychloroquine est commercialisée – que dans le cadre « d’une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie» ou «d’un renouvellement de prescription émanant de tout médecin».
À ce titre, Didier Raoult souligne à fort juste titre les méfaits de l’intrusion étatiste dans le rapport patient-médecin, ainsi que la confusion des genres entre le politique et le médical. Ainsi déclare-t-il dans Le Figaro Magazine du 3 avril : « Je ne suis pas d’accord avec l’interférence de l’État dans la relation entre le médecin et le malade. C’est la responsabilité individuelle des médecins. C’est le serment d’Hippocrate. […] Il faut donc que l’exécutif se garde de faire de la médecine à notre place. »
Le rôle de tout un chacun : revenir à la rationalité individuelle pour mieux gérer les crises sanitaires du futur
Dans un article paru dans Le Point du 19 mars dernier, intitulé « Le fantôme de l’ordre retrouvé surgit », le philosophe Peter Sloterdijk dénonce les méfaits d’une « sécurocratie » dissimulée sous le masque d’une « médicrocratie », laquelle parviendrait d’autant plus facilement à exercer son pouvoir qu’elle œuvre au nom du « bien ». Le philosophe André Comte-Sponville alertait quant à lui, dans un entretien accordé au Parisien du 1er septembre 2016, sur le danger que représenterait une possible surmédicalisation de la société. En tout état de cause, il paraît souhaitable et même tout à fait nécessaire que les professionnels de la médecine s’attachent à résoudre une crise sanitaire comme celle que nous traversons, de manière qu’il y ait le moins de morts possibles.
D’après le discours politico-médiatique ambiant, il semblerait que nous soyons confronté à une alternative : choisir entre la santé et l’économie.
Or, les stratégies mises en œuvre notamment par les Tigres asiatiques, ainsi que l’approche du traitement de la maladie défendue et pratiquée par Didier Raoult nous montrent que ce dilemme apparent est en réalité un faux problème. Prenons donc garde de ne pas avaler les couleuvres que nous tendent nos professionnels de la politique, toujours désireux de se mêler de ce qui ne les regarde pas et d’usurper quand ils le peuvent la place et le rôle des acteurs de la société civile.
Il faut donc déjà revenir au principe de base selon lequel il faut laisser les médecins et uniquement eux pratiquer la médecine.
Ce n’est pas à un gouvernement, fût-il appuyé dans ses choix de politique sanitaire par un « Conseil scientifique », de dire aux médecins ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire.
Il faut ensuite laisser les médecins gérer les crises sanitaires en leur donnant la possibilité de prescrire le médicament dont ils savent l’efficacité sur la pathologie qu’ils traitent. Comme l’a déclaré tout dernièrement Didier Raoult dans le bulletin d’information scientifique de l’IHU Méditerranée sur YouTube : « Il est bien de faire face aux crises sanitaires. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup par coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu’il y ait plus de morts qu’ailleurs. »
Il importe de rappeler que c’est aussi à tout un chacun d’adopter le comportement adéquat en cas de crise sanitaire comme celle qui sévit. Or sommes-nous bien sûrs de contribuer à la bonne gestion d’une crise sanitaire lorsque nous attisons en permanence la phobie collective de la maladie ? Comme le souligne Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en psychologie sociale et spécialiste des maladies infectieuses, dans un entretien paru le 13 mars dans Libération, la place aujourd’hui accordée dans nos sociétés aux réseaux sociaux a largement contribué à créer un climat anxiogène. « Le niveau d’inquiétude qui est observé aujourd’hui à l’ère du numérique », ajoute Jocelyn Raude dans le même entretien, est très supérieur à celui qui était observé dans d’autres crises comparables. »
Il conviendra donc certainement de faire notre propre introspection collective et de voir en quoi nous avons pu éventuellement nous comporter, durant cette crise, moins sous l’effet de la rationalité individuelle, que sous celui de la peur de groupe, sentiment exacerbé à coup sûr par notre culture de l’hypercommunication permanente – qu’il faut distinguer de la véritable information, essentielle en démocratie. En leur temps, Démocrite et Épicure avaient prôné une conception scientifique et rationnelle du monde naturel, cherchant à extirper les représentations infondées, sources de peurs et d’angoisses. La science, l’éducation et l’information ont contribué et contribuent toujours à élever et à libérer l’être humain en l’amenant à être plus rationnel dans ses décisions, ses actions et ses comportements. L’une des leçons que nous pourrions aussi tirer de la gestion de la crise du Covid-19 est qu’il est temps pour nous de redevenir pleinement des individus, et non de rester aux yeux de nos politiques d’impersonnels atomes sociaux. Et à l’heure où ces mêmes politiques multiplient les appels à la « cohésion » et à l’ « unité » nationales, sachons revenir au propos du philosophe Alain, selon lequel « la fonction de penser ne se délègue point ».
Matthieu Creson
Enseignant, chercheur (en histoire de l’art), diplômé en lettres, en philosophie et en commerce