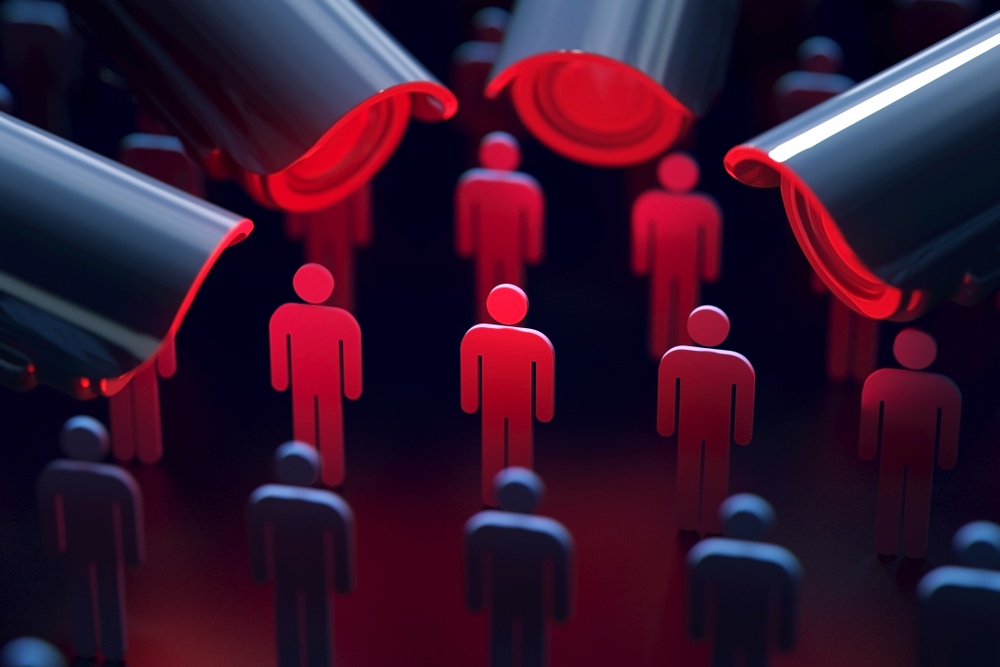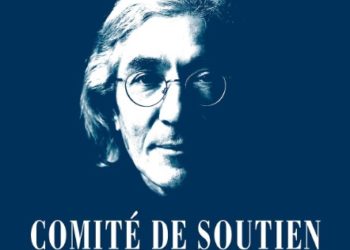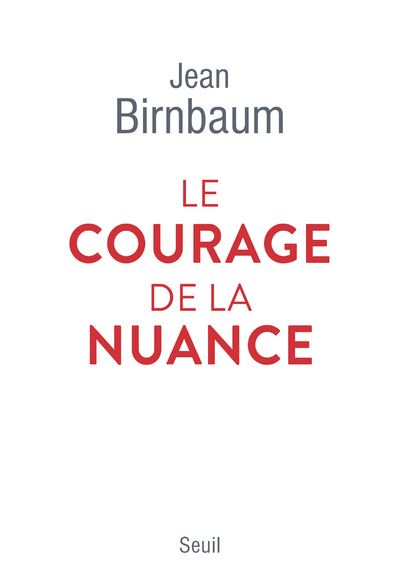Trop souvent encore, pour beaucoup, « l’opinion publique », ce sont seulement les sondages. Or, chaque jour, des millions de personnes s’expriment librement sur Facebook, Twitter, LinkedIn, sinon sur Instragram ou désormais Tik Tok. Il faut en prendre acte et caractériser ce nouvel âge de l’opinion, qui lui redonne un rôle très actif, pour le meilleur et pour le pire.
Cette parole numérique, qui date maintenant d’une quasi quinzaine d’années, a mauvaise réputation. On la critique avec virulence, tant ces nouvelles expressions sont réputées dangereuses, ignorantes ou violentes. L’opinion publique, il faudrait seulement la mesurer en l’évaluant par une méthodologie des sciences sociales reposant sur des lois statistiques et un questionnaire en bonne et due forme. Au fond, l’opinion c’est un chiffre, sollicité sinon construit par des experts. Or ce sens très passif de l’opinion publique est presque l’inverse du sens originel du mot, qui est d’être une expression publique volontaire, par les moyens techniques de communication d’une époque. Sens originel qui redevient premier avec la révolution numérique, puisque l’expression est désormais à la disposition de chacun, sans intermédiaire, par les plateformes de réseaux sociaux.
Cette révolution dans l’opinion – la révolution, au sens astronomique, est un retour au point de départ – transforme encore une fois nos démocraties représentatives en profondeur. Pour être précis, la démocratie de l’expression change la fonction de l’opinion publique, en lui redonnant un pouvoir très actif.
On situe classiquement sa naissance à la fin du XVIIIe siècle, pour prendre toute son importance lors de la Révolution française. Salons, clubs, loges, brochures, libelles et caricatures qui circulent, ces lieux et la presse naissante deviennent des espaces où s’expriment de plus en plus publiquement des opinions sur la chose commune, c’est-à-dire publique.
Retenons que cet acteur décisif du renversement d’une monarchie multiséculaire ne représente pas le peuple et la diversité de ses opinions. Il est essentiellement parisien, émane de milieux restreints, parfois de la Cour elle-même avant la Révolution, le plus souvent de milieux bourgeois ensuite.
Ce qui fait sa force est la puissance mobilisatrice de son expression, sa capacité de circulation dans Paris – on dirait, aujourd’hui, sa « viralité ». L’opinion publique est en fait l’œuvre de minorités très actives. De l’esprit des Lumières au « sans-culottisme », se diffusent des « informations » et des idées – et surtout beaucoup de rumeurs, de complots, de légendes urbaines. La désinformation, qu’on appelle aujourd’hui fake news, à la suite de Donald Trump (ce sera peut-être son principal héritage), est loin d’en être absente, et la haine encore moins.
La « démocratie du public », ou la république des sondages
Cet air de famille entre la naissance turbulente, polémique, violente de l’opinion publique et le maelstrom d’opinions que produit l’ère numérique est en fait assez frappant, sinon déroutant. Il y a pourtant trois étapes, qu’il faut retracer, pour comprendre ce retour aux origines, par l’entremise d’une révolution technologique.
Premier âge de l’opinion, celui d’abord où la presse se structure peu à peu, et fera progressivement l’objet de législations : l’opinion publique signifie alors celle exprimée dans les journaux, par ceux qui ont la possibilité de s’y écrire, mais aussi celle de la rue et des associations qui s’y mobilisent : c’est la première moitié du XIXe siècle et son parlementarisme de notables, élus avec un suffrage restreint, selon la classification de B. Manin dans Principes du gouvernement représentatif. Le suffrage universel et les partis politiques, dits de masse, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, canaliseront bientôt les opinions des masses électorales : les journaux deviennent eux-mêmes une presse d’opinion souvent liée à ces partis – c’est la « démocratie de partis » dit B. Manin. Avant que « la démocratie du public » advienne, celle où l’audiovisuel – radio et actualités cinématographiques avant la Deuxième Guerre mondiale, puis peu à peu la télévision – transforme la production et la circulation de l’information comme des opinions, en même temps d’ailleurs que l’exercice du pouvoir.
Le développement des sondages d’opinion accompagne de près cette montée en puissance de l’audiovisuel tout au long du XXe siècle.
C’est après la Libération que s’installe vraiment en France cette technique de recueil des opinions fondées sur les lois de la statistique, venue des États-Unis, en particulier de l’institut Gallup. L’Ifop l’a tout juste expérimentée dans les années d’avant-guerre – on se souvient qu’un des tout premiers sondages publiés dans notre pays concerna les accords de Munich, en 1938, que l’opinion approuvait à 57 % contre 37 % (l’esprit munichois, s’il était majoritaire dans le pays, n’était peut-être pas aussi dominant que cela…).
Reste que l’institutionnalisation des sondages en France est concomitante de l’augmentation des postes de TV dans les foyers, et de la personnalisation de la vie politique qu’elle induit, de l’élection présidentielle au suffrage universel direct (1965), qui a le même effet et va familiariser les citoyens avec les intentions de vote, de l’installation du présidentialisme qui en découle, avec les cotes de popularité mensuelles des deux têtes de l’Exécutif, puis celles des principales personnalités politiques pendant que des sondages sont publiés par les médias sur les grandes questions politiques du moment. Les instituts français de sondage naissent dans les années 60 et 70, Sofres après le vieil Ifop, puis BVA, Ipsos, CSA, etc. Soulignons que l’État n’est pas en reste pour son propre compte, quand il crée, en 1974 auprès du Premier ministre, une structure appelée d’abord SID (Service d’Information et de Diffusion), puis SIG (Service d’Information du Gouvernement), qui réalise chaque semaine et confidentiellement un sondage d’opinion, sinon plusieurs en fonction de l’actualité.
Le triangle systémique
Cette « démocratie du public » est structurée en France par un triangle magique : un système politique régi par la personnalisation et le fait majoritaire (Président et principaux opposants, issus de l’élection présidentielle), un système médiatique qui peu à peu se détache de l’emprise gouvernementale, le nombre de chaînes de télévision et de radios se multipliant ; enfin les sondages, commandés par les médias, exprimant entre deux élections présidentielles, législatives ou intermédiaires, la voix de l’opinion, c’est-à-dire des gouvernés. Les gouvernants, les médias, l’opinion publique : ce triangle en forme de boucle systémique survit à l’expression numérique, advenue depuis, grâce à la magie persistante du chiffre sondagier, mais sa légitimité se réduit à vue d’œil.
Jusqu’à quel point est-elle encore « représentative », cette démocratie du public, quand les élus sont confrontés à la vox populi sondagière et finissent par s’y fier, pendant que la délibération publique se déroule de plus en plus sur les plateaux TV, plutôt qu’au Parlement ? Vox populi qui donne le « la » du commentaire médiatique, féroce ou flatteur selon qu’une personnalité baisse ou progresse dans les cotes de popularité ; qui fait pencher la balance et céder l’Exécutif en cas de conflit social (nombre dans la rue x taux de soutien sondagier = force d’un mouvement social) ; qui parfois limite la durée de vie d’un Premier ministre, devenu trop impopulaire ou au contraire trop populaire, au point de gêner le Président ; et bien sûr, avec les intentions de vote, locales ou nationales, qui amplifie la dynamique d’un candidat, ou bien au contraire, brise l’élan de sa campagne, voire met fin prématurément à sa candidature.
Le sondage est le grand régulateur du système, le juge de paix sur lequel, tôt ou tard, on finit par s’aligner.
Du reste, les soirs d’élection, on ne commente que l’écart des résultats aux sondages des jours précédents. Au risque parfois d’extrapolations dangereuses : en juin 2016 en Grande-Bretagne, l’écart sondagier entre les votes live et remain était faible la veille du scrutin, deux points, et il a suffi d’un peu de « vote caché », sous déclaré, en faveur du live, pour que le résultat s’inverse et que le Brexit l’emporte, à la stupeur d’observateurs qui avaient quelque peu confondu désirs et réalité… Il s’en faut de peu, parfois, pour que le sondage ne remplace l’élection, que le sondé ne vaille plus que le citoyen, que l’opinion publique soit jugée plus exacte que le vote, bien qu’elle soit mesurée par des instruments imparfaits (comme tout instrument), avec des marges d’erreur connues et quelques autres ajustements plus mystérieux nommés par exemple « redressements »…
Il y eut une dissonance dans ce concert démocratique autorégulé par voie de sondage : Pierre Bourdieu, avec un article retentissant, « L’opinion publique n’existe pas ». Au-delà de recommandations méthodologiques et d’interprétation précieuses, le sociologue incitait à se poser une sacrée bonne question : dans quelle mesure l’interrogation que l’on adresse aux sondés est bien une question qui se pose pour eux, et dans les bons termes ? Le sondage risque à tout moment l’imposition de problématique : les sondeurs et leurs clients imposent aux sondés de répondre à un problème politique – et à des questions qui le traduisent – qu’eux ne se posent pas toujours, et encore moins dans ces termes ; sur lequel ils n’ont pas d’informations ni d’avis, parce que ce problème demande une compétence politique, un niveau de connaissance et d’information, qui ne sont pas distribuées de façon égale, loin de là, au sein de la population interrogée sous forme d’échantillon représentatif. « Approuvez-vous le rôle du Conseil constitutionnel ? » L’enjeu politique est de vérifier si « l’opinion » légitime l’État de droit et la limitation opposée au pouvoir politique, par une jurisprudence constitutionnelle. Mais qui connaît le Conseil constitutionnel, son rôle de contrôle de la constitutionnalité des lois et ses modalités, les principes qui fondent sa jurisprudence ? Dans un tel cas, dit Bourdieu, vous obtiendrez une vague approbation de principe sans guère de réalité : votre sondage a produit un artéfact, un résultat artificiel, mais qui est là pour renforcer la légitimité du système.
Bien sûr, la critique est trop radicale. L’opinion sondagière existe tout de même parfois… Par exemple quand on demande aux sondés, à quelques jours du scrutin, leur intention de vote : chacun sait alors qu’il y a une élection et la plupart ont une bonne certitude du choix de leur candidat, même si l’hésitation progresse désormais à chaque scrutin, jusqu’au dernier moment. Ou bien quand pendant un mouvement social important, l’ensemble de la population finit par s’emparer d’un texte de loi, pour se forger son opinion. Il est prudent d’attendre parfois : un gouvernement, celui de M. de Villepin en 2006, sur la foi d’un sondage initial positif, mais serré, décida d’engager la réforme du CPE (Contrat Première Embauche). Après quelques semaines de mobilisation sociale et de discussion médiatique, cette réforme fut jugée très négativement par l’opinion – et le projet bien que voté tomba aux oubliettes. Le même processus avait été à l’œuvre lors de la campagne référendaire de 2005, à propos du Traité constitutionnel européen : vague approbation au début, à un moment où la problématique était imposée à une opinion peu mobilisée sur le sujet, et encore moins informée de sa portée ; puis inversion de l’opinion quand la campagne s’est vraiment engagée – contrairement à la légende, le jugement sur J. Chirac a peu pesé dans cette cristallisation négative. Car elle bouge l’opinion, elle est en fait un processus permanent, dépendant de la conversation nationale, elle-même alimentée par les événements médiatisés, par les expériences sociales vécues dans la vie de tous les jours, par la parole de ceux qui influencent, les « directeurs d’opinion » – parfois à leur insu et de manière négative, quand par exemple tous les éditorialistes penchent dans le même sens, comme une « pensée unique » transformée en bien-pensance – ce fut le cas lors du référendum sur le TCE.
La démocratie de l’expression permanente et généralisée
On a dit, à juste titre, que le référendum de 2005 avait été la première votation où les blogs et Internet avaient joué un rôle notable dans la mobilisation de l’opinion, en concurrence ou plutôt en opposition aux grands médias dominants, très – trop – largement acquis à la cause du « Oui » au TCE, comme d’ailleurs 80 % de la classe politique.
C’était les prémisses d’un changement d’époque – pas seulement dans le fonctionnement de notre démocratie.
Une rupture que l’on peut dater avec une relative précision en France : l’arrivée en 2007 du smartphone grand public suivi des plateformes de réseaux sociaux, avec des applications permises par l’Apple Store de l’Iphone. Au moment même où la TNT en France permettait le développement des chaînes d’info en continu. Ces années-là, dont le rappel paraît presque désuet, sont bien un moment de bascule, celui où la « démocratie du public », avec son triangle gouvernants/médias/sondages voit advenir une démocratie de l’expression permanente et visible par des réseaux sociaux accessibles à tous, et du commentaire permanent par les chaînes d’info, réseaux sociaux et chaînes d’info s’alimentant mutuellement. Démocratie où règne bientôt le direct live, et un nouveau rituel de l’information, l’info en continu, qui ne concerne pas seulement les chaînes du même nom : en témoigne la transformation de nos bons vieux quotidiens papier – dont on a rappelé le rôle originel dans la naissance de l’opinion publique – en applis d’info en continu, mêlant l’écrit à de plus en plus de vidéos. Car de la démocratie du public à la démocratie de l’expression, c’est toujours l’image-son qui domine, qui donne le « la » de l’info et des événements et qui alimente les commentaires, sur un plateau, ou bien les témoignages sur un réseau social. Triomphe définitif de la visibilité annoncée par Régis Debray et son concept médiologique de « Vidéosphère ».
Il en résulte une métamorphose de notre vie démocratique, dont on voudrait souligner quelques traits dans ce nouvel âge de l’opinion publique : la désintermédiation, la « post-vérité », enfin la naissance d’un nouveau « tribunal populaire ».
La désintermédiation
Nous voici donc dans un monde numérique où, par l’accès généralisé à l’expression visible – visible des autres donc publique – la parole du quidam peut peser autant que celle du professeur d’université, du journaliste, de l’expert en tout genre : il n’y a plus d’argument d’autorité, seule la rhétorique compte, celle qui permet de toucher, émouvoir ou convaincre, de dénoncer et s’indigner aussi… La visibilité, cette capacité à capter l’attention générale, n’est plus le monopole de ceux qui ont une « capacité », comme on disait au XIXe siècle de la classe dirigeante. Les corps intermédiaires sont ramenés à leurs intérêts particuliers : la présomption de sagesse et de sens de l’intérêt général ne leur bénéficie plus. Horreur et damnation ! clament-ils, déchus ou bousculés. L’engeance et le premier venu les contestent, quand ils ne les soupçonnent pas. D’ailleurs, le premier réflexe des démocratures (russe, turque, iranienne…), quand survient la contestation populaire, est de couper ou brouiller les réseaux sociaux. Ceux-ci ont désormais partie liée, qu’on le veuille ou non, avec la liberté d’expression des personnes, à laquelle nous nous prétendons si attachés.
Il est difficile de ne pas percevoir, derrière cette plainte, aussi récurrente que vaine en France contre cette technologie si puissante, le long sanglot des autorités dépossédées du monopole de la parole légitime.
La nostalgie d’un monde où mots et images appartenaient d’abord à ceux qui avaient tribune ouverte dans les journaux ou bien l’insigne honneur de trôner sur les rares plateaux TV. Parole autorisée, accréditée, distinguée, par un titre, un statut, une élection, qui seuls offraient le droit d’être écouté, vu et lu, pour mieux donner le « la » du consensus ou de la dispute acceptable. La « direction d’opinion », elle, existe toujours mais ses règles de fonctionnement ont changé – les « influenceurs » numériques, pour faire court, ont succédé aux éditorialistes et un éditorialiste doit devenir un influenceur, courant de Twitter aux plateaux de chaînes d’info. Telle instagrameuse aux centaines de milliers d’abonnés est en effet plus « prescriptrice » dans le domaine de la lecture que les bons vieux critiques littéraires des journaux. Ce n’est plus le « clergé » de l’Église médiatique qui impose les problématiques en tout genre à l’opinion, mais de plus en plus, ces opinions et expressions numériques qui influent et provoquent les réactions médiatiques.
L’invention de l’imprimerie avait facilité la diffusion de la Réforme protestante contre l’Église et son clergé, par l’accès direct à la Bible traduite en langue vernaculaire ; la radio et le cinéma, médias de masse, ont « produit », selon Walter Benjamin, le dictateur de l’ère des masses, en même temps que la « star ». Le smartphone, qui permet à chacun d’être vu et de s’exprimer partout, à tout instant, ne serait-il pas l’arme du « populisme » à l’ère de l’individu communautarisé ? Il le facilite parce qu’il y a eu rupture de consensus dans les démocraties libérales et que les nombreux perdants de notre système trouvent là le moyen de contester leurs défaites et de retrouver une fierté, eût-elle parfois un goût saumâtre. Souvenons-nous des Gilets jaunes, constitués en trois semaines avec des groupes Facebook, mais aussi de toutes ces soudaines révoltes populaires, avant l’épidémie, d’Algérie au Liban, qui ont fleuri grâce aux smartphones et aux réseaux sociaux.
La post-vérité
Seulement voilà, il y a un revers à la médaille… Sur lequel le dictionnaire d’Oxford a mis un nom et une définition, l’année du Brexit : « post-vérité : qui fait référence à des circonstances où les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion (nous soulignons) que l’appel aux émotions et aux vérités personnelles ». Les émotions et vérités personnelles pullulent dans l’expression numérique : c’est le royaume du « ressenti » et du témoignage, celui du « moi je sais » et du « moi j’ai vu ». Ce qui oblige à en revenir à la vieille distinction philosophique des opinions et du savoir. Dans le domaine scientifique en particulier – santé, écologie… Tel parent témoignera ainsi que tel vaccin a eu des effets secondaires sur son enfant – vidéo YouTube qui sera partagée sur Facebook. Ces témoignages, fabriqués parfois mais pas toujours, ont joué un rôle important dans la propagation – la viralité numérique – de la mouvance « antivax ».
Nous avons ainsi connu, l’automne dernier en France, notre première crise de la « post-verité », quand la deuxième vague de l’épidémie s’est annoncée et qu’elle a été déniée…
La réalité sanitaire s’est brouillée dans la confusion et la dérision des paroles et des images, des chiffres multiples et des « coups de gueule ». Nombre d’épidémiologistes et virologues se sont lancés dans le concours de la prédiction, en cédant aux sirènes de la visibilité. Polémiques scientifiques sur les plateaux télé et sur Twitter, où les plus raisonnables se sont brûlés les ailes : la deuxième vague était priée de se plier aux brillantes supputations de nos savants en désaccord – ce qu’elle n’a pas fait… Ainsi, chacun d’entre nous avait son scientifique préféré, celui qui collait à son degré d’exposition ressenti au virus. Il n’y avait plus de faits médicaux, seulement des interprétations divergentes. Une petite musique en est résultée, parce que douce à l’oreille : « On en fait quand même beaucoup pour si peu de morts ». La relativisation de cette épidémie a ainsi gagné des pans entiers de l’opinion publique, et les réticences à l’encontre du vaccin anti-covid viennent en partie de là.
Qui nous mettra d’accord sur les faits, ceux qui sont vérifiables et constituent la base d’une discussion et d’un monde commun ? La tentation de médias de plus en plus dépendants des réseaux sociaux est de s’idéologiser pour capter des communautés numériques – les fameuses « sphères », au risque d’en oublier la recherche des faits. Retour de médias d’opinion, non plus liés à des partis comme à la fin du XIXe siècle, mais à des familles idéologiques numériques.
Le tribunal populaire ou Orwell à l’envers
Tant que la parole était monopolisée par de bons clients de médias accrédités, respectueux des puissants et des notoriétés, la parole des victimes des méfaits et crimes des dirigeants était maintenue dans les marges, sinon exclue. Le smartphone et les plateformes de réseaux sociaux transforment là aussi la fonction de l’opinion publique : il s’agit comme jamais de contribuer activement à la chute personnelle des gouvernants, par la pression mise sur eux. Et le rapport de forces s’inverse, comme les inconvénients : les soupçonnés, à tort ou à raison, de crime ou de complaisance, sont acculés aujourd’hui dans le coin du ring social, sous les coups numériques, pendant que la parole accusatrice rameute et excite la détestation. De l’impunité, on passe au risque inverse, celui du soupçon généralisé.
Parler de dérive orwellienne pour dénoncer cette grande transformation est un contresens.
Dans 1984 « Big brother » scrute l’intimité de chacun grâce à une caméra installée dans le salon par un pouvoir politique totalitaire. C’est l’exact contraire qui se passe dans notre démocratie de l’expression : ce sont les autorités et ceux qui les incarnent qui vivent aujourd’hui sous l’œil numérique de la foule déboulonneuse de statues (anciennes ou présentes), grâce à des smartphones prompts à dénoncer le fautif par une prise de parole virale et à attester au besoin par l’image prise sur le vif – quatre homards géants sur une table par exemple. La « tyrannie » de la visibilité, c’est celle qu’exerce cette multitude sur les autorités. Tyrannie d’un nouveau pouvoir spirituel, et non temporel, selon la distinction d’Auguste Comte : pouvoir spirituel – culturel et moral si l’on préfère, hégémonie si l’on se veut gramscien – qui instaure non des lois, mais un nouvel ordre de priorités et de préoccupations, d’injustices à dénoncer, de bons comportements à observer ; qui ne distribue ni ne retire de l’argent, mais des réputations et du prestige. La multitude numérique incarne, avec ses influenceurs et lanceurs d’alerte en avant-garde, ce pouvoir spirituel grandissant, forçant l’ancien, celui des médias classiques, à suivre.
Cet orwellisme inversé a pour conséquence logique de nous réquisitionner, nous autres citoyens, en tant qu’apprentis-juges ou policiers. En se nourrissant des enquêtes « d’investigation » qui offrent aux médias leurs meilleures audiences. Le succès de Mediapart comme du Canard enchaîné leur doit en effet beaucoup, contre le vieux journalisme de connivence et de respect des autorités – voire parfois d’impunité des coupables.
C’est ainsi que le triangle systémique de la démocratie du public s’est déréglé et comme inversé avec la démocratie de l’expression. Les gouvernants et autres autorités vivent sous la menace judicaire et plus encore de réputation, ce qui ne contribue pas toujours à leur courage et efficacité – voir notre gestion sanitaire de l’épidémie… Les médias encadrent de moins en moins l’opinion, ils doivent se couler dans la recomposition idéologique en cours, qui a lieu sur les réseaux sociaux. Et les citoyens de plus en plus visibles s’y perdent un peu, ne sachant plus démêler les faits de leurs interprétations. L’opinion existe de plus en plus, à l’inverse de la critique bourdieusienne de l’ère des sondages. Mais sait-elle où elle va ? Réponse sans doute en avril-mai 2022…
Philippe Guibert
Enseignant et consultant
Ancien directeur du Service d’Information du Gouvernement (SIG)
Auteur de La tyrannie de la visibilité – Un nouveau culte démocratique, VA Press, janvier 2020.