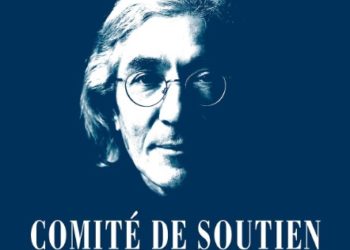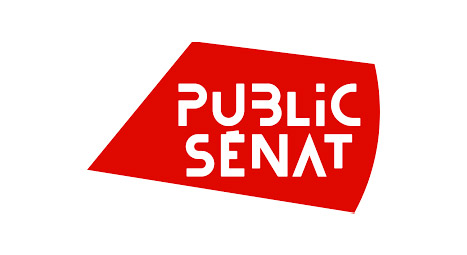Le scrutin uninominal à deux tours fait l’objet de critiques depuis la Cinquième République. Or, le choix du mode de scrutin est primordial pour tout régime représentatif. Et son degré d’adhésion à la démocratie est mesuré en fonction de la capacité de ce choix à garantir un certain nombre de principes fondamentaux pour l’exercice des droits civiques et politiques.
En France, s’agissant de l’élection des députés, on le sait, est pratiqué le système majoritaire uninominal à deux tours.
Depuis les débuts de la Cinquième République, ce système fait l’objet de critiques, qui demeurent actuelles et qui n’ont rien perdu de leur pertinence.
Et si le système demeure avec constance, en dépit d’une brève parenthèse limitée aux seules élections législatives de 1986, c’est exclusivement en raison de l’entente tacite, sinon de la connivence entre les deux principales forces politiques, qui drainent, lors de chaque élection, sinon la majorité des électeurs, du moins une majorité exprimée en sièges.
Et comme ces deux forces politiques sont situées chacune à un point opposé du spectre politique, l’on constate que leur convergence de vues ne repose pas sur une doctrine précise et argumentée, répondant à des conceptions de la représentation, a fortiori s’agissant du parti socialiste, dont les options premières ne le menaient certainement pas à vouloir conserver ce mode de scrutin, réputé, dans son camp, injuste et dangereux pour la démocratie.
Cette constatation se trouve renforcée si l’on a égard aux forces politiques qui remettent en cause la légitimité du mode de scrutin en vigueur en France, puisque ces forces sont hétérogènes et ne se situent pas à un point déterminé de l’échiquier politique.
Pour autant, l’analyse se doit d’être précisée et affinée, car si les effets injustes et déformants du mode de scrutin en usage dans notre pays sont bien connus, en ce qui concerne les bénéfices qu’il accorde indûment aux deux grandes formations politiques – et singulièrement à celle arrivée en tête lors de chaque échéance –, ainsi qu’en ce qui a trait aux pénalités qu’il inflige tout aussi gratuitement aux partis politiques de moindre importance pris globalement, il est d’autres conséquences qui sont moins mises en exergue par habitude et qui n’en sont pas moins inéquitables.
Ce sont ces dernières que la présente étude se propose de mettre en pleine lumière, non sans avoir rappelé, au préalable, la portée la mieux connue du mode de scrutin majoritaire à deux tours, car la somme de toutes ces incidences façonne un aspect de la représentation parlementaire fort peu conforme aux exigences démocratiques contemporaines.
Les conséquences bien identifiées du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours : une bipolarisation artificielle et la sous-représentation corrélative des petites formations
L’on sait que l’usage de ce mode de scrutin entraîne, d’une part, la sur-représentation des deux formations arrivées en tête et par définition, rivales en ce qui concerne la conquête du pouvoir exécutif, avec, en outre, une prime accordée à celle ayant réuni le plus de suffrages, cependant que les formations de moindre importance ne parviennent à atteindre un niveau de représentation en rapport avec leur importance électorale et même, peinent, si elles ne s’allient pas avec une des deux formations de tête, à être représentées.
La faveur aux deux grands partis
Cette conséquence est bien connue. Elle découle logiquement du mécanisme des élections à deux tours, qui, au second tour, mettent en évidence, la plupart du temps, deux partis politiques ou deux coalitions partisanes. Aussi, en fonction du swing de chaque élection, chacun de ces partis ou coalitions parvient, tour à tour, à l’emporter lors des élections législatives. Toutefois, d’une étude détaillée et minutieuse des modes de scrutin en usage dans les états de l’Union européenne en 2003, il était apparu que le système français était celui qui, de loin et bien plus que le système britannique, accordait une “prime” majoritaire au parti arrivé en premier lors des élections législatives.
Depuis 2002, ce face à face met en scène, d’un côté, l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et de l’autre, le Parti socialiste (PS).
Et si l’on remonte dans le temps, l’on s’aperçoit de ce que le phénomène n’est pas nouveau, indépendamment des dénominations des forces politiques en présence.
En effet, avant la création de l’UMP en 2002, qui précéda de peu les élections législatives tenues cette année-là, le système mettait aux prises, en 1997, d’une part, la coalition du Rassemblement pour la République, de Démocratie libérale et de l’Union pour la démocratie française, le Rassemblement pour la République jouant un rôle prépondérant et de l’autre, le Parti socialiste. Remontant encore un peu plus loin dans le temps, la bipolarité était exercée entre le Rassemblement pour la République et l’Union pour la démocratie française, pour ce qui concerne l’hémisphère droit et le Parti socialiste à gauche.
Avant la création de l’Union pour la démocratie française en 1978, l’articulation binaire était moins prononcée, le parti gaulliste, quelle que fût son appellation (Union pour la nouvelle République, Union pour la défense de la République, Union des démocrates pour la République) dominant l’ensemble d’une scène politique peu structurée, hormis par ce parti lui-même et sa prééminence, atomisée et d’où ne se dégageait aucune force réellement apte à contrebalancer le parti dominant.
Et à gauche, jusqu’en 1973, le Parti communiste était plus fort que les formations se réclamant du socialisme démocratique, mais il éprouvait des difficultés, au second tour des élections législatives, à rassembler des voix de manière à faire pièce au Parti gaulliste, cependant que des opposants au gaullisme se situaient à droite et répugnaient, par conséquent, à s’allier au second tour à un parti de gauche, ce qui contribuait au morcèlement et aux divisions de l’opposition.
Cette situation, favorisée par l’utilisation du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours, consacrait le premier rang du parti présidentiel, qui n’avait pas de challenger sérieux.
La situation changea à partir de 1978, quand le Parti socialiste devint le premier parti de l’opposition de gauche et que l’ensemble des forces libérales et conservatrices se trouva dans le même camp électoral. Et dès 1981, avec le phénomène de l’alternance, la bipolarité trouva son équilibre, lequel, quelque peu modifié, perdure encore au XXIe siècle.
La traduction de ces rapports de forces fut la prépondérance disproportionnée, en nombre de sièges gagnés, du parti ou de la coalition arrivé en tête (Union pour la nouvelle République en 1962 et en 1967, Union de défense de la République en 1968, Union des démocrates pour la République en 1973, Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie française en 1978 et en 1993, Parti socialiste en 1981, puis, en 1988, en 1997 et encore, en 2012, Union pour un mouvement populaire en 2002 et en 2007).
Cet état des choses fut plus ou moins prononcé et la circonstance qu’il le fut plus évidemment encore en 1962, 1973, 1978, 1981, 2002, 2007 et 2012 et de manière un peu plus atténuée, pour des raisons différentes, en 1967, 1968, 1988 et 1993, n’ôte rien à sa permanence.
En conséquence, le mode de scrutin usité en France aboutit à ce qu’un parti ne réunissant pas plus de 32 % des voix, comme l’Union pour la nouvelle République en 1962 ou 35 %, à l’instar du Parti socialiste en 1981, détienne presque la majorité absolue des sièges.
Bien évidemment, l’une des raisons d’être de l’utilisation d’un mode de scrutin majoritaire est de permettre de dégager une majorité arithmétique ; en conséquence, il peut paraître naturel aux yeux de ses défenseurs, qu’il produise un tel effet, fondé sur l’idée de plus grande légitimité des formations politiques les plus importantes, ne le seraient-elles que fort relativement.
L’examen de la seconde conséquence de l’emploi d’un tel mode de scrutin est de nature à affaiblir la défense de ses partisans.
L’amoindrissement de formations plus petites, même représentatives en termes électoraux
La seconde conséquence du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours est corrélativement de dévaluer proportionnellement la part occupée par des formations, certes moins importantes que les deux principales, mais qui peuvent accéder au rang de formations représentatives dans l’opinion et être considérées comme moyennes.
En premier lieu, certains partis politiques sont laminés s’ils ne contractent des alliances avec les deux plus grands partis. L’on peut songer à Lutte ouvrière, au Nouveau parti anticapitaliste, au Parti ouvrier indépendant, au Parti de gauche, au Mouvement écologiste indépendant, au Mouvement national républicain, au Mouvement pour la France, au Centre national des indépendants et paysans, à Chasse, nature pêche et traditions ou à Génération écologie ou bien aussi, de nos jours au mouvement démocrate.
Supposé que ces partis parviennent à présenter un candidat dans chacune des circonscriptions, ils paient le prix de leur indépendance par une non-représentation à l’Assemblée nationale assurée. Ces partis ne dépassent pas 2 % des voix exprimées et leur relégation est légitimée par les soutiens au mode de scrutin en vigueur en raison de leur faiblesse.
Bien que discutable en son principe, l’on peut comprendre ce point de vue. Même lorsque la représentation proportionnelle est instaurée dans un régime démocratique, il est fréquent qu’un seuil ou qu’un quotient soit fixé, en deçà duquel les partis présentant des candidats ne pourront avoir d’élu. évidemment, ce seuil peut être de 1 %, 2 %, 3 %, 4 % ou 5 % et la physionomie de la représentation nationale est fort différente selon le niveau retenu. Si l’on a égard au fait que seuls des systèmes très justes, mais rares, tels Israël ou les Pays-Bas retiennent un seuil ou un quotient minime, l’on peut, sans abus, considérer qu’entre 4 % et 5 %, l’objectif de justice est satisfait. Ce sont ceux employés, notamment, par l’Autriche et l’Allemagne.
Mais, il est des formations politiques écartées d’une représentation en accord avec leur importance et qui, néanmoins, ne sont pas aussi insignifiantes en nombre de suffrages exprimés.
C’est le cas du Parti communiste français, lequel, depuis 1958, est constamment sous-représenté par rapport à son importance électorale. Qu’il obtienne 6 % des voix, comme en 2012 ou bien 22 % comme en 1962, le nombre de ses députés n’est jamais à due proportion de ses scores.
Cela résulte de la logique du système majoritaire à deux tours : au second tour, le Parti communiste français a moins de chances de réunir autour de lui suffisamment de suffrages pour contrer un adversaire plus modéré, de droite ou de gauche. Et il lui est plus difficile de réunir l’ensemble des voix de gauche sous sa bannière que cela ne l’est pour le Parti socialiste.
À ce handicap, s’ajoute aujourd’hui sa plus faible implantation électorale sur l’ensemble du territoire national. Mais, en toute hypothèse, il est toujours sous-représenté.
Tel est également celui du Front national, qui depuis 1988 et excepté en 2007, a toujours dépassé, lors des élections législatives, les 5 % des suffrages exprimés au premier tour, dépassant parfois les 10 % (en 1993, 1997, 2002 et 2012) et qui n’a jamais pu faire élire plus de deux députés.
Encore plus flagrant que s’agissant du Parti communiste, en raison de l’isolement plus important du Front national par rapport aux autres forces politiques, ce décalage interroge sur la pertinence d’un mode de scrutin qui en vient presque à ignorer un parti politique représentant 13 % ou 15 % des voix exprimées.
Mais, ce fut aussi le cas du Mouvement démocrate (MoDem) en 2007, qui avec 7,7 % des voix aux élections législatives, ne réussit qu’à faire élire trois députés sur 577.
Et par le passé, ce fut aussi le sort du centre démocrate en 1967 et en 1968, comme des réformateurs (centre démocrate, centre républicain, mouvement démocrate socialiste, parti radical) en 1973, dont le nombre de députés n’était pas en relation avec l’importance électorale.
Cela démontre que le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours ne pénalise pas que des partis extrémistes, ainsi qu’il est parfois soutenu, mais des formations modérées et délibérément centristes.
Le critère qui paraît commun à tous les partis victimes de ce mode de scrutin frisant l’iniquité, est l’indépendance qu’ils tiennent vis-à-vis des deux grands partis sur lesquels se polarise la vie politique.
Ce ne sont pas les partis “hors système”, fantaisistes, “divers”, qui sont marginalisés par ce mode de scrutin, mais tous ceux qui ne s’inscrivent pas dans une alliance avec l’un des deux grands, ce que va confirmer avec éclat l’étude de ses conséquences moins connues, car moins révélées des analystes. Car, au-delà de ce qui est assumé par les acteurs, les protagonistes du jeu politique, il y a ce qui est occulté, laissé dans l’ombre et peu révélé à l’opinion.
Des effets moins connus : la sur-représentation de petites formations
C’est là l’un des paradoxes de ce mode de scrutin, de favoriser des partis politiques dont l’impact électoral est faible.
Les partisans du système majoritaire mettent en exergue la capacité de ce système à élaborer des majorités, naturellement, sans que des tractations aient lieu et sans que de longs pourparlers en soient le prélude.
Dans cet esprit, l’on a l’impression qu’un grand parti ou une grande coalition, préférablement désignée par les électeurs, se voie en mesure d’exercer des responsabilités, seul. Et il est mis l’accent sur la notion de “majorité”, de sorte que l’on croie au caractère majoritaire de chaque membre la composant.
Afin que de le mieux appréhender, un état des lieux du phénomène se doit de précéder des conclusions analytiques à son sujet.
Etat des lieux à partir des résultats électoraux
Il est certain que lorsque l’UMP fut au pouvoir de 2002 à 2012, après avoir gagné, à deux reprises, en 2002 et en 2007, les élections législatives, ce parti pouvait, une fois au gouvernement, légitiment apparaître comme le détenteur de la majorité. Et il en va de même, depuis 2012, du Parti socialiste. Du mode de scrutin usité pour les élections législatives, ces partis sont sortis grands vainqueurs et dominant l’Assemblée nationale.
Néanmoins, un examen plus détaillé et minutieux des résultats électoraux met en lumière une autre réalité, qui fait corps avec la faveur accordée au parti arrivé en tête.
Il s’agit de la représentation de partis alliés à l’un des deux grands, qui ont pu, en conséquence de cette alliance et de cette proximité, faire élire des représentants et dont l’importance électorale personnelle est en revanche des plus réduites.
En 2002, c’est ainsi que l’Union pour la démocratie française, laquelle, avec 4,7 % des suffrages, obtint 29 sièges, alors que le parti communiste français, qui fit un score fort proche (4,9 %) et légèrement plus important, dut s’en contenter de 21.
En outre, l’UDF obtint bien davantage que le Front national, fort pourtant de 11 % des suffrages.
Dans l’opposition, le Parti radical de gauche s’est trouvé dans la même situation, lui dont les résultats électoraux propres sont difficiles à quantifier, tant il est exceptionnel qu’il se mesure, au premier tour, au Parti socialiste. Le cas des Verts est analogue, car si leurs résultats personnels pouvaient dépasser ceux des Radicaux de gauche, sans le Parti socialiste, ils n’auraient pu faire élire le nombre de députés qui fut le leur.
En 2007, ce fut le Nouveau centre, qui avec 2 % des voix exprimées, eut bien davantage de sièges que son frère ennemi, le Mouvement démocrate, lequel convainquit pourtant 7,7 % des électeurs et presque autant que le Parti communiste qui réunit 5 % des électeurs. Le Nouveau centre eut, de surcroît, une représentation dont le Front national, avec 4 %, ne bénéficia pas. Et à nouveau, le Parti radical de gauche bénéficia d’une représentation qu’il n’aurait pas eue si un mode de scrutin de type proportionnel avait été en vigueur, assorti d’un seuil requis au minimum, afin de pouvoir faire élire des candidats. De même, ce que l’on a dit supra des Verts en 2002, mérite de l’être de nouveau, à propos de leurs quatre députés élus en 2007.
En 2012, encore, le Nouveau centre, le Parti radical de gauche, les Verts et même le Mouvement républicain et citoyen profitèrent de l’élection de certains parmi leurs candidats, sans qu’ils aient eu besoin d’administrer la preuve de leur force et de leur implantation électorales.
Cette situation crée un véritable paradoxe, dont les tenants du système majoritaire ne vantent pas l’existence, car cette contradiction affaiblit considérablement la vision d’un mode de scrutin « récompensant » les quelques rares formations politiques ayant pu gagner suffisamment la faveur de l’opinion, de manière à être représentées au Palais-Bourbon, les autres étant supposées ne pas être assez fortes, ne pas être suffisamment ancrées dans l’opinion.
Et pourtant… Le paradoxe agit assez loin sur l’ordre des choses. C’est en effet, sous la présente législature, grâce au Parti radical de gauche que les gouvernements détiennent une majorité absolue à l’Assemblée nationale (cette situation rappelle évidemment celle de la septième législature). Et de 2002 à 2007, ce fut grâce à l’Union pour la démocratie française que l’UMP détint cette majorité.
Cette situation a des racines anciennes. Outre la septième législature (1981-1986) qui a été invoquée, il faut se souvenir que sous les deuxième, troisième et quatrième législatures, le poids électoral des Républicains indépendants n’était certainement pas en rapport avec le nombre de leurs députés, que sous la cinquième législature, l’importance électorale du Centre, démocratie et progrès était sans relation avec le nombre de ses élus et que sous la sixième législature, le Parti radical valoisien, le Centre des démocrates sociaux, voire le Parti social-démocrate étaient sur-représentés dans l’hémicycle, comme l’étaient, déjà et depuis 1973, les Radicaux de gauche. Et sous les septième, neuvième, dixième et onzième législatures, tous les petits partis membres de l’Union pour la démocratie française, tant que celle-ci ne fut pas unifiée en 1998, sous l’égide de M. Bayrou, furent dans ce cas (Centre des démocrates sociaux, adhérents directs à l’UDF, Parti radical valoisien, Parti social-démocrate, puis Force démocrate et Parti populaire pour la démocratie française).
Une analyse faisant ressortir les différents fondements d’un système profondément injuste
Comment cette situation pour le moins troublante peut-elle se produire ? Par l’effet d’alliances nouées avant le premier tour des élections législatives, qui permettent à des partis politiques dont la force réelle est faible, voire presque inexistante, dans l’électorat, de négocier avec chacun des deux grands partis (le Parti socialiste et l’Union pour un mouvement populaire) un certain nombre de circonscriptions dans lesquelles ce grand parti ne présentera pas de candidats contre les leurs. D’ailleurs, ces partis, la plupart du temps, ne se donnent pas la peine de présenter des candidats dans chacune des circonscriptions.
Ainsi, apparaissent-ils revêtus, non seulement de leur étiquette personnelle, laquelle draine peu d’audience, mais de celle du grand parti qui a pris la responsabilité de les soutenir dès le premier tour. Et c’est ainsi qu’ils peuvent parvenir au second tour et, le cas échéant, à l’emporter à son issue.
Cet état des choses interroge à deux égards.
En premier lieu, il remet en cause la fonction, que d’aucuns estiment constitutive d’une vertu, de l’emploi du mode scrutin majoritaire uninominal à deux tours : ce dernier ne favorise pas exclusivement les grands partis, ce qui est souvent présenté comme une excuse relative à son injustice ; il privilégie aussi, et de manière plus outrancière encore, de petits partis, dont la légitimité d’une représentation à l’Assemblée nationale dans ces conditions, apparaît douteuse. Quelle légitimation apporter au fait que le Mouvement républicain et citoyen soit doté de trois sièges, sous l’actuelle législature, cependant que le Front national n’en compte que deux et que le Parti communiste n’en a que sept ? Comment expliquer et faire comprendre que le Parti radical de gauche et le Nouveau centre aient pu, d’abord, sérieusement envisager et ensuite, réaliser la constitution d’un groupe de députés à l’Assemblée nationale, tandis que le Parti communiste a peiné pour ce faire et qu’il s’agissait d’une impossibilité avérée pour le Hront national ou le Mouvement démocrate ?
À tous égards, la compréhensibilité de la loi électorale se trouve mise à mal, au moins dans le sens de sa compréhensibilité politique.
En second lieu, il met à mal la vision d’un scrutin majoritaire tourné vers l’idée de compétition et de concurrence. Ce n’est pas “que le meilleur gagne” qui prévaut. C’est une autre conception, fondée sur l’idée d’agrégats bipolarisés, à l’intérieur desquels se trouve un élément moteur (le “grand parti” de “gauche” ou de “droite”), autour duquel gravitent des formations sans écho réel dans l’électorat et dont l’élection de certains de leurs candidats permet d’assurer une majorité parlementaire, succès récompensé généralement par l’attribution de fonctions ministérielles, au cas où le grand parti “pilote” et “vedette” parvient au pouvoir.
Ainsi est bouleversée la conviction, assénée fréquemment lors de la présentation des avantages et des inconvénients des modes de scrutin, selon laquelle le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours, à l’instar du scrutin majoritaire à un seul tour, signifierait clarté et transparence aux yeux des électeurs, la représentation proportionnelle étant censée, à l’inverse, entraîner des combinaisons, des négociations étrangères aux électeurs, ces derniers ne sachant quelles seraient les préférences de la formation pour laquelle ils se prononcent au moment de l’élection, pour constituer, le cas échéant, un gouvernement.
De même, ne s’agit-il pas de l’application de la formule selon laquelle un choix ouvert serait offert aux électeurs au premier tour, choix qui serait restreint du fait des désistements et des reports au second, car, ce qui se produit la plupart du temps, à propos de la situation que nous avons dépeinte, est que, dès avant le premier tour, un grand parti s’est entendu avec une ou plusieurs petites formations, aux fins de la présentation conjointe d’un grand nombre de candidats (parfois presque de la totalité du nombre de sièges en lice). Par conséquent, les tractations et pourparlers ont eu lieu dès avant l’élection, avec à la clef, l’idée de “circonscriptions réservées” à telle ou telle de ces formations à l’audience confidentielle. Fréquemment, elles peuvent avoir pour pivot la recherche, par une des petites formations en lice d’un cumul de mandats par leurs champions, tant il est vrai que le mode de scrutin actuellement en vigueur pour l’élection des députés est intimement lié au cumul des mandats autorisé, par ailleurs, par le code électoral.
Si une compétition réelle avait eu lieu, lors de chaque scrutin et dans chaque circonscription, combien d’élus, depuis 1973, le Mouvement des radicaux de gauche, devenu Parti radical de gauche, aurait-il obtenu ? De même, est-il permis de se demander, de 1978 à 1997 de combien de sièges auraient pu disposer le Centre des démocrates sociaux et le Parti radical valoisien, s’ils avaient dû affronter, à chaque fois et en tout lieu, un candidat du RPR et un autre du Parti républicain. Et comment les Verts eussent-ils pu faire élire des députés de 1997 à 2012 ?
Avec toute sa raideur, le mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, employé au Royaume-Uni, aux états-Unis, au Canada, en Inde, jadis, en Nouvelle-Zélande, avant 1993 et avec des variantes, à Malte et en Australie, présente au moins la netteté d’être réellement compétitif et concurrentiel. Injuste dans sa portée, non seulement en ce qu’il lamine les partis qui n’ont pas un ancrage local suffisant et en ce qu’il autorise la victoire en sièges, sur le plan national, d’un parti ayant pourtant obtenu moins de voix que son suiveur et pour ces motifs, constituant un véritable repoussoir et un anti-modèle, il n’en demeure pas moins, en comparaison du système français, plus clair. Et de surcroît, se contente-t-il de primer un ou deux partis au plan national, de dimension respectable, l’un et l’autre, et non d’adouber des formations qui ne se sont véritablement confrontées aux électeurs, le terrain ayant été neutralisé en leur faveur et les deux grands partis leur consentant un effacement partiel, dans certaines circonscriptions.
Par voie de conséquence, apparaît un caractère pernicieux de ce mode de scrutin : il oblige implicitement les petites formations qui ont accepté de se placer dans une alliance avec un des grands partis, afin d’obtenir une représentation parlementaire, à une discipline qui peut aboutir jusqu’à la négation ou l’effacement de leurs valeurs.
En effet, tributaires d’un grand parti pour l’élection de quelques-uns de leurs membres, elles deviennent dépendantes de leur réélection. Le grand parti peut aisément exercer un chantage selon lequel en cas de défaillances de leur part dans le soutien qu’elles lui apportent, il peut, en représailles, ne pas soutenir leurs candidats lors des prochaines élections. En outre, si le grand parti est représenté au gouvernement, il lui est facile de subordonner l’entrée au gouvernement de ces petites formations à un soutien sans écart de leur part.
Pareille évolution a marqué la coalition ayant soutenu le gouvernement de M. Jospin et y ayant participé, de 1997 à 2002. Le seul parti dont dépendait arithmétiquement la majorité absolue du gouvernement à l’Assemblée nationale était le Parti communiste français. Celui-ci s’aligna sur une position de fidélité et de loyauté au gouvernement et durant les élections intermédiaires, d’ailleurs, excepté les élections des représentants français au Parlement européen, pratiqua des alliances avec le Parti socialiste et des candidatures communes. Les Verts agirent de même durant cette période et il est certain que ces deux partis perdirent beaucoup de leur identité initiale lors de cette expérience commune. Par contraste, lorsque le Mouvement des citoyens décida de soutenir la candidature de son chef, M. Chevènement, celui-ci quitta, en 2000, le gouvernement.
Une remarque analogue vaut pour le Nouveau centre de 2007 à 2012 et depuis lors, même dans l’opposition : hors de l’UMP, il peine à exister. C’est donc à un véritable faussement des identités et clivages partisans que peut aboutir le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Une expérience intéressante eut lieu avec l’UDF de 2002 à 2007. Au début de la législature, ce parti fut d’une grande discipline vis-à-vis de l’UMP. Puis, au fur et à mesure de la législature et de l’approche de l’élection présidentielle, il se détacha, de manière à se construire sa propre identité, car dans son cas, il ne s’agissait pas d’une simple restauration, ce parti n’ayant plus tenté, avant 2002 et de longue date, de se différencier réellement de l’ex-RPR.
Le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours s’accommode donc parfaitement de l’existence de micro-partis dont l’existence est purement parlementaire. Tel fut le cas, des décennies durant, des adhérents directs à l’UDF, du Parti républicain radical et radical-socialiste, dit “valoisien”, ou du Parti social-démocrate. Et auparavant, cela avait été le cas, plus brièvement, de la Fédération nationale des républicains indépendants et du Centre, démocratie et progrès. Comme ce le fut encore du Parti populaire pour la démocratie française durant sa courte existence. Aujourd’hui, le Nouveau centre, le Parti radical de gauche, le Mouvement républicain et citoyen illustrent ce schéma et plus encore, Force européenne démocrate, l’Alliance centriste et le Parti radical ou territoires en mouvement, qui, pour l’heure, ne se sont pas mesurés aux électeurs.
Il va de soi que la portée du mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours interroge au regard du respect de l’article 4 de la Constitution aux termes duquel : “La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation”, ainsi que du respect du principe qui en découle, selon le Conseil constitutionnel, de pluralisme des courants d’idées et d’opinions.
À tout le moins, en promouvant des partis de rang extrêmement modeste au niveau de la représentation nationale et en excluant simultanément des partis politiques à l’audience plus certaine, elle méconnaît le principe de proportionnalité en n’opérant pas une plus juste pondération.
Intempérant, le mode de scrutin actuel exclut ou retarde, en tout cas, marginalise, l’émergence, au plan de leur représentation parlementaire, de partis politiques disposant cependant d’un ancrage dans l’opinion, tandis qu’il maintient artificiellement à ce rang des partis qui ne trouvent plus ou pas d’écho dans l’électorat.
En conclusion, le mode de scrutin pratiqué en France pour l’élection des députés présente de nombreux inconvénients et est entaché de nombreux vices : déformant outrancièrement, comme tout système majoritaire, la représentation populaire, il ne se contente pas d’opérer une sélection en ne retenant que les partis plus importants ; tout en évinçant d’une légitime députation certaines formations, il en agrège d’autres, dont la représentativité électorale est incertaine, voire inexistante. Par là, il rend ces petites formations otages des deux plus grandes et nivelle ainsi le système partisan.
Et s’il a permis – à une exception près, en 1988 – de dégager une majorité à l’Assemblée nationale, il convient de relever que lors de la seule occasion, sous la Cinquième République, où fut mis en œuvre, en 1986, un mode de scrutin faisant appel à la représentation proportionnelle, une majorité put également émerger.
Enfin, ses inconvénients sont tels que son maintien engendre naturellement le désintérêt et le découragement des électeurs, car le rapprochement des situations qui ont été exposées supra est fâcheux pour la bonne santé de la démocratie et du lien civique. L’on ne peut, à cet égard qu’être surpris de constater la modestie des propositions de réforme du mode de scrutin pour l’élection des députés, formulées, dans son rapport remis le 9 novembre 2012, par la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, dite “commission Jospin” instituée le 16 juillet 2012, laquelle se contente de préconiser un mode de scrutin mixte, selon lequel seuls 10 % des sièges seraient attribués à la représentation proportionnelle, le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours continuant à être employé pour l’élection des 90 % restants. Et il est couramment admis qu’un nouveau mode de scrutin peut servir à changer la société…
Edwin Matutano, avocat, docteur en droit
—————
(1) J.-C. Colliard, Les systèmes électoraux dans les Constitutions dans les pays de l’Union européenne, Les cahiers du Conseil constitutionnel, n°13, janvier 2003, p. 69.
(2) Le Parti gaulliste, bien que n’ayant pas obtenu moins de suffrages qu’en 1962, se heurta à une opposition plus structurée au second tour.
(3) Le Parti gaulliste obtint un raz-de-marée en sièges, mais en nombre de voix, sa domination était, quoique moins accentuée, très affirmée, ce qui atténuait le prisme déformant du mode de scrutin.
(4) Le Parti socialiste, bien que majoritaire, n’obtint pas la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale.
(5) Comme en 1968, à propos du Parti gaulliste, la domination du Rassemblement pour la République et de l’Union pour la démocratie française coalisés, bien que spectaculaire, apparaissait moins illégitime et décalée de la réalité, eu égard à la déroute subie par le Parti socialiste, leur principal adversaire.
(6) J.-E. Gicquel, J-Cl. Administratif, fasc.102, Parlement.
(7) Le nouveau centre obtint 22 sièges, le Modem, 3.
(8) Sur 577 sièges, le Parti socialiste en compte 280 et le Parti radical de gauche en a 12.
(9) Lasserre-Kiesow, La compréhensibilité des lois à l’aube du XXIe siècle, Rec. Dalloz, 4 avril 2002, p. 1 157.
(10) J.-C. Peyronnet, Parlementaires : assiduité, cumul et mode de scrutin, AJDA, 2012, p. 2 185.
(11) Aux états-Unis, ainsi, à trois reprises, le Président élu ne fut pas celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix : en 1876, en 1888 et en 2000 ; au Canada, à sept reprises (1878, 1882, 1887, 1891, 1896, 1926, 1957,1979), le parti ayant emporté le maximum de sièges aux élections fédérales était arrivé en deuxième position ; pareille distorsion se produisit deux fois au Royaume-Uni : en 1951 et en 1974 ; elle eut lieu à cinq reprises en Australie (1954,1961,1969,1990,1998) ; en Inde, elle fut constatée trois fois (1996,1998 et 1999) ; à Malte, elle se produisit en 1981 et en 2008 ; enfin, en Nouvelle-Zélande, quand ce mode de scrutin avait cours, elle se produisit en 1981.
(12) Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009.
(13) Décision n° 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012.
(14) Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, Doc. fr., Paris, 2012.
(15) D. Baranger, O. Beaud, Un regard de constitutionnalistes sur le rapport Jospin, AJDA, 2013, p. 389.
(16) Expression empruntée à B. Perrin, Le mode de scrutin au service de la réforme, AJDA, 2013, p. 1 769.