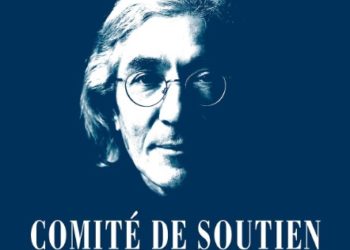Il y a presque trois décennies, je me posais la question* à une encablure de l’acte 1 de la décentralisation de la Ve République. Elle m’est reposée aujourd’hui ici. C’est l’occasion de mesurer la résilience des hypothèses et diagnostics d’alors. Moins pour juger de leur validité que pour apprécier la portée des changements survenus depuis dans le monde des élus professionnels, à la veille d’un nouveau train législatif (si ce n’est constitutionnel) après les élections municipales de 2020.
Quelle était l’observation d’alors ? L’annonce rituelle de « la fin des notables » masquait la résistance de la « notabilité », une dimension structurelle de notre système politique. Les notables étaient vus, à l’orée des années 90, moins comme un groupe spécifique qu’un milieu de différenciation des acteurs de la transformation des pouvoirs et de leurs pratiques anthropologiques. Leur mode de production était à la fois dans le territoire et le statut social.
Le territoire, c’est un espace fragmenté qui, même s’il a été nationalisé par plusieurs biais et de multiple fois, doit toujours être reconstruit pour être représenté à l’aune de circonscriptions électorales.
Le statut social, c’est la notoriété faite de variables et multiples ingrédients parmi lesquels la réputation de compétence appliquée à différents domaines de l’action publique.
Le notable était donc vu déjà comme une figure promise à d’incessantes transfigurations au rythme des changements institutionnels, politiques et sociaux.
L’analyse de la réforme de la décentralisation de ces années 80 était rapportée aux principales caractéristiques de ses processus : la relance du Département au prix d’une relativisation de la Région ; la promotion de l’élu local comme entrepreneur politique ; l’expansion de politiques publiques locales ; l’atrophie de la démocratie délibérative.
Ces sujets étaient à l’époque peu explorés par les sciences sociales. Les travaux pionniers restaient plutôt rares. Ils ouvraient pourtant la voie à des recherches sur la continuité du pouvoir notabilaire : son apparent archaïsme était géré par la bureaucratie étatique qui œuvrait ainsi efficacement à la modernisation fonctionnelle des « pouvoirs locaux ». La stabilité et la force de l’État local se renforçaient au gré de réformes territoriales auxquelles s’adaptait la notabilité politique. Ces pistes ont été redessinées par l’élan réformateur porté par la législation mais aussi l’idéologie décentralisatrice de la gauche au pouvoir.
C’est dans le champ de la science politique (en sociologie et en histoire) que ces recherches ont été les plus nombreuses et heuristiques. Au-delà des divergences méthodologiques, elles aboutissaient à l’idée d’un processus de professionnalisation politique fermant toujours plus le cercle de ses acteurs autour de leurs intérêts et enjeux propres dans des territoires déterminés. Ce cercle était le vivier de la reproduction des notables. Celle-ci requerrait des qualités tout autres que celles de la légitimité élective traditionnelle : mobilisation de savoirs techniques, constitution d’équipes de fonctionnaires territoriaux, formation de groupes de collaborateurs élus, production de politiques publiques locales. Les nouveaux notables étaient donc un groupe en expansion qui devait transformer les ressources acquises ou héritées : cumul des mandats, rémunération des fonctions, maitrise des modes de scrutin, conduite de l’action publique.
Nous allons examiner comment s’est opérée et a évolué cette transfiguration au cours des trois décennies qui nous séparent de notre primitive interrogation. Nous le ferons à travers le prisme d’un triple changement : celui des institutions de la décentralisation ; celui des conditions de carrière politique ; celui de l’organisation sociale.
De l’entreprise à l’empowerment
Nous avons laissé notre notable des années 80 à l’état d’ « entrepreneur » work in progress. Ce terme voulait désigner un double phénomène : celui d’un processus par lequel un élu construit des « qualités » avec lesquelles il forge une image manageriale ; celui d’un état correspondant à la capitalisation de ressources offertes par la décentralisation. S’agissant de mesurer les changements dans la sphère institutionnelle intervenus depuis, on les résumera avant de proposer une autre caractérisation du nouveau notable qu’elles ont produit.
La principale innovation des lois de 1982 était la promotion de la Région comme collectivité de plein exercice. Elle s’est progressivement affirmée comme niveau de représentation politique et d’impulsion des politiques publiques. Ses domaines de prédilection se concentrent sur les infrastructures, le développement économique, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche. Mais l’effet de rationalisation qui était attendu de la régionalisation n’a pas eu lieu. Le 1er janvier 2016, les régions ont été ramenées de 22 à 13 (hors régions d’outre-mer, au nombre de 5), en opérant la fusion de certaines d’entre elles. Cette fusion géographique ne s’est pas accompagnée de moyens croissants, de nature à créer des régions d’envergure européenne, en dépit des discours officiels. Si bien que le bilan de l’opération est d’ores et déjà celui d’un échec au demeurant prévisible.
Si bien que le Département, souvent considéré comme devant disparaître à l’occasion de chaque nouvelle réforme, est resté le véritable phénix de l’administration française. Régulièrement condamné, il renaît toujours de ses cendres, car il bénéficie notamment d’un fort soutien au sein du Sénat qui pèse d’un poids essentiel sur les politiques de réforme territoriale. C’est le Département qui, entre autres compétences, exerce l’essentiel de la mise en œuvre de beaucoup de politiques sociales, de transports et de solidarité (pour lesquelles il a été désigné « chef de file » par la loi Maptam du 27 janvier 2014). C’est lui qui est au cœur des enjeux d’aménagement équilibré du territoire entre les zones urbaines et rurales. La tendance est à la fusion de Départements ou à leur confusion avec les Métropoles si ce n’est avec les Régions. C’est bien l’aggravation de la complexité qui s’est imposée au terme de ces trois décennies de réformes.
Elle est amplifiée par la carte des communes. On sait que la France dispose avec elles d’un niveau d’administration territoriale dont la densité est très supérieure à la moyenne européenne. Avec 34 970 communes, dont près de 32 000 ont moins de 2 000 habitants, la France compte à elle seule plus de 40 % du nombre total de municipalités de l’Union européenne (pour 15 % de la population). Leur regroupement dans des « communes nouvelles » définies par la loi du 16 décembre 2010 a permis de réduire ce chiffre à un rythme assez lent mais piloté par l’Association des Maires de France et non par l’État : 1 730 communes de moins en sept ans pour 800 communes nouvelles.
Afin de résoudre les difficultés créées par cette atomisation, la coopération intercommunale a été régulièrement encouragée, ce qui a donné naissance à un second très dense niveau local : l’intercommunalité institutionnalisée et dotée de compétences, de pouvoirs fiscaux, d’élus au suffrage universel et d’administrations. Soient : 21 métropoles, 13 communautés urbaines, 223 communautés d’agglomération, et 1 001 en zone rurale. Parallèlement à ces institutions, qui sont des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), on compte aussi d’autres regroupements, sans pouvoir fiscal, mais chargés de la mise en œuvre de compétences, le plus souvent techniques. Ce sont les syndicats intercommunaux. On en compte plus de 11 000 alors que le projet des gouvernements qui se succèdent depuis les années 1990 est de les fondre dans la première catégorie d’intercommunalité. Au dessus du niveau local et « inter-local », on compte donc deux niveaux dotés de compétences générales sur leurs territoires.
Dans ce paysage, s’impose une fragmentation digne de la féodalité pour ce qui concerne l’exercice de pouvoirs qui esquivent de plus en plus les règles de la démocratie élective la plus élémentaire. Cela s’opère dans un contexte de retrait de l’État organisé par la Révision générale des politiques publiques (RGPP) commencée en 2007 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et poursuivie en 2012 sous celui de François Hollande (sous le nom de Modernisation de l’action publique). Il s’accompagne de la privation de ressources fiscales d’importance pour toutes les collectivités territoriales. Les impôts sont remplacés par des dotations, ce qui ruine encore un peu plus le principe de leur autonomie et de libre administration inscrit au fronton de l’article 72 de la Constitution. Le système des « blocs de compétence » prévu en 1982 s’est perdu dans un gouvernement de la complexité, théorisé en Italie dès les années 80 comme « gouvernement de la fragmentation » dont la France s’est rapprochée.
Quelles sont les conséquences de cette évolution sur le notable-entrepreneur confronté à une gestion de ressources de plus en plus rares dans un environnement opaque ?
Si sa position sociale demeure une propriété singulière de son pouvoir politique, le notable est de plus en plus l’autre nom d’une structure collective étoffée, rajeunie et diplômée. Elle est repérable dans la généralisation de cabinets toujours plus professionnalisés. Le renforcement des exécutifs locaux est en régulière augmentation dès les années 1990. Il s’appuie sur une personnalisation maximale du chef et de ses pouvoirs démesurés sur des équipes d’élus et sur des assemblées dont le pouvoir a décliné. La compétence est à la fois concentrée et collégiale : elle entretient une demande de capacité d’expertise, d’encadrement administratif, de coopération politique. Le cercle des collaborateurs d’élus s’est resserré et devient un vivier où s’amorcent de véritables carrières électives. Le contrôle du territoire, s’il demeure une des conditions majeures de la notabilité, doit satisfaire la maitrise de la complexité et de la fragmentation. La logique de l’intercommunalité est d’obliger les élus à se mouvoir dans la différenciation. Cela doit s’entendre comme une gestion de plus en plus particularisée faite de négociations, de cofinancements, de coopérations en tout genre entre collectivités. Ce n’est plus le rapport du préfet aux notables ni du centre à la périphérie qui importe. C’est la construction de compromis, de coalitions, de rapports de force horizontaux dans un environnement ultra-concurrentiel pour capter des ressources très inégalement réparties. L’autorité politique ne vient plus de la capacité à accéder au centre, mais du savoir-faire dans la distinction des bons niveaux de politiques publiques allouées à des fragments de territoires. Dans le domaine de la légalité républicaine aussi. L’État reflue : les préfets exercent de moins en moins le contrôle qui leur échoit. Du coup s’inventent des compétences (en matière économique mais aussi quasi régaliennes comme la sécurité) qui sont autant de normes de l’action publique. Certains élus, en apparaissant comme les maitres de cette adaptation de l’État au local, deviennent les figures de ces compétitions que ce soit en « zones sensibles » ou d’ « excellence ». Ces territoires se couvrent d’instances multiples et spécifiques (commissions, conseils, comités de pilotage…) propices à la mobilisation de ces acteurs dont l’État attend la participation et l’engagement. Dans ces arrangements locaux, les élus découpent des espaces où ils peuvent exercer des pouvoirs différenciés à l’extrême, vu la réduction du périmètre de l’administration territoriale et de ses services.
La portée de cette transformation peut être mesurée au moyen de la notion d’empowerment. Elle renvoie à des sens extrêmement divers, ce que son exportation anglo-saxonne comme sa trajectoire sémantique et politique ont aggravé. Dans une polysémie allant de la revendication d’une autodétermination de groupes stigmatisés, à la volonté d’étendre les « valeurs » du marché à toutes les institutions, on retiendra deux de ses principales dimensions : celle du pouvoir et celle du processus d’apprentissage qu’il requiert. Elles désignent un tournant dans lequel les enjeux des pouvoirs locaux deviennent fondamentaux pour une raison essentielle : ils sont à eux seuls une distanciation d’avec les bureaucraties hiérarchisées et une incitation corrélative à une meilleure efficience des services publics que réaliserait une « participation citoyenne ».
Les institutions décentralisées gagnent donc une place privilégiée dans ce mouvement où l’on croit qu’on doit et peut se passer de pouvoir.
Elles en sont devenues la manifestation comme si leurs qualités étaient dans la proximité sociale et leur distance d’avec des appareils autoritaires.
Le champ des politiques publiques locales peut être ainsi vu comme celui où s’articulent trois formes de pouvoir : de création, d’invention et d’expérimentation (pouvoir de, avec et sur). Une vision très néolibérale de l’État animateur requiert des élus qu’ils incarnent des espaces et usent de procédures susceptibles de correspondre à une demande autant polymorphe que redoutée de participation sociale et politique. Les nouveaux notables sont ceux qui y parviennent dans l’entrelacs des nouvelles échelles territoriales de coopération. La limite de cet empowerment est dans ces arènes de participation jusqu’ici bien contrôlées par les élus. L’augmentation de leur pouvoir diffus sur des espaces flexibles pourrait susciter des tensions stimulantes.
C’est pourquoi il faut examiner ce qu’est devenue la dimension dépolitisée autant que dépolitisante des notables avec les réformes ayant touché à leur statut.
De la notoriété à l’obscurité
Le notable tel que nous le saisissions au début de la mise en œuvre des lois de décentralisation était ce professionnel de la politique en perpétuelle exploitation des moyens qu’il recevait autant des sociétés qu’il aspirait à représenter que des services extérieurs de l’État auxquels il avait accès. Sa notoriété ainsi construite le plaçait au sommet d’une pyramide de pouvoirs faits de capitaux sociaux, culturels et politiques. Cette situation demeure valide. Mais la décentralisation a dévalué plusieurs de ces capitaux. Si bien que la figure surexposée du notable semble se métamorphoser pour se fondre dans l’opacité des réseaux qu’il parcourt et de la banalisation qui en résulte. Deux phénomènes peuvent servir de cadre à l’analyse : la dévaluation tendancielle du cumul des mandats et la dépolitisation croissante de la gestion décentralisée.
Le cumul des mandats était une fabrique de la notoriété.
Il allouait à l’élu un pouvoir d’intermédiation avec son environnement social et politique, ressource majeure de la position dans son champ. Le cumul, si spécifique à la France, était moins le résultat de stratégies individuelles que l’expression d’une sociologie de la démocratie représentative dans ce pays. Il ne s’agit pas tant ou pas seulement de dispositions personnelles à exercer du pouvoir que des incitations du milieu à produire le personnel nécessaire à un « jacobinisme apprivoisé ». La décentralisation a régulièrement jusqu’ici développé cette tendance, pas seulement en constituant des centres locaux de décision. Elle a « majoralisé » tous les exécutifs, départementaux et régionaux, c’est-à-dire qu’elle leur a appliqué le système très spécial du maire dans sa commune : un exécutif personnel non collégial, irresponsable devant son assemblée dont il est à la fois le président et l’exécutif. Autrement dit un condensé de cumuls et un concentré d’autorités. Ce système a renforcé « l’union personnelle » entre pouvoir local et pouvoir central que réalisait le cumul des titres de responsabilité.
La question du cumul des mandats concerne donc l’économie du système politique. Plusieurs lois ont été votées (en 1985, 2000, 2014) pour limiter le cumul dans l’espace. Elles sont restées la marque d’un clivage entre la droite et la gauche. Cette dernière n’est parvenue que partiellement à la résoudre durant les années où elle avait la majorité parlementaire pour le faire en appliquant son programme. Il s’agit en fait de changer une culture propre à la France, ce qui peut expliquer la réticence du législateur à s’engager dans cette voie. Ce dispositif était non seulement essentiel dans le rapport entre le centre et la périphérie ; il était aussi le socle matériel de l’addition d’indemnités grâce auxquelles les élus pouvaient vivre de la politique de manière durable. La longévité de l’exercice de mandats (sans aucun rapport avec la situation des pays étrangers comparables) garantissait ainsi une carrière. Au cours des quatre dernières décennies, le nombre de députés qui ont eu la politique comme activité professionnelle principale, et ce grâce au cumul, a été multiplié par huit. Dans le même temps le nombre d’anciens collaborateurs et de permanents de partis devenus députés a plus que doublé. La sociologie de cette « représentation nationale » est celle d’un groupe (surdiplômé, masculin, vieillissant, sans aucun ouvrier et avec 4,6 % d’employés – 40 % environ de la population active) de moins en moins représentatif de la société. Le vivier des mandats locaux s’est épaissi avec la multiplication des institutions décentralisées ; si bien qu’on compte environ 600 000 élus dans la France d’aujourd’hui (soit une augmentation d’environ 20 % en 30 ans). Cette expansion quantitative est une opportunité politique qui explique la promotion des collaborateurs des élus installés et la fermeture de leur cercle. L’exercice d’un mandat local est devenu plus nécessaire qu’auparavant pour accéder à une fonction nationale. Plus que jamais le cumul était devenu une protection garantissant la longévité d’une carrière qu’il faut savoir gérer. Les changements législatifs ont poussé à fermer toujours un peu plus les espaces de la représentation en les professionnalisant.
Depuis 2017, les parlementaires ne peuvent plus cumuler leur mandat national avec un mandat exécutif local. Mais ils peuvent conserver leur mandat de conseiller dans l’une ou l’autre des assemblées locales. Et on a pu observer l’inventivité des élus à fort capital électif pour contourner les interdits : cumul « en grappe » (avec les héritiers ou collaborateurs politiques), en famille ou en opportunité (selon les mandats convoités et leur calendrier électoral). On ne saurait oublier les fonctions de direction d’établissements publics et autres structures de gestion auxquels ils ont toujours accès. La difficulté est dans l’application de ces mesures. Tout se passe comme si les promesses faites et les textes votés, on s’employait à différer leur mise en œuvre, si ce n’est à les remettre en cause. L’argument du lien avec la « société réelle », indispensable à une bonne législation autant que gage d’une proximité sociale revient inlassablement.
Quoi qu’il en soit la tendance est à la réduction du cumul et de ses propriétés dont la concentration de pouvoirs. On peut se demander si elle est due au rejet (ancien et massif) du cumul dans l’opinion ou au changement d’échelle des modes d’action des élus.
La fragmentation des territoires analysée précédemment fait apparaître un autre phénomène qui ressort des observations de tout ce qui concerne l’intercommunalité. La focale est certes mise sur la commune ; mais le nombre, la variété, la transformation de cette unité de mesure du changement, peut valoir pour toute la gestion locale vue sous l’angle de la notabilité.
Le localisme a toujours été une ressource majeure même pour les partis les plus nationalisés.
Les nouveaux espaces ouverts par la décentralisation en ont augmenté l’importance. La gestion des collectivités est devenue, à elle seule, tout un programme, supplantant celui des formations d’appartenance. Les clivages propres aux partis ont progressivement gommé leur dimension idéologique ou historique. C’est un pragmatisme généralisé qui les a supplanté. Les élus se sont posés comme aménageurs qui doivent démontrer une capacité d’agrégation des intérêts (privés, publics ; horizontaux, verticaux) produisant des compromis territorialisés entre plusieurs réseaux (d’experts, de professionnels, d’homologues). On a vu ainsi dés les années 90 s’opérer une dissociation entre deux territoires : celui des circonscriptions héritées des constructions nationales anciennes, où s’est cristallisée l’organisation des administrations, partis, groupes d’intérêt ; celui des circonscriptions fonctionnelles où s’agencent les alliances entre intérêts publics et privés, la production de biens et de services, l’imagination de nouveaux espaces. Cette dissociation ne débouche pas sur un antagonisme mais sur une nouvelle dimension, dynamisée par la coopération intercommunale (et aussi transfrontalière) : celle d’un territoire flexible où les circonscriptions de l’action publique varient et mettent en concurrence différents découpages à la base de l’organisation et de la représentation des intérêts.
Ce dispositif a fini par affecter le cœur du métier politique lui-même. Il a porté un vaste mouvement de dépolitisation qui a anticipé et préparé la désintégration des grands partis, apparue au grand jour lors de l’élection présidentielle de 2017.
L’institutionnalisation de l’intercommunalité a été le creuset de ce processus. Les Établissements publics de coopération intercommunale se sont autonomisés en encourageant les maires à privilégier les arrangements de nature à préserver ou étendre leurs prérogatives. En apprivoisant cette réforme les élus locaux (et leurs équipes) ont fabriqué une véritable culture du consensus. Le gouvernement des structures intercommunales s’est aligné sur un accord inter-partisan, les gestions de gauche et de droite se ressemblant de plus en plus. Les conflits se résolvent à distance des électeurs, de manière pragmatique et en dehors de toute dimension idéologique. Les compromis ainsi passés le sont en toute confidentialité pour éviter l’intervention d’acteurs extérieurs. Ils sont ainsi une garantie supplémentaire de stabilité fonctionnelle et de protection de la carrière des élus (dont les indemnités s’élèvent d’autant).
Ce résultat entraîne deux inconvénients : le premier est celui de la technicisation des choix et de la réduction de leur envergure. Les compétences transférées restent souvent de fait dans l’orbite des communes au prix de compensations coûteuses (en matière de voirie ou d’urbanisme). Les projets importants se brisent sur la routinisation de la gestion communale. Le second inconvénient est d’ordre démocratique : la répartition des sièges se fait selon des négociations opaques avec une logique d’échange entre factions ou caciques politiques ; le pouvoir des maires est renforcé alors que leurs conseils municipaux sont dévitalisés ; les délibérations communautaires se font selon une logique de secret plus que de publicité.
Cette dépolitisation est radicale. Elle est désormais profondément enracinée dans tous les territoires, vu les bénéfices qu’y trouvent les élus. Elle est sans doute la forme ultime revêtue pas le processus de notabilisation qui a le plus souvent privilégié l’incarnation des intérêts locaux contre la politique et ses clivages. Elle réussit à les banaliser si ce n’est à les rendre invisibles. Elle peut correspondre au changement social comme elle risque tout autant d’apparaître comme une déficience démocratique.
*
* *
Pour conclure ce réexamen de la figure du notable, il faut évoquer l’impact du changement social de ces dernières années. Nous sommes déjà passé à une autre société. Les modes de production de la valeur ont changé ; et cela a des conséquences majeures pour ce qui concerne l’économie de la connaissance et les caractères d’un « nouvel âge démocratique ». L’élévation du niveau culturel moyen des populations, du fait de l’accès facilité à un stock toujours plus grand d’informations de tous ordres, s’inscrit dans la longue durée civilisationnelle. Leur maitrise, le traitement de leur sélection font problème. Mais le nouvel état des sociétés démocratiques est bien là : les relations hiérarchiques s’affaissent ; les rapports entre gouvernants et gouvernés, dominants et dominés, classes et individus appellent des idées nouvelles sur le peuple, le pouvoir, les alternatives possibles.
Un nouveau cycle semble s’être ouvert avec l’apparition de mouvements sociaux dont l’usage qu’ils font des technologies numériques est un bien commun, d’Occupy Wall Street à Taksim, en passant par Tahrir, Italia ou Riad Al Sohl. En France, de Nuit debout aux « gilets jaunes » en passant par Notre-Dame des Landes. L’autre trait distinctif à ce « mouvement des places » est le retour au local, conçu comme un espace de repolitisation. En France la commune et le quartier retrouvent un sens dans une perspective d’émancipation (telle que le conçoit une version de l’empowerment) de populations toujours plus exclues des institutions de la représentation.
C’est ici que se joue une rencontre avec le phénomène observé de dépolitisation du système décentralisé. On a pu observer dans le mouvement des « gilets jaunes » une séquence significative, celle où l’Association des maires ruraux de France (AMRF) et l’Association des maires des petites villes de France (APVF), soit 11 000 maires environ, appelaient leurs membres, le 5 décembre 2018, à « recueillir les doléances et les propositions des citoyens ».
Tout s’est passé dans ce mouvement comme si les élus locaux étaient épargnés par les mobilisations, celles-ci préférant cibler les permanences de parlementaires.
En retour on peut voir dans cette sorte de compréhension des élus pour les manifestants, une contestation nouvelle des procédures autoritaires qui ont accompagné l’intercommunalité de ces dernières années, depuis les réformes de mode de scrutin jusqu’aux changements des conditions d’application de la loi. On peut s’interroger sur le devenir de ce type de convergence quant à l’avènement d’une « démocratie participative », tout au moins de procédures ou d’instruments qui induisent de nouveaux modes de contrôle du politique dans les territoires. Toutes et tous sont nés de l’initiative d’une autorité de tutelle et aucune n’a vocation à se substituer à celle-ci. Leur délibération est consultative et ne débouche que très rarement sur la garantie d’une exécution. Ces procédures ont donc d’indéniables qualités démocratiques : elles produisent de l’information ; elles forcent à l’argumentation ; elles construisent de la légitimité par le respect de tous les acteurs impliqués. Tout ceci annonce une nouvelle posture dans la production d’une légitimité institutionnelle. Mais pour l’instant, c’est le mécanisme de discussion de la décision qui y importe finalement plus que la décision elle-même. Ce type de participation peut donc être un procédé d’acceptation sociale des décisions détournant les mouvements sociaux de leur vocation contestataire et critique. C’est ce que confirment les enquêtes de terrain dans des domaines spécifiques. Par exemple, la politique de la ville à laquelle les habitants des quartiers populaires en France sont souvent invités (si ce n’est enjoints) à participer. La démocratisation attendue est de toute manière bornée par la faible présence des plus démunis (les jeunes, les non-diplômés, les femmes seules, les étrangers) dans les dispositifs délibératifs observés. De plus, la dimension délibérative reste généralement locale ; et les élus « de terrain » se montrent particulièrement attentifs à ce qui pourrait mettre en cause leur pouvoir, même résiduel (il n’est qu’à voir la pratique la plus répandue des comités de quartier inféodés au système municipal). Même et surtout quand la loi (comme celle de programmation pour la ville du 21 février 2014) prévoit des « conseils citoyens » dans les « quartiers prioritaires », les maires qui en sont responsables en font des structures de validation de leurs décisions. De toutes ces pratiques il ressort que la délibération généralisée peut devenir un support à des mobilisations civiques mais qu’elle ne produit pas un nouveau type de pouvoir. Et que celui-ci reste bien exclusivement dans les mains des élus et des agences qu’ils mobilisent. L’institution s’avère décidément plus forte que les agents sociaux cantonnés à des formes de mobilisation.
Mais cette question excède le cadre de notre question sur les notables. Que sont-ils donc finalement devenus au stade atteint par la décentralisation de la République ? Tout s’est passé comme si, campant au centre de leurs terroirs, monopolisant leurs représentations, cumulant horizontalement les pouvoirs afférents, ils s’étaient en quelque sorte sécularisés. De ministres du culte de l’autorité, symbolique qu’ils étaient, ils se sont fondus dans le paysage des « aires urbaines » (l’hybridation villes-campagnes) telles que définies par l’Insee. C’est une banalisation qui ne règle en rien le repli « nativiste » à l’œuvre dans nos sociétés, qui menace pas seulement les « représentations nationales », mais aussi l’inscription de la démocratie dans le territoire.
Paul Alliès
Professeur émérite à l’Université de Montpellier
* Dans la revue Autrement, n° 122, mai 1991. « Faire la politique », Marc Abelès (dir.) pp.108-119.