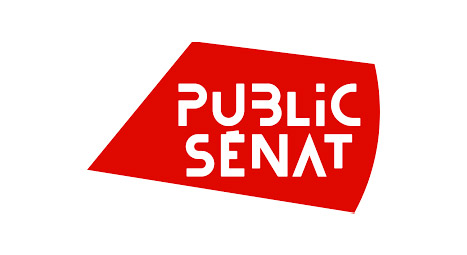La crise agricole – nous préférons dire « paysanne », celle du pays, celle des pagi médiévaux, des hommes de la terre, de notre terre – n’en finit plus : blocages, opérations tractorisées, fumier répandu sur d’autres, tonnes de lait déversées, intrusions à Rungis, boycott du salon de l’agriculture, etc. Les réactions politiques sont inexistantes, coincées entre l’inféodation européenne et l’incapacité ignorante des gouvernants, ou disproportionnées, convaincues de l’absurdité wébérienne (et détournée) que toute violence étatique est légitime.
L’origine de la souffrance paysanne ne date pas d’hier, bien ancrée dans une dynamique pluriséculaire mais déjà si jacobine. C’est au début du XIIe siècle que Louis VI le Gros demande la création d’un important marché pour nourrir les Parisiens face à l’accroissement du nombre d’habitant dans la capitale[1]. A cette fin, on demande aux paysans de produire « plus » (non pas pour « gagner plus »…) pour que le surplus de production entraîne une baisse des coûts et donne ainsi l’apparence du « bon marché » aux consommateurs. L’apparence du bon marché entraîne irrémédiablement des conséquences désastreuses pour les paysans car, s’ils doivent produire plus, ils doivent investir plus pour permettre cette production accrue ; et plus l’investissement est conséquent, plus la production pour compenser cet investissement doit être grande. C’est, au final, le cercle infernal, potentiellement entendable dans le secteur industriel, mais incompréhensible dans un monde agricole qui ne vit que de ce que donne la terre.
Les Halles de Paris ont tué les paysans, voilà pourquoi Rungis était visé il y a quelques semaines.
Le Ventre de Paris fait souffrir les entrailles des paysans… Antithèse de l’humanité, guerre silencieuse entre l’économie qui affame et l’homme qui nourrit.
La révolution industrielle, guidée par le modèle libéral anglo-saxon, n’a fait que renforcer cette incohérence. En effet, « pour produire plus, pour améliorer la productivité afin de soutenir la concurrence, il faut acheter à l’industrie […]. L’agriculteur devient un industriel sans le savoir, mais aussi sans le profit »[2].
Le paysan post-moderne, celui des 30 glorieuses, s’est engouffré dans la technicisation agricole qui lui a donné l’illusion d’une accélération de la réduction entre son investissement (à perte) et son profit.
Le remboursement devait avoir lieu, mais le modèle concurrentiel a continué de favoriser la course à l’excédent, et donc à la productivité, et donc à l’industrialisation… or, l’excédent n’a fait que provoquer la baisse des revenus paysans. Ces agriculteurs aveuglés ont cru alors en la PAC, mais elle ne fut que la compensation illusoire des déficits liés à la demande de surproduction, alors que l’ouverture au marché commun entraînait une recrudescence de la demande de la surproduction. La PAC fut un accélérateur, et même un moteur, du marché libéral dans le monde agricole, tout cela avec la bénédiction des instances supranationales[3].
On entend, depuis le début de la révolte paysanne, le monde agricole réclamer un « juste prix », conscient syndérétiquement d’une nécessité de la justice de la rétribution du travail et de la vente des produits agricoles.
Or, ce « juste prix » est fondamentalement impossible sur le marché actuel, de modèle libéral, contrairement à celui médiéval, de modèle réaliste :
« Il y avait une seule balance sur le marché médiéval. Sur le marché moderne, il y en a deux : la vieille balance censée exprimer le « juste prix », exclusif du profit, à l’abri des manœuvres, pour le paysan ; pour l’industrie et les services, la nouvelle balance, que les vieux théologiens du Moyen-âge eussent estimée dolosivement faussée, génératrice de profit »[4].
« Moyenâgeux » est un terme finalement résolument moderne…
Outre la justification de la part des hommes, par la justice distributive, au regard de la hiérarchie sociale, la philosophie classique et la scolastique médiévale ont parfaitement rappelé que cette distribution (des choses, des honneurs, des droits, et des « prix ») était intrinsèquement inique si elle ne s’appuyait que sur un système de forme hiérarchique, notamment au regard des dérives spéculatives et usurières que cette forme pouvait accepter. La chrématistique est ainsi dénoncée par Aristote dans l’Éthique à Nicomaque et dans les Politiques, notamment car l’argent ne saurait être une fin en soi, car il appelle un bien encore plus grand : soit plus d’argent, soit des biens que l’on peut acquérir au moyen de cet argent. Le Stagirite souligne ainsi l’irrémédiable injustice d’une économie dévoyée par la recherche de l’unique profit, tel que le marché l’entend finalement aujourd’hui, y compris dans le monde agricole :
« Ceux qui s’efforcent de mener une vie heureuse recherchent ce qui procure les jouissances physiques, de sorte que, comme celle-ci semblent dépendre de ce qu’on possède, toute leur vie, ils la passent occupés par l’acquisition de richesses, et c’est ainsi qu’on en est arrivé à cette forme de l’art d’acquérir, la chrématistique. […] Il est tout à fait normal de haïr le métier d’usurier du fait que son patrimoine lui vient de l’argent lui-même, et que celui-ci n’a pas été inventé pour cela »[5].
Dans cette critique de ce Parnasse capitalistique, « l’argent pour l’argent », il nous faut définir et comprendre ce que recherche le paysan, à savoir le « juste prix ». Il n’est pas le prix qui correspond à l’accord des parties ; il n’est pas le prix fixé par un pur consensualisme, ce dernier pouvant être fondé sur un écart abusif quant à la valeur réelle de l’objet, écart possiblement dû à plusieurs facteurs : ignorance de l’une des parties, rapport de force ou de domination, système économique vérolé par la perte des finalités, absence de recherche du Bien commun, etc. Le « juste prix » est déterminé grâce à l’équité, à la médiété, c’est-à-dire à la prise en compte de la nature des sujets et objets participant à la relation commerciale : il faut prendre en compte l’essence de l’acquéreur, celle du vendeur et celle de la chose objet de l’échange. Il y a donc tant l’objet que les sujets qui participent de la définition du « juste prix », dans un équilibre tâtonnant qui ne lèserait aucune des parties contractantes et s’appuierait sur la nature causale de l’objet. Le « juste prix » est le prix qui permet la réalisation de la justice commutative, c’est-à-dire « l’attribution à chacun de ce qui lui est dû »[6], et donc au paysan la rémunération proportionnelle de son travail et des fruits de celui-ci. Payer un « juste prix », c’est réaliser un acte de justice.
Soumettre les prix agricoles aux fluctuations du marché rend donc impossible le « juste prix » car cela ne permet jamais, au regard de la nature des biens agricoles et du travail du paysan, d’atteindre la proportionnalité, le prix n’étant fixé que par un modèle économique consensualiste dont la finalité n’est pas de favoriser le Bien commun mais uniquement d’accroître le capital.
La solution serait alors, pour l’ensemble du monde paysan, de renverser le paradigme libéral dans lequel le monde agricole s’est fourvoyé : quitter le marché moderne et les bourses mondiales, et revenir à l’équité économique.
Malheureusement, aujourd’hui, le monde paysan subit deux modèles désormais pluriséculaires, deux idéologies qui ne sont que les revers d’une seule et même médaille, l’une matérialiste et utilitariste, l’autre idéaliste et moraliste : d’une part, l’idéologie du libéralisme économique, qui ne fonctionne que pour les produits manufacturés et industriels, mais qui est aux antipodes du secteur primaire. Le calque du modèle industriel imposé au modèle agricole pour donner l’illusion consumériste du « bon marché » est mortifère car il empêche le paysan de vivre. D’autre part, l’idéologie écologiste, de plus en plus terrorisante, voire terroriste, minoritaire et cependant omnipotente, religieusement encadrée par la grande papesse Greta 1ère, par le collège cardinalice des Pascal Canfin, Sandrine Rousseau, Hugo Clément, Marie Toussaint, Theresa Reintke, par le grand tribunal de la rote internationale du GIEC, la grande Inquisition des Soulèvements de la terre et de L214, les confessionnaux des ONG où l’on se rachète une conscience, les prêtres EELV et ceux des programmes anxiogènes de l’Éducation nationale, les nouveaux livres de l’Apocalypse et du réchauffement, les intégristes de la FSSXR (Fraternité Sacerdotale Sainte Extinction Rebellion), les prescriptions alimentaires au quinoa désaviandé, les normes familiales du « sans enfant », les intégristes dji-zadistes, et l’œil du GADLU qui nous observe par le trou de la couche d’ozone… L’œil était dans la tombe et regardait Caïn… Cette idéologie n’empêche pas le paysan de vivre : elle le tue.
Les paysans cultivent la terre dans laquelle nos pères dorment à jamais. Travaillant la Patrie, ils sont la vraie Nation. Et face à ces mourants, face aux cris du labour et au sang des sillons, l’ultratechnocratie, le moteur sans cause : l’a-patrie européenne.
Pierre-Louis Boyer
Doyen de la Faculté de Droit, des sciences économiques et de gestion
Maître de conférences HDR
[1] R. Delatouche, « Quelques réflexions sur une histoire des Halles de Paris », Académie d’agriculture de France. Extrait du procès-verbal de la séance du 9 juin 1964, p. 854-867 ; « Réflexions complémentaires sur une histoire des Halles de Paris », Académie d’agriculture de France. Extrait du procès-verbal de la séance du 19 juin 1968, p. 692-702. Voir aussi ses quelques lignes dans R. Delatouche, La chrétienté médiévale, Paris, Téqui, 1989, p. 119, ainsi que dans Le Moyen Âge pour quoi faire ?, op. cit., p. 162-168.
[2] R. Delatouche, La chrétienté médiévale, op. cit., p. 126.
[3] R. Delatouche, Ibid., p. 160 : « Le libéralisme, l’économie, de moyen, est devenue fin. La servante se révèle maîtresse. Elle asservit l’homme et la société qu’elle est censée servir […] La France, l’Europe, ne sont plus qu’une maison de commerce engagée dans la guerre économique […] La communauté internationale est un champ clos où s’affrontent les puissances économiques ».
[4] Ibid., p. 125. On retrouve les mêmes réflexions dans Le Moyen Âge pour quoi faire ?, op. cit., p. 169-174.
[5] Aristote, Les politiques, I, 9, 1257-b et I, 10, 1268a.
[6] Digeste, 1,1,10 ; Platon, La République, 322c.