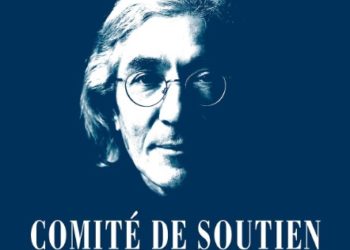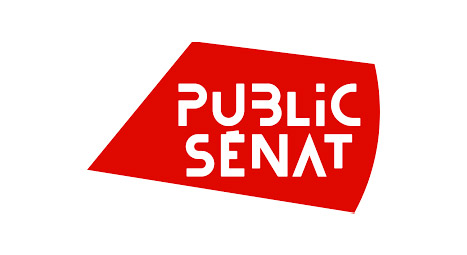La Résistance, si elle se caractérise par ses objectifs et ses modalités d’action, renvoie aussi à la question des valeurs qui motivent ses acteurs et ses actrices. Cet article examine de manière synthétique la question des valeurs qui sous-tendent l’engagement résistant en France durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945) à partir de trois axes d’étude : les valeurs motivant l’engagement, celles qui imprègnent le programme visant à réformer les structures sociales et politiques à la Libération et enfin la question de la violence.
De la défaite de 1940 émerge une nation à la dérive. L’effondrement des valeurs républicaines est acté le 10 juillet 1940 : à la IIIe République se substitue la dictature antisémite du maréchal Pétain qui fait le choix de la collaboration. L’été 1940 voit l’effacement des valeurs et des symboles traditionnels tandis qu’émerge une géographie politique inédite. La France est divisée en sept zones, de nouvelles frontières mettent fin à l’unité territoriale. Au même moment s’installe l’administration militaire allemande et italienne. Dans ces circonstances, faut-il le répéter, résister n’est pas une évidence. La Résistance est d’abord un choix, une réaction épidermique à une situation inacceptable et inconcevable. Elle est ensuite une « morale en action » selon l’expression de l’historien Laurent Douzou, un agir écrit de son côté l’historien François Marcot. L’exode, « plébiscite avec les pieds », n’est pas un mouvement de frayeur d’un peuple lâche, elle est la marque du refus, notamment pour les populations de Belgique et des départements du nord, de subir une deuxième occupation et son cortège de violences en une génération. Le passage à Londres n’est pas une fuite éperdue à travers la Manche – d’ailleurs d’autres font le voyage dans l’autre sens – elle est une projection vers l’avenir pour des individus qui comprennent, déjà, que la guerre n’est pas réglée par la seule bataille de France, pour reprendre les mots du général de Gaulle. « Celui qui ne se rend pas à raison contre celui qui se rend » écrit Edmond Michelet dans son tract du 17 juin 1940 alors que Jean Moulin essaye de se suicider pour ne pas signer un texte infâme que les Allemands tentent de lui imposer. La Résistance, enfin, est planificatrice. Elle doit s’inscrire dans le temps long, celui de l’attente d’une Libération hypothétique dont personne ne connaît le jour et l’heure mais qu’il s’agit de préparer, non seulement militairement, mais aussi politiquement. Et ce, en dépit de la traque des services de répression allemands, italiens et vichystes amenant, là-aussi, son cortège de violences.
Dans ces conditions, pourquoi résister ? Quelles sont les valeurs de ces hommes et de ces femmes qui provoquent le passage à l’acte et entretiennent leur volonté en dépit des catastrophes et des coupes drastiques opérées dans leur rang ? Pourquoi faire face à la capture, la torture, la déportation et la mort, issues probables compte-tenu de l’asymétrie de la lutte ce dont tous et toutes sont conscients ?
La recherche historique interroge de longue date la question des valeurs et des projets, constitutifs d’une « identité résistante » ou plutôt d’identités résistantes, au pluriel, qui se combinent en dépit de leur grande diversité. L’approche « psychologisante » ou l’élaboration de statistiques trouvent rapidement leurs limites. Contrairement à un lieu commun, la Résistance a laissé des archives, la lutte clandestine a généré par exemple l’apparition de tracts ou de journaux clandestins édités par des mouvements de résistance qui affirment leurs valeurs, leurs espoirs et leurs motivations afin de susciter chez leurs lecteurs le rejet de la situation présente. Plus compliquée est cette approche dans le cas des réseaux qui n’ont pas pour objet l’action politique mais l’accomplissement d’objectifs militaires. Les dossiers personnels des agents ne disent pas grand-chose de leurs motivations profondes d’autant qu’ils sont constitués après la guerre dans le cadre des procédures d’homologation. Les témoignages, édités à compte d’auteur, publiés après la guerre ou recueillis par les enquêteurs de la Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France (CHOLF) puis du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale (CHDGM) conservés aujourd’hui aux Archives nationales, sont précieux mais livrent un regard rétrospectif. Le discours doit être replacé dans le contexte des enjeux et des tensions de la sortie de guerre. Sans prétention aucune à l’exhaustivité, trois points sont ici envisagés sous forme synthétique : des valeurs qui sous-tendent l’engagement, celles constitutives de l’horizon d’attente, celui de la Libération, et des programmes qu’elles impulsent, enfin la question du rapport à la violence et à la lutte armée.
Pourquoi s’engager ?
Les résistants, hommes et femmes, ne sont pas semblables aux soldats des tranchées de la Première Guerre mondiale. Il ne peut y avoir de tensions entre « contrainte » et « consentement » dans la lutte clandestine car personne n’est obligé d’y risquer sa vie. L’expression « volontaire pour une mission en France » apparaît ainsi significativement dans tous les états de service consultés au moment de l’homologation des agents parachutés depuis Londres. La plupart des résistants sont bénévoles, le salariat n’est qu’un recours ultime pour ceux qui plongent dans la clandestinité totale afin de continuer la lutte en satisfaisant leurs besoins. L’engagement est la conséquence d’une volonté farouche et inébranlable de « faire quelque chose » et de le faire avec enthousiasme. Autant les témoignages que les écrits ou les derniers mots des fusillés dans les lettres adressées à leur famille ou dans un ultime « Vive la France », mettent l’accent sur la dimension patriotique qui anime l’action résistante. « Il fallut la chute, l’écrasement, la honte, le désespoir pour que la Patrie fût révélée à chacun d’entre nous » écrit Auguste Vistel (Alban) dans son ouvrage Héritage spirituel de la Résistance. Le patriotisme est une valeur de référence. Peuvent s’y reconnaître les nationalistes, les catholiques, les républicains, le mouvement ouvrier, communiste ou socialiste, ou le monde paysan quand bien même les doctrines en la matière peuvent être divergentes voire contradictoires.
Les résistants n’ont pourtant pas le monopole de l’invocation du patriotisme pour justifier leur engagement : Pétain fait ainsi « don de sa personne à la France » et la plupart des journaux collaborationnistes mettent en avant que collaborer est aussi une œuvre patriotique servant la révolution nationale.
Le patriotisme de la Résistance est complété par d’autres valeurs de référence. La religion est l’une d’entre elles, mais dans la majorité des cas elle ne suffit pas. Le général de Gaulle est catholique, tout comme la plupart des officiers de la France libre, mais il ne justifie pas son appel à la résistance par des références religieuses. C’est un truisme de dire que les communistes ne s’engagent pas au nom d’une religion séculaire. Le fait est que la foi catholique ou protestante est, sinon un frein, du moins un indicateur malaisé à utiliser comme motivateur du passage à l’acte. La désobéissance envers le maréchal Pétain et le régime de Vichy qui promettent le retour à des valeurs conservatrices à l’opposé de « l’esprit de jouissance » qui aurait mené la France à sa perte ou encore le soutien initial du clergé n’incitent pas les catholiques à désobéir. Les valeurs portées, en revanche, par les religions, la solidarité, l’aide aux plus démunis ou aux populations persécutées, motivent des engagements. La suppression des libertés syndicales provoque l’indignation des démocrates-chrétiens. Les jésuites, eux, expriment leur hostilité envers le paganisme nazi. La résistance catholique est impulsée par la fondation du mouvement Témoignage chrétien à Lyon tandis que les persécutions antisémites incitent les catholiques et les protestants à participer fortement au sauvetage des juifs menacés. Les juifs ne sont pas des acteurs passifs attendant d’être déportés ou sauvés. L’engagement résistant est précoce notamment au sein des mouvements et des maquis. Les organisations juives, qui regroupent notamment les juifs immigrés d’Ukraine, de Pologne ou plus largement d’Europe centrale et orientale, mettent l’accent sur la valeur de solidarité face aux persécutions puis, notamment dans le cadre de la main-d’œuvre immigrée avant de s’orienter vers l’action politique et la lutte armée. « Vous avez hérité la nationalité française, nous l’avons méritée » déclare Missak Manouchian face à ses juges. L’engagement des juifs immigrés, et plus largement des étrangers polonais, espagnols, tchécoslovaques… dans la Résistance en faveur d’un pays qui n’était pas celui de leur naissance et qui ne les avait pas nécessairement naturalisés, montre que les valeurs qui sous-tendent cet engagement dépassent la seule question de la souveraineté et des identités nationales.
À ces conceptions s’ajoutent celles relevant d’idées politiques anciennes ou nouvelles qui peuvent apparaître comme structurantes mais dont l’examen laisse apparaître de fortes divergences. La valeur républicaine n’est pas unanimement partagée d’autant que le discrédit pèse sur la IIIe République. Il faut attendre l’automne 1941 pour que Charles de Gaulle entame son « tournant républicain ». L’idée républicaine ne figure pas dans sa déclaration aux mouvements publiée le 24 avril 1942. Ce n’est que le 27 mai 1942 que le chef de la France libre se présente en conférence de presse comme « résolu à recouvrer intégralement la souveraineté nationale et la forme républicaine du gouvernement ». Il faut, toutefois, se garder de faire des raccourcis. Certes, les premiers chefs de réseau du BCRA (Maurice Duclos, Honoré d’Estiennes d’Orves, Pierre Fourcaud et Gilbert Renault) sont engagés dans des mouvements d’extrême-droite ou ligueurs avant 1939. Leur participation précoce dans la Résistance n’est donc pas motivée par la défense des valeurs républicaines qu’ils ont, peut-être, été ravis de voir s’écrouler. Toutefois, la sociologie de la France libre, établie par Jean-François Muracciole, montre que la droite nationaliste, ligueuse et monarchiste y est très minoritaire, à peine 4,2 % des Français libres et seulement 2 % d’entre eux militent dans un parti politique d’extrême-droite avant-guerre. Au contraire, les premiers Français libres sont majoritairement des hommes jeunes et peu politisés. En France, l’engagement résistant ne signifie pas toujours coupure immédiate avec les valeurs de Vichy.
La vichysto-résistance est un phénomène qui ne peut se réduire à l’exemple souvent caricaturé de la francisque de François Mitterrand.
Elle illustre, surtout, la complexité des comportements, le phénomène de « penser-double » et les ambivalences mis en avant par les travaux de Pierre Laborie, ainsi que le fait que les résistants ne sont pas en décalage avec la société de leur temps. Le fait est que des clarifications s’opèrent au plus tard en 1942. Tous les résistants ne défendent pas les valeurs du gaullisme, cette « certaine idée de la France ». Robert Belot a montré les ressorts de cette « résistance sans De Gaulle » qui ne se résument pas aux ralliés du général Giraud. Il n’empêche que le gaullisme est un facteur majeur d’attraction dans le cadre du recrutement en France, pas toujours sur des bases honnêtes. Dans le sud de la France, Frank Arnal n’hésite pas à se présenter comme « capitaine de la France libre » pour recruter des agents, alors que son réseau, homologué sous le nom de F2, dépend des services de renseignement polonais.
Il est indubitable que l’antifascisme et la haine du nazisme entraînent des ralliements. Dans ses mémoires, l’australienne Nancy Wake raconte un voyage à Vienne puis à Berlin dès le printemps 1933 pour observer par elle-même la situation après l’arrivée des nazis au pouvoir :
« On m’a souvent interrogée sur le pourquoi de mon engagement contre les Allemands. C’est simple, il remonte à des scènes qui me laissèrent non seulement révoltée, mais aussi horrifiée. Ce fut à cette époque que je pris la résolution de faire, si l’occasion m’en était donnée, tout ce que je pouvais – que ce fut important ou modeste, insensé ou dangereux – contre cette pourriture. Quand la guerre gagna la France, puis lors de l’Occupation, le parti à prendre me parut simple. »
Transparaît le refus catégorique de valeurs fondées sur des inégalités et des violences à caractère racial. Nancy Wake a vingt-trois ans quand elle se rend en Allemagne, et elle y prend effectivement conscience que l’ordre du monde ne s’accorde pas toujours avec le désir d’une vie insouciante. Ses valeurs universalistes et cosmopolites se concilient mal avec un projet politique qui envisage le monde comme une perpétuelle guerre des races et qui vise à protéger une prétendue « germanité » biologiquement menacée. Cela dit, il n’existe pas de déterminisme dans le parcours de Nancy Wake, du moins pas autant qu’elle le présente. Elle n’est pas résistante avant la lettre dès 1933. Entre le rejet du racisme et de l’antisémitisme qui se déploient en Allemagne et l’engagement résistant plusieurs années plus tard, il y a un fossé qui ne peut être comblé que par des circonstances exceptionnelles.
De manière générale, l’antifascisme n’est pas une valeur invoquée immédiatement par l’ensemble de la Résistance.
Si Gabriel Péri dénonce le régime nazi, le PCF, contraint par le pacte germano-soviétique, dénonce d’abord le régime de Vichy sans s’en prendre directement au IIIe Reich. Évitons là aussi des raccourcis : tous les communistes ne cherchent pas à faire reparaître L’Humanité avec l’accord de l’occupant, certains s’engagent dès 1940 dans la Résistance. C’est la mondialisation de la guerre, l’offensive sur l’URSS de juin 1941, l’unification de la Résistance entre 1942 et 1943 qui permettent d’observer un lien désormais plus étroit entre le combat contre l’occupant et l’engagement antifasciste symbolisé par l’enrôlement des anciens brigadistes d’Espagne dans les FTPF.
Des valeurs pour reconstruire
La Résistance est planification et projection dans le temps. L’horizon d’attente d’une Libération entraîne une réflexion sur les structures politiques et sociales à mettre en place afin d’assurer la transition. Une valeur est revendiquée par de Gaulle, les résistants intérieurs et Vichy : la légitimité. Pétain a pour lui de pouvoir prétendre représenter la continuité institutionnelle, ce qui explique aussi qu’il propose, peu avant la Libération, au général de Gaulle une grande cérémonie sous l’Arc de triomphe où il lui aurait remis symboliquement ses pouvoirs. Il garde, un temps, la main sur l’Empire. En 1944, la seule colonie à n’être pas ralliée aux Français libres est l’Indochine. En juillet 1940, Pétain dispose toujours d’une flotte de guerre, dont une partie est détruite à Mers-el-Kébir et l’autre se saborde finalement à Toulon. Dernier point, « l’opinion publique » est, selon l’expression de Pierre Laborie, d’abord « ambivalente » avant de se détourner progressivement du vieux chef. La crise de la légitimité du maréchal Pétain apparaît au grand jour en novembre 1942. Charles de Gaulle, de son côté, s’efforce de construire les contours d’un État alternatif, s’attaquant sans relâche à la légitimité de Vichy notamment par l’intermédiaire de René Cassin. La question prend plus d’ampleur entre le printemps et l’été 1944 : débarrassé des velléités du général Giraud, il constitue depuis Alger le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) soutenu par une assemblée provisoire. En France se prépare l’installation des nouveaux pouvoirs incarnés par les comités de Libération et les commissaires de la République. De Gaulle, finalement parvenu dans Paris libéré, refuse de proclamer la République, arguant qu’il en a perpétué les valeurs. Les résistants, eux, affirment être l’émanation d’un tissu social meurtri, ils sont légitimes pour le reconstruire et défendent leur légitimité à parler à la France libre d’égal à égal, ce qui se traduit aussi par le voyage à Londres des principaux chefs des mouvements de résistance, qui demeure une étape incontournable. Dernier point, cette valeur pousse les chefs de réseaux à se faire explicitement reconnaître par leurs services secrets respectifs comme le référent principal de leur organisation, ce qui se traduit par la remise de moyens financiers et de moyens de liaison qui leur permettent de renforcer leur pouvoir. Ce souci de légitimité est toutefois à double tranchant puisqu’il peut aboutir à la paralysie.
Il provoque, aussi, des débats chez les militants socialistes parisiens, désireux d’entrer dans la lutte clandestine, mais qui refusent de conserver le nom de « Parti socialiste » car ils « ne savaient pas ce que pensaient les socialistes dans toute la France ».
Dans ce cadre rapidement résumé, sur quelles valeurs reposent les programmes à mettre en œuvre à la Libération ? Les mouvements de résistance sont prolixes en la matière dans les pages des tracts puis des journaux clandestins dès les premiers mois de l’Occupation. Pour son premier numéro de décembre 1941 publié en zone rattachée, Socialisme et liberté proclame : « il ne suffira pas de nettoyer le sol de la patrie des espions, des traîtres, des collaborationnistes et autres agents de l’étranger, il faudra surtout élaborer un programme dont le détail variera naturellement en fonction des circonstances ». Dans le contexte, ce texte est en avance sur son temps, et donc inaudible. Le principe de l’épuration est néanmoins déjà posé. Elle est à la fois initialement envisagée comme un châtiment et un acte purificateur. Sans entrer dans un sujet bien balayé par l’historiographie, notons que sont finalement pourchassés ce qui a « porté atteinte à l’unité nationale » et les comportements jugés « indignes ». L’épuration extrajudiciaire s’exerce ainsi contre les « mauvais Français », et les « mauvaises Françaises ». Dans le cas de ces dernières elle prend une dimension éminemment virile par l’intermédiaire des tontes dont sont victimes celles accusées d’avoir entretenu des relations sexuelles avec l’occupant. L’épuration judiciaire, elle, s’exerce au nom du rétablissement des valeurs républicaines. De manière générale, les journaux clandestins écartent toute idée de retour à « l’avant » et expriment la nécessité d’un renouveau fondé, néanmoins, sur des valeurs en héritage. On connaît la volonté des collaborationnistes parisiens d’épouser le vœu de l’ambassadeur allemand Otto Abetz de diviser les cultures politiques, donc de brasser large et d’invoquer les grands ancêtres et les valeurs de droite comme de gauche. La Résistance, aussi, s’efforce de présenter sa lutte dans la continuité directe d’une histoire des mouvements sociaux et des révoltes nationales contre l’oppression, afin de promouvoir les valeurs révolutionnaires héritées du XIXe siècle, au premier rang la Liberté.
Le 1er mai 1943, pour faire pièce à la récupération de cette date symbolique par Vichy, Libération-Sud célèbre « le jour de fête et de lutte pour la classe ouvrière » et termine par la citation fameuse de Danton : « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace et la France sera sauvée ».
C’est entre 1943 et 1944 que la dimension programmatique de la Résistance s’affirme. Le 15 mars 1944 est adopté à l’unanimité le « Programme d’action de la Résistance » connu sous le nom de « programme du CNR » ou « les Jours heureux ». Les travaux de Claire Andrieu indiquent que l’initiative et le résultat sont redevables à l’activisme des socialistes, Léon Blum en tête dès le mois d’août 1942, puis par l’intermédiaire du Comité d’Action Socialiste (CAS), et du journal clandestin Le Populaire dans son édition de juin 1943 en zone sud. Le programme commun est le fruit d’un consensus : un premier jet soumis au CNR par André Philip, commissaire national à l’Intérieur en juillet 1943 est repoussé par les délégués des partis de droite et les communistes. Les représentants de la CGT clandestine proposent un « programme d’action », le mouvement communiste Front national enchaîne sur un « projet d’une charte de la Résistance » en novembre 1943 sur lequel les discussions s’engagent et qui comprend un volet inédit, intitulé « action immédiate ». Un texte final, fruit d’un compromis négocié âprement, est adopté le 15 mars 1944. La première partie concerne les mesures d’action immédiate, c’est-à-dire les moyens à mettre en œuvre pour garantir le retour à la souveraineté nationale. Il met ensuite en valeur les réformes ancrées à gauche, avec le concept d’État-providence et en rupture avec le capitalisme : politiques (rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse), économiques (nationalisations), sociales et syndicales (réajustement des salaires, sécurité sociale…). Toutefois, son audience demeure faible et la droite s’en détourne dès la Libération. Claire Andrieu souligne qu’il s’agit « d’un texte conservateur par ses silences » notamment du fait de la présence de Paul Bastid, ministre radical sous le Front populaire. Rien sur une éventuelle Constitution et surtout maintien de l’opposition, déjà portée par les radicaux-socialistes avant 1939, à toute avancée concernant le droit de vote des femmes, que de Gaulle a pourtant défendu dans sa déclaration aux mouvements d’avril 1942 et qu’il accorde par ordonnance le 21 avril 1944. La construction d’une nouvelle France devait déboucher sur l’extension des droits. Le droit de vote des femmes est absent du programme du CNR qui réclame donc le retour à un suffrage universel qui ne l’était pas. En dépit de leur forte présence dans les rangs de la Résistance, de leur lutte menée à égalité avec les hommes dans l’armée des ombres et du peu de cas fait par les bourreaux du sexe de leurs victimes, la Libération est bien ingrate envers les femmes qui subissent le retour des normes d’une société fondée sur l’inégalité entre les sexes.
La violence est-elle une valeur de la résistance ?
La mémoire de la Résistance retient la figure du résistant masculin, maquisard viril opérant des sabotages surdimensionnés et abattant des soldats nazis en cadence. Il faut apporter des précisions connues de longue date.
La question de la violence est inséparable de celle de la lente acceptation de la lutte armée.
L’unification des formations paramilitaires constituées par les mouvements de zone sud, ainsi que la séparation entre les branches militaires et politiques des mouvements, font partie de la mission confiée à Jean Moulin lorsqu’il est parachuté dans les Alpilles le 1er janvier 1942. Il organise une Délégation générale pour assurer la liaison entre la France libre et les mouvements de résistance intérieure de zone sud qu’il doit unifier en vue de la fourniture d’armes et de matériels. La constitution de l’Armée secrète (AS) est la conséquence d’une évolution majeure dans la stratégie résistante : le passage à la lutte armée. La lutte armée, et l’usage de la violence qu’elle suppose, ne sont pas des valeurs originelles de la Résistance. La lutte armée ne va pas de soi dans un pays pétri d’une conception républicaine qui préfère désormais le suffrage universel, même strictement masculin, au droit à l’insurrection révolutionnaire. Le mouvement ouvrier, antimilitariste et largement gagné par le pacifisme jaurésien dans toutes ses nuances, a également repoussé la violence armée comme forme de lutte dans les années 1930. Les attentats perpétrés par les communistes dans le cadre de la lutte armée décidée après juin 1941, notamment celui du métro Barbès par le colonel Fabien le 21 août 1941, provoquent réticences et débats, aussi à cause du coût humain consécutif aux fusillades dans le cadre de la politique des otages. La violence est surtout portée par l’occupant allemand qui accentue la répression contre la Résistance et torture ses captifs, hommes et femmes sans distinction, pour qu’ils livrent leurs contacts. Entre temps, la question de la lutte armée rebondit avec le développement du phénomène maquisard. Fabrice Grenard a récemment montré que l’histoire des maquisards ne peut être réduite à ses représentations postérieures. De la naissance de ces premiers camps peuplés d’ouvriers souhaitant échapper à la Relève dès l’automne 1942, au « séisme » du STO en février 1943 qui accélère le peuplement réfractaire des zones rurales et montagnardes, l’histoire des maquis est complexe. Nés en dehors de la Résistance intérieure, soutenus par des chefs comme Henri Frenay, mais objet d’interrogations voire d’hostilité de la part des représentants de la France libre, Jean Moulin en tête, les maquis finissent par être considérés comme des atouts maîtres dans la stratégie alliée… à condition d’être organisés, d’être utilisés à bon escient et que les réfractaires soient « transformés en combattants ».
La violence n’est pas une valeur strictement virile. La lutte clandestine peut l’exacerber chez les hommes comme chez les femmes. Nancy Wake raconte :
« Il n’y avait rien de violent dans ma nature avant la guerre, cependant, les années passant, je me découvris différente. Mais ma détermination envers l’ennemi ne me faisait pas pardonner la brutalité et la torture chez les nôtres. Un jour, on m’informa discrètement qu’une troupe proche retenait trois femmes, dont l’une était une espionne allemande. J’exigeai la garde de ces trois malheureuses, malmenées et traitées comme des prostituées […]. Les deux Françaises ne posaient pas de problème, mais on refusait de lâcher l’Allemande. Je l’interrogeai. Elle avoua avoir été envoyée afin d’espionner le maquis pour le compte de la Gestapo. À contrecœur, je l’informai qu’elle serait fusillée, il n’y avait pas d’alternative dans ces circonstances. D’abord, les hommes refusèrent de tirer sur une femme, puis quand ils comprirent que je le ferais moi-même, ils formèrent le peloton. Elle cracha dans ma direction et cria Heil Hitler avant de mourir. Je demeurai absolument impassible. Comment était-ce possible ? C’était simple. Je me souvenais de Vienne, de Berlin, des juifs. Je me rappelai cette Française, enceinte de sept mois, ligotée à un poteau, éventrée à la baïonnette par un soldat allemand sous mes yeux. Son enfant de deux ans hurlant, agrippée à sa main, on la laissa agoniser avec son bébé. »
Hommes et femmes en résistance n’acceptent pas nécessairement de mettre à mort d’autres êtres humains, même des traîtres ou des Allemands. Pearl Witherington, une autre agente du SOE, explique n’avoir jamais pu tirer sur quelqu’un de sang-froid, au nom de valeur selon elle consubstantiellement féminine, parce que les femmes donnent la vie mais ne la prennent pas sauf pour se défendre. La mort donnée dans la Résistance a suscité un large imaginaire, transcrit dans une fameuse scène du film L’Armée des ombres où un traître est étranglé en gros plan. Dans les faits, l’exécution du traître réussit rarement du premier coup quel que soit le sexe de l’exécuteur. Renoncement, poisons inefficaces, convictions religieuses érigeant en dogme l’interdit du meurtre : prendre la vie ne va pas de soi. Ce rejet traduit l’expression d’un impératif catégorique qui serait consubstantiel à son genre selon Pearl Witherington. Nancy Wake donne l’ordre d’exécution « à contrecœur », à l’exemple de l’ensemble des chefs de réseau qui usent d’un droit de vie ou de mort sur leurs agents ou sur des traîtres identifiés. Personne ou presque n’est avide de faire couler le sang. George Starr, chef du réseau SOE Wheelwright, soupçonné d’avoir pratiqué la torture sur des prisonniers allemands, suscite l’indignation de sa hiérarchie. Ceux qui exécutent la cible le font parce que c’est impératif pour la survie du groupe ou pour remplir un objectif de guerre.
Tuer en résistance n’est pas acceptation de la violence comme valeur, c’est un impératif hypothétique, qui vise une finalité qui n’a pas de présupposé moral mais un objectif pragmatique.
° ° °
S’engager dans la Résistance, c’est donc faire appel à un système de valeurs qui font sens et guident l’action, sans qu’aucune ne suffise à elle seule à expliquer les comportements hostiles à l’occupant ou à Vichy. C’est aussi mobiliser des valeurs pour reconstruire une société nouvelle. La Résistance parle à notre présent, ses valeurs sont mobilisées pour célébrer des comportements individuels et collectifs jusqu’aux crises contemporaines. N’est-il pas question, à cette heure, de Volodymyr Zelensky, « chef de la résistance ukrainienne » ? De civils, hommes et femmes prenant les armes pour lutter contre l’envahisseur et possible occupant, assimilés non à une armée régulière, mais bien à la « résistance » ? Les lignes droites n’existent pas bien sûr et les analogies sont davantage significatives de nos inquiétudes, de nos questionnements du moment et des références qui imprègnent nos représentations et notre univers mental. Cette mobilisation lexicale traduit toutefois une constante, celle du maintien d’un dialogue entre passé et présent et d’un régime d’historicité singulier. L’émotion provoquée par la disparition de Daniel Cordier ou Hubert Germain en est un signe. L’instrumentalisation de la Résistance est aussi une constante politique et un lieu de passage encombré, tous et toutes se mettent en scène en récipiendaire de valeurs défendues dans une lutte asymétrique. Il y a toutefois des épisodes surprenants, tel celui d’un candidat à la présidentielle française célébrant des maquisards morts aux Glières, pourtant assassinés par un régime qu’il s’efforce de réhabiliter.
La disparition progressive des derniers témoins nous engage, aussi, à réfléchir dès à présent à la transmission de ces valeurs, sans oublier que, pas plus que la Résistance en général, ces dernières furent uniques ou consensuelles et que les tensions et les rancœurs nées de la guerre appartiennent encore à notre présent.
Guillaume Pollack
ATER en histoire contemporaine (UPEC, CRHEC)
Chercheur partenaire (Paris 1, SIRICE)
Auteur de L’armée du silence. Histoire des réseaux de résistance (1940-1945) à paraître aux éditions Tallandier en 2022