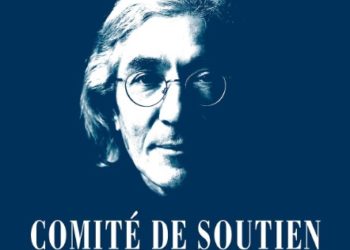Le black bloc semble être une nouvelle forme de la violence manifestante contemporaine dont l’apparition sur le devant de la scène médiatique interroge les sociétés démocratiques. Les méthodes utilisées par ces militants se revendiquant pour certains du marxisme, pour d’autres de l’anarchisme, semblent traduire un renouvellement des pratiques d’affrontement urbain tout en s’inscrivant dans des filiations anciennes de contestation générale du système capitaliste. Si nouvelle quelle puisse apparaître, la violence dans les manifestations est loin d’être un phénomène nouveau, elle s’inscrit majoritairement dans un continuum de l’action révolutionnaire. C’est cet héritage ancien, que les manifestants d’aujourd’hui cherchent sans cesse à récréer.
Une composition sociale diverse
Il convient de rappeler que le black bloc est d’abord et avant tout une pratique manifestante, même si la coloration politique qui existe est plutôt marquée à gauche. Son origine a été déformée. Initialement, le black bloc est le nom d’un groupe anarchiste de Frankfurt, le Schwartz block, qui manifestait à visage découvert. Rapidement, l’utilisation du terme change, les policiers allemands qualifient les groupes autonomes et/ou libertaires qui manifestent le visage masqué contre les expulsions d’appartement.
Le mot connaît une réappropriation positive chez les manifestants au tournant des années 2000 avec les premiers blocs qui forment dans les manifestations altermondialistes le black bloc prenant sa tournure actuelle. Aujourd’hui, le black bloc représente des groupes anonymes, de tailles variables, formés de plusieurs centaines de personnes, femmes et hommes, se masquant le visage et se couvrant de vêtements noirs. Il se constitue et se défait au gré des rassemblements. Son objectif premier est de défier l’État et les institutions pour les faire reculer symboliquement en détournant le cours d’une manifestation, en affrontant leurs représentants officiels ou en s’en prenant aux symboles de la société de consommation, laissant derrière lui ses traces comme des slogans anticapitalistes rédigés au fil des dégradations qui s’inscrivent souvent dans une veine sarcastique comme cela a pu être le cas lors du 1er mai 2018 ou de la journée du 16 mars 2019 et de la destruction de certaines boutiques des Champs Élysées.
Si des appels à l’émeute urbaine circulent et peuvent être relayés, ils ne sont pas signés et la tenue noire renvoie à cette même volonté d’anonymat. Les black blocs, sauf exception, ne revendiquent jamais ouvertement leur participation, comme pour répondre à l’individualisation de la société marchande. Pour fonctionner et se mettre en ordre de marche, le black bloc bénéficie de la bienveillance d’une partie des autres manifestants qui, sans prendre part aux affrontements ou aux dégradations, protègent sa formation.
Dans leur immense majorité les émeutiers appartiennent aux mouvances qui composent la gauche radicale, comme il s’agit de groupes affinitaires il n’existe pas de parti ou de mouvement structurant les groupes. Ils peuvent appartenir à des nébuleuses variées : antifascistes radicaux, membres de collectifs contre les violences policières, aide aux migrants, écologie radicale, collectifs féministes, groupes de « solidarité internationale », avec les Palestiniens et les Kurdes, mais aussi club d’amateurs et de supporters de foot – voire de sport de combat et dernièrement Gilets jaunes ayant adopté ces pratiques.
Ces formes de militantisme expriment les continuités et les mutations de la culture anticapitaliste, dont la composition sociale est diverse, loin des représentations des surdiplômés.
Ces sédiments reposent sur les cultures musicales du punk rock jusqu’au rap et à l’électro. Les éléments communs, plus classiques, sont basés sur la consultation de sites internet, la lecture d’ouvrages venant de maisons d’édition souvent underground et l’existence de réseaux sociaux publics et de messageries cryptées.
Dans ces cortèges, plusieurs générations cohabitent, la tradition de l’émeute urbaine se transmettant de génération en génération. En effet, ils sont indirectement les héritiers des manifestations des années 1970.
Les militants d’aujourd’hui cherchent à reprendre le flambeau
Les références historiques témoignent aussi de ce patchwork voire de ce potlatch idéologique. La Révolution française et la Commune de Paris restent les références incontournables comme en témoignent les graffitis. Les slogans utilisés soulignent son caractère bigarré où se mêlent le vocabulaire propre aux banlieues, les clins d’œil aux séries télévisées, mais aussi des reprises d’aphorismes de René Char tel celui inscrit à plusieurs reprises sur les murs : « agir en primitif, prévoir en stratège ». Ces militants recréent une geste révolutionnaire mobilisant le passé comme moyen d’action.
Ces violences manifestantes sont depuis la Révolution française un phénomène récurrent. Dès l’origine, la violence a été considérée par les organisations ouvrières comme pouvant accoucher du Grand soir. Dans ses premières années, le syndicalisme prône l’action directe et la confrontation systématique avec l’État et le système capitaliste. Par la grève, par l’affrontement, par l’action symbolique, les masses doivent s’éveiller. L’imaginaire culturel de ces militants s’incarne dans le renversement de l’ordre bourgeois : la chanson comme la littérature et la presse révolutionnaire évoquent la guerre de classe à venir à l’image de la chanson « Le Premier mai sans flicaille ce n’est plus un premier mai » datant du début du siècle.
Avec les bolcheviques la violence de rue prend un caractère organisé. Des explosions de colère populaire spontanée existent, comme en 1927, lors des manifestations de protestation contre l’exécution aux États-Unis des deux anarchistes italiens Sacco et Vanzetti. À Paris, des grands boulevards jusqu’aux Champs Élysées, des barricades sont érigées, des magasins pillés et les forces de l’ordre prises pour cible.
En dehors de cette manifestation, le Parti communiste canalise la violence manifestante tout en l’exaltant. Il sublime l’idée d’un affrontement entre manifestants et forces de l’ordre. Le titre de la revue proche du PCF est à cet égard sans équivoque : Le militant rouge. Organe théorique et historique des insurrections. Sur le terrain, cela se traduit par la mise en place d’un service d’ordre rigoureux, organisé, coordonné qui utilise les conflits sociaux pour provoquer des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Cette violence est magnifiée par le poète communiste Louis Aragon qui dans une des strophes de Front rouge extraites de Persécuteurs persécutés, publié en 1931, déclame : « Pliez les réverbères comme des fétus de paille. Faites valsez les kiosques, les bancs, les fontaines Wallace. Descendez les flics camarades ». Cette stratégie perdure jusqu’en 1935. Il n’est pas rare de voir des militants communistes user d’armes à feu dans les affrontements avec les forces de l’ordre.
La violence révolutionnaire réapparaît après la Deuxième Guerre mondiale, d’abord à la faveur des grèves quasi insurrectionnelles de 1947 et de manière sporadique dans certaines manifestations organisées par le PCF et ses structures satellites, comme celle du 28 mai 1952 lors de la venue du général américain Ridgway. Les militants communistes convergent vers Paris. L’affrontement est délibérément recherché. L’échec de la manifestation oblige le PCF à repenser sa stratégie de la violence et à chercher d’autres moyens d’action.
Dans l’avant 1968, les actions symboliques utilisant la violence manifestante et l’action coordonnée sont nombreuses comme le 20 mars au siège de l’American Express, symbole de la guerre du Vietnam. Par contre, et à l’opposé, l’explosion des journées de mai ne recouvre aucun caractère organisé. Le rêve d’un grand soir spontané et carnavalesque s’est trouvé ainsi réactivé, le temps de quelques nuits. Mais très vite, la violence manifestante a été de nouveau encadrée notamment par les groupes d’extrême gauche qui organisent et imposent la violence manifestante avant de se dissiper.
La dernière grande émeute urbaine datait du 23 mars 1979, pendant vingt ans les affrontements avaient presque totalement disparu excepté quelques aspects marginaux en 1986 lors des grèves contre le projet de loi Devaquet ou en 1990 lors du vote de la loi Jospin sur l’école. Les plus anciens ont transmis l’expérience acquise. Dans les deux décennies suivantes, les actions sont devenues souterraines, peu visibles.
Depuis près de vingt ans, une nouvelle forme d’affrontement urbain a vu le jour, s’est développée et a pris de l’ampleur.
Ce type de cortège naît à Seattle en 1999, puis réapparaît à Gênes en 2001. En France, elle apparaît d’abord sporadiquement.
Un premier black bloc se forme à Évian en 2003 puis deux autres à Strasbourg et à Poitiers en 2009. Depuis, plusieurs autres terrains sont apparus avec les « zones d’autonomie temporaire » et les « zones à défendre » de Notre Dame des Landes et de Sivens entre 2014 et 2018 et autour des affrontements lors des protestations contre la loi travail en 2016, les grèves dans les Universités en 2018, jusqu’à l’explosion du 1er mai 2018 et depuis trois ans autour de quelques noyaux de Gilets jaunes.
Dans chacun des cas, ils se traduisent par plusieurs heures d’affrontements, des dégradations urbaines et des slogans inscrits sur les murs. Les militants d’aujourd’hui cherchent à reprendre le flambeau tout en inventant de nouvelles pratiques. La logique reste la même : refuser le monopole de la violence légitime, montrer le caractère de l’État, dénoncer le système capitaliste, mais aussi, même si cela n’est pas forcément perceptible à première vue, rester, sauf exception, dans le domaine symbolique, cherchant à redonner aux manifestations leurs caractères carnavalesques, pervertissant le temps d’un rassemblent l’ordre établi, quitte à utiliser la violence.
Sylvain Boulouque
Historien, enseignant en temps partagé à l’INSPE de l’académie de Versailles et au lycée
Auteur dernièrement de Mensonge en Gilets jaunes, Paris, Serge Safran, 2019 et de Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire, Lyon, ACL, 2020.
Photo : 1000 Words/Shutterstock.com