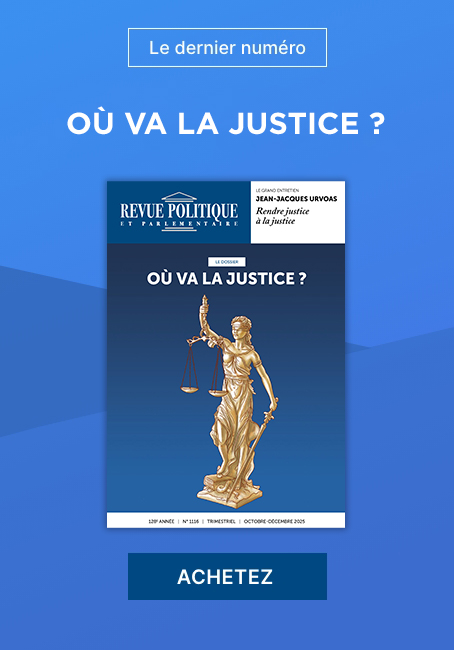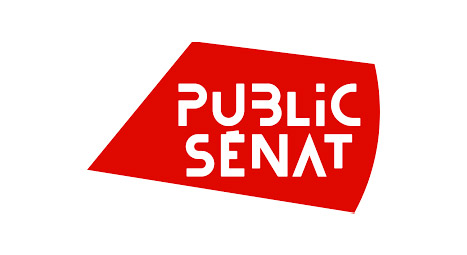Le multilatéralisme global et ses incertitudes. Du risque d’avoir raison trop tôt
Les relations internationales ont longtemps reposé sur une équation simple : elles ne dérivaient que de l’agrégation de relations bilatérales entre États souverains. Tel était en tout cas le message clair de la philosophie politique européenne lorsqu’elle s’est constituée, sous la houlette de Hobbes ou de Bodin, au moment de la Renaissance, précisément quand furent inventés les États-Nations modernes. Certains aujourd’hui en éprouvent une certaine nostalgie et font, à l’instar de Donald Trump, du retour au simple bilatéralisme un des principes de leur grammaire diplomatique. Pourtant, le dépassement d’un tel simplisme s’est peu à peu imposé, jusqu’à paraître aujourd’hui indispensable.
L’histoire a commencé dès le XIXe siècle, lorsque les progrès technologiques ont vite démontré que certains aspects de la vie sociale conduisaient inévitablement les États à abandonner une part de leur souveraineté et à fondre leur action publique dans des organisations prenant collectivement en charge des secteurs essentiels de l’activité humaine : ainsi en fut-il des premières conventions européennes en matière de navigation fluviale puis maritime, d’activité postale ou télégraphique, et très vite aussi de santé publique, tant l’essor des transports accélérait la circulation des maladies. Comment pouvait-il en être autrement ? Ainsi apparurent notamment l’Union télégraphique internationale (1865), l’Union générale des Postes (1874) et, plus tard, l’Office international de l’hygiène publique (1907).
L’HÉRITAGE AMBIGU D’UNE INVENTION MANQUÉE
Le grand enjeu – qui pèse toujours sur les relations internationales d’aujourd’hui – était de passer du spécifique au général : avec l’essor de guerres de plus en plus meurtrières, il paraissait progressivement évident que la paix supposait aussi une gestion globale, transcendant le bilatéral. Les millions de morts de la Première Guerre mondiale étaient là pour le confirmer. Deux paradigmes se sont alors opposés : celui du français Léon Bourgeois, pressentant la mondialisation et l’émergence d’une « opinion publique internationale » et appelant ainsi à une « société des nations » activant une solidarité internationale construite ; celui de l’étatsunien Woodrow Wilson proposant, à Versailles, en 1919, une institution promouvant une « sécurité collective » construite par le concert d’États souverains, mais organisés autour des plus puissants d’entre eux… La seconde version a triomphé aboutissant, avec la SDN puis l’ONU qui s’inscrivait en 1945 dans la même veine, à un multilatéralisme hybride qui garantissait la survie du principe de puissance et même la souveraineté absolue des plus forts, puisque cinq « Grands » disposent encore aujourd’hui d’un droit de veto les dispensant de se soumettre à une décision collective qui leur serait contraire…
Le dilemme était en tout cas posé, dès 1919 : le multilatéralisme est-il le prolongement enrichi du vieux principe de concertation entre puissants, ou le point de départ d’une réelle « gouvernance globale » ? Est-ce simplement le « machin » dénoncé en son temps par le général de Gaulle, ou l’adaptation indispensable à un ordre planétaire de plus en plus interdépendant et sur lequel, du coup, le principe de souveraineté n’a plus totalement prise ? L’idée majeure de gouvernance globale apparut dans les années quatre-vingt sous la pression de plusieurs commissions onusiennes (notamment la Commission on Global Governance créée en 1995) : on tirait alors les conséquences logiques de cette sécurité humaine que, parallèlement, le PNUD (Programme des Nations unies pour le Développement) avait inscrite, dès 1994, comme objectif majeur de son action. Il était alors devenu clair que les insécurités alimentaire, environnementale, sanitaire, économique, menaçaient autant la paix et la sécurité mondiale que la compétition stratégique entre États, et que ces insécurités ne pouvaient pas être sérieusement maîtrisées par la seule matrice de la souveraineté.
Le débat domine aujourd’hui, dans un contexte de réévaluation sensible et dangereuse du souverainisme : faut-il maintenir coûte que coûte le multilatéralisme dans ses habits de simple concertation ou accepter cette nouvelle discipline de la gouvernance globale ? Nous sommes incontestablement entrés dans une séquence où il est de bon ton de fustiger la mondialisation, de la dénoncer comme responsable de tous les maux : le tournant du siècle a été marqué par une déception explicite des classes moyennes étatsuniennes, soupçonnant que la mondialisation qu’elles pensaient de facture américaine s’était retournée contre leur économie, favorisant notamment la Chine, et plus généralement les émergents du Sud global. En a dérivé un vent protectionniste et souverainiste qui s’est peu à peu étendu à la quasi-totalité de l’Europe, sombrant également dans un national-populisme peu enclin à vanter les mérites de la gouvernance globale. Ailleurs, des régimes autoritaires de diverses factures cultivent pour d’autres raisons la même méfiance : l’idéal manque de soutien parmi les États et les leaders d’opinion.
Le paradoxe est fort : cette crise de confiance et ce souverainisme réactivé sont intervenus dans le double contexte de l’effondrement de l’URSS et de la montée des périls planétaires, c’est-à-dire au moment même où le monde avait plus que jamais besoin d’une énergique régulation globale. Boutros-Ghali et surtout Kofi Annan eurent à régir dans ce contexte ardu, ce dernier pariant sur les vertus évidentes d’un « multilatéralisme social ». Le choix stratégique faisait sens : désespérant des impasses propres au Conseil de sécurité, il nourrissait l’espoir que les agences onusiennes spécialisées dans le domaine social, plus consensuelles et moins tenues en bride par les États, allaient pouvoir créer empiriquement les conditions d’une efficacité renouvelée et consolider ainsi les chances de paix.
Le pari était réaliste : le PAM (Programme alimentaire mondial) démontrait alors des vertus utiles à la paix qui furent d’ailleurs récompensées par un prix Nobel. Celui-ci ne fut nullement usurpé : alors que la population mondiale doublait, l’institution réussit à maintenir la partie frappée de malnutrition à un niveau à peu près stable. Mais les déceptions s’enchaînèrent très vite : malgré une splendide « Déclaration du Millénaire » (1er janvier 2000) lançant les fameux OMD (Objectifs du millénaire pour le développement), les progrès en matière environnementale et climatique furent nettement inférieurs tant aux résultats escomptés qu’aux besoins les plus urgents ; dans le contexte dramatique de la Covid, l’OMS a été plus combattue que soutenue… Mais il y a pire : percevant les risques que ce multilatéralisme social faisait courir aux principes de souveraineté et de puissance, le populisme s’est retourné contre lui, Donald Trump décidant de quitter certaines de ses agences, de diminuer son soutien à d’autres et de mettre fin au programme étatsunien d’aide au développement… Autant dire que la gouvernance globale est devenue un rêve, alors qu’elle a failli être réalité et qu’on n’en a jamais eu tant besoin.
DES USAGES CONTRADICTOIRES DU MULTILATÉRALISME
Plus que jamais, depuis la chute de l’ordre bipolaire, notre système international est écartelé entre deux pratiques contradictoires qu’il faudra bien, un jour, réconcilier. D’une part, les États s’installent résolument dans la continuité de la pensée hobbesienne, faisant de la souveraineté, de la compétition et de la puissance les trois composantes essentielles et quasi-exclusives de toute politique internationale. D’autre part, les processus économiques, sociaux, communicationnels révèlent, jour après jour, des enjeux et des modes d’action qui appellent à des règles et des pratiques renouvelées, fortement inspirées par la mondialisation, les échanges matériels ou virtuels, et les dynamiques transnationales. De plus en plus, ce « second monde » incarne le réel et couvre les souffrances et les performances qui font le quotidien de l’humanité.
Le multilatéralisme est aujourd’hui au centre de ces tensions. Les États les plus puissants misent résolument sur le contrôle de son émanation wilsonienne et les garanties qu’elle offre à la puissance, surtout au sein d’un Conseil de sécurité qui donne un droit de veto à certains d’entre eux, attentifs à ne pas l’élargir. Les acteurs de la mondialisation, ONG, mais aussi population souffrante ou aspirant à un ordre global plus vivable, s’appuient au contraire sur un multilatéralisme social censé non seulement ouvrir la voie à une gouvernance planétaire, mais soulager aussi les maux issus de l’insécurité globale. L’opposition des deux voies débouche sur deux conceptions radicalement opposées de la sécurité : la sécurité internationale, évoluant vers un idéal de sécurité collective, d’inspiration wilsonienne doit servir l’intérêt des États et reconfigurer le fameux équilibre de puissance ; la sécurité globale considère tout au contraire, dans le sillage de Léon Bourgeois, que le préalable à toute sécurité, dans le monde tel qu’il est devenu, est de protéger la planète des dysfonctions majeures qui la menacent sur le plan climatique ou sanitaire. Comment pourrait-on imaginer une sécurité nationale préservée dans un monde au bord de l’implosion globale ?
Évidemment, les États se méfient de la seconde de ces conceptions et se raccrochent désespérément à la première, refusant même d’accueillir le concept de sécurité globale. Ce déni atteignit la caricature quand le Parlement français eut à examiner et adopter la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 « pour une sécurité globale », dont le principal objet… était de donner aux forces de l’ordre des prérogatives nouvelles ! Le résultat de cette crispation étatique, dans un contexte présent de retour à un souverainisme intransigeant mais décalé, est inquiétant. D’une part, le Conseil de sécurité est frappé d’impuissance, voire de paralysie, comme en atteste son com- portement face à la plupart des conflits : Proche-Orient, Ukraine, Caucase, Sahel, Soudan… Il laisse les membres du P5 et, de facto, la Russie et les États-Unis, imposer leur loi à grand recours de veto, sans s’ouvrir aux acteurs réels de ces nouveaux conflits, formations souvent extraétatiques, sans leur offrir la possibilité d’exprimer leurs attentes et de participer à la définition des solutions. D’autre part, le jeu a voulu que la connivence entre ses membres, surtout les permanents, bloque toute possibilité d’élargir et de moderniser le concept de sécurité dont le Conseil fait usage. C’est sous présidence chinoise, et avec le soutien actif de la diplomatie trumpienne, que cette instance a dû renoncer à la prise d’une résolution robuste sur la Covid, tandis que, peu avant, le délégué russe s’était violemment opposé à l’introduction des questions climatiques dans les débats du Conseil. En gros, les plus puissants des États aiment l’institution tant qu’elle laisse libre cours à leur seul jeu. Les autres peuvent se consoler en agissant au sein de l’Assemblée générale, d’autant que ses résolutions, comme celles condamnant récemment la Russie à propos de l’Ukraine ou Israël à propos de la question palestinienne, n’ont aucune valeur contraignante : elles n’ont en fait que valeur de sondage mondialisé…
Sur le front de la sécurité globale, la situation est du coup incertaine, voire inquiétante. Comme nous l’avons vu, les agences onusiennes s’activent en lien de plus en plus étroit avec les ONG. Plus de 6 000 d’entre elles sont officiellement accréditées auprès des Nations unies, le nombre étant en constante et rapide augmentation. Leur rôle de plaidoirie, mais aussi d’écriture même du droit et des grandes conventions (comme celles sur les mines antipersonnel ou sur la CPI) n’est plus à démontrer, banalisant la multilatéralisation des sociétés civiles. Le grand problème tient à l’articulation de ces activités à celles des États qui constituent des relais indispensables à la mise en place effective des réformes dessinées. À cette fin, les années 1990 avaient vu se succéder, sous auspices onusiennes, toute une série de « conférences internationales » impliquant les États dans la gestion des grands défis planétaires (Rio, en 1992, sur l’environnement, Copenhague, l’année suivante, sur le développement social, puis Le Caire sur la population ou Pékin sur la condition féminine…). La méthode nourrissait des espoirs et s’est institutionnalisée à travers la périodicité des COP (Conference of the Parties) : mais celles-ci ont inévitablement introduit la méthode transactionnelle comme mode de négociation, concernant des enjeux qui, par leur globalité, supportent difficilement d’être soumis à des compromis entre intérêts nationaux. Le problème est bien là : le multilatéralisme présume, probablement à juste titre, que, face aux sujets planétaires, l’intérêt national ne peut pas même s’épanouir si l’intérêt global n’est pas totalement servi. Le multilatéralisme a été inventé dans ce sens : c’est pourquoi il fait peur et que nombre d’États, notamment les plus puissants, trouvent, à l’instar de la diplomatie trumpienne, la solution dans le négationnisme en la matière, le climatoscepticisme ou l’assimilation de l’aide internationale à la corruption ou à la promotion du « communisme »…
Le multilatéralisme devient ainsi un enjeu de débat au sein même de la « communauté internationale ». Pays d’Aristide Briand et de Léon Bourgeois, la France se plaît à se présenter comme son défenseur zélé, même s’il lui arrive de déroger discrètement. Au contraire, Donald Trump s’applique à proclamer, du haut de la tribune de l’Assemblée générale, qu’il est davantage lié aux intérêts propres aux États-Unis. La Chine, attachée au renouvellement et à l’universalisation des normes, s’investit dans l’institution à cette fin, tandis que bien des pays du Sud global, faute d’avoir accès à la décision, savent en faire une tribune d’expression…
Autant d’usages, souvent confisqués par les intérêts nationaux, comme autant d’échecs dans la construction d’une gouvernance globale dont les catastrophes, climatiques, alimentaires ou sanitaires, nous montrent l’urgence : le multilatéralisme subit en quelque sorte les contre-coups décevants de cette force éthique qui lui donnait raison avant tout le monde. Mais son présent rôle est loin d’être négligeable : dans un monde où, chaque année, dix millions d’humains meurent de faim dans l’indifférence quasi-générale, on comprend ce qu’on peut en attendre. Mais il y a aussi cette impressionnante capacité d’énonciation, celle venant certes de l’Assemblée générale, de ses experts, de ses agents, mais aussi de ses instances juridictionnelles, CPI ou CIJ : même fêtés par certains, Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahu restent sous le coup de mandats d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Dite par un État, la sentence est rarement crédible ; prononcée par une instance mondiale, elle reste dans les esprits.
Bertrand BADIE
Sciences Po Paris
Les derniers articles
Les maires et le logement: le cauchemar du vieillissement du parc
Les programmes des candidats aux municipales comportent tous cette fois un volet logement significatif et distinctif. L’essentiel y est le...
Turbulences en Méditerranée orientale
La Méditerranée orientale représente un modèle de turbulences actuellement aggravées par la guerre israélo-américaine décrétée contre l’Iran. Cette région, où...
Première étude : Ecologie : le non-dit
Cette analyse invite à regarder autrement nos débats contemporains : quelles idées d'aujourd'hui deviendront demain si banales qu'on oubliera leurs...