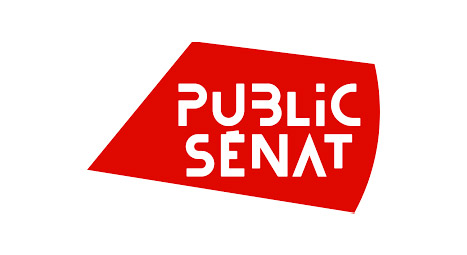Sociologue, enseignant et essayiste québécois, Mathieu Bock-Côté est l’auteur de nombreux ouvrages. Dans son dernière livre L’empire du politiquement correct, il scrute les mécanismes sur lesquels se fonde la « respectabilité politico-médiatique ». La Revue Politique et Parlementaire a demandé à cet observateur avisé de l’Europe quelle était sa vision de l’identité européenne.
Revue Politique et Parlementaire – Qu’est-ce qui fait aujourd’hui pour vous l’identité de l’Europe ?
Mathieu Bock-Côté – J’aurais tendance à vous répondre d’abord avec une banalité gaullienne : l’identité de l’Europe est d’abord celle de ses nations, grandes et petites, occidentales comme orientales. Ce ne serait pas une si mauvaise réponse, mais elle laisserait de côté, j’en suis conscient, une part essentielle de cette définition : quel massif historique, pour paraphraser Régis Debray, ces nations plus ou moins rassemblées forment-elles ? Je pourrais aussi vous répondre en cherchant à identifier la matrice civilisationnelle de l’Europe, en parlant de son héritage gréco-latin, ressaisi et remanié par le christianisme et marqué par la philosophie des Lumières et un esprit de découverte et de conquête lui ayant permis de se déployer aux quatre coins de la planète. Chaque fois, il s’agit de définir la civilisation européenne sur la longue durée. J’ajoute que sa définition ne se calque pas sur celle de la civilisation occidentale, par ailleurs, même si elle la croise.
Mais permettez-moi de retourner la question. De quelle manière l’Europe officielle a-t-elle voulu se définir depuis le début des années 1990 ? Essentiellement à la manière d’une utopie postnationale incarnant, pour reprendre les mots de Fukuyama, la maison de la fin de l’histoire. L’Europe entendait se définir par les droits de l’homme et l’économie de marché. On pouvait y ajouter la prétention à bâtir un modèle social appelé à domestiquer le capitalisme. Jeremy Rifkin parlait quant à lui du rêve européen : il s’agissait en d’autres mots de porter un modèle de civilisation et de société à l’avant-garde de l’humanité prenant le relais d’une Amérique ne parvenant plus vraiment à faire partager son rêve. Mais au-delà du discours des uns et des autres, on ne semblait pas vouloir définir l’Europe autrement qu’à travers des catégories politiques universalistes, théoriquement valables pour l’humanité entière. L’Europe semblait terriblement incapable de penser son héritage spécifique, son identité propre et ses frontières. Elle semblait se définir comme un espace indéterminé, appelé à toujours s’étendre.
Une telle définition de soi, aussi évanescente, aussi désincarnée, a eu des effets politiques notables. C’est pour cela qu’en 2005, il ne fallait pas mentionner dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l’Europe : on particularisait ainsi l’Europe, on l’ancrait dans une identité historique spécifique, on l’obligeait à se définir autrement qu’à la manière d’une proposition susceptible d’embrasser l’humanité dans son ensemble. L’Europe devenait une civilisation parmi d’autres, ce qui lui semblait intolérable. Ce n’est pas sans raison que la question de la Turquie a pris autant de place à l’époque dans le débat public : il fallait intégrer la Turquie à l’Europe pour qu’elle ne soit justement plus un club chrétien, pour l’arracher à toute définition identitaire.
Pour construire l’Europe politiquement, il fallait la déconstruire culturellement et historiquement.
On ne se surprendra pas qu’elle se soit éloignée peu à peu des peuples, qui ressentent au fond d’eux-mêmes une forme d’appartenance à la civilisation européenne, mais qui ne voient pas pourquoi ils se soumettraient à une entreprise d’ingénierie sociale et identitaire à grande échelle n’ayant plus d’européenne que le nom.
RPP – Les catégories universelles auxquelles vous faites référence sont issues de la démocratie libérale et cette dernière n’est-elle pas une construction politique de l’Europe ?
Mathieu Bock-Côté – La démocratie libérale a une prétention universelle – à tout le moins, ses promoteurs militants en semblaient encore convaincus au début des années 2000, quand ils voulurent par exemple expérimenter la théorie des dominos démocratiques au Moyen-Orient. C’était le cas de la philosophie néoconservatrice, qui entendait par exemple faire de l’exportation du modèle démocratique un élément central de la politique étrangère des nations occidentales. On pouvait y voir une forme d’impérialisme démocratique agressif : Hubert Védrine parlera quant à lui d’un wilsonisme botté. La formule était bien tournée. L’universalisme peut lui aussi perdre la tête en oubliant que les hommes participent à l’humanité à travers une série de médiations particulières. On ne saurait arracher l’homme à ses racines et ses appartenances sans le décharner. En d’autres mots : la démocratie libérale est le régime politique dont a accouché la civilisation occidentale, et on aurait tort de croire qu’on peut le transplanter par décret, comme si la culture et l’histoire pesaient pour peu de choses dans son avènement. J’ajouterais qu’on aurait aussi tort de croire que la démocratie libérale peut se maintenir dans nos pays en reniant son enracinement et certaines vertus essentielles – parmi celles-là le patriotisme et le sens de l’enracinement. La démocratie est le meilleur régime mais ce n’est qu’un régime. S’il se détache mentalement de la civilisation qui l’a engendré, il se dénature et devient alors le vecteur de ce que j’appelle le fondamentalisme de la modernité, qui pousse à la contractualisation intégrale du lien social – autrement dit, à sa désymbolisation et sa déréalisation.
RPP – L’Europe s’est construite à travers un processus de création, création politique, création culturelle, à travers des racines religieuses, mais elle s’est aussi bâtie contre. Dans son livre Mahomet et Charlemagne, Henri Pirenne démontre finalement que l’unité de la Méditerranée disparaît avec l’émergence de l’islam et que l’un des vrais combats de l’Europe durant des siècles a aussi été un combat aux marges de l’Europe et de la Méditerranée pour repousser les invasions de l’islam. Cette dimension historique est aujourd’hui manifestement gommée, elle n’est plus assumée. Y voyez-vous là une raison idéologique et une faiblesse de la pensée ?
Mathieu Bock-Côté – Pour répondre directement à votre question, il est bien possible, oui, que devant le péril migratoire et la présence inquiétante de l’islam, la civilisation européenne fasse l’expérience de son unité – ou plus exactement, qu’elle ressente explicitement, à l’échelle de l’histoire, une conscience de civilisation. Mais nous travaillons fort à ne plus penser la tension entre les civilisations, comme s’il suffisait d’un peu de bonne foi pour la dissoudre. Je ne suis pas de ceux qui idéalisent le conflit et qui rêvent du moment paroxystique où les peuples s’affrontent. Au contraire : le politique a une fonction pacificatrice qu’il nous faut redécouvrir. Mais à tout le moins, si on ne pense pas sa possibilité, il risque de resurgir dans sa forme la plus violente.
Permettez-moi néanmoins de traduire votre question dans les termes de la philosophie politique. Un monde sans tensions, neutralisé, réconcilié, est une fiction idéologique destructrice. On semble pourtant vouloir nous y faire croire de force aujourd’hui, avec l’utopie du dialogue, comme s’il suffisait que les hommes se parlent longtemps, très longtemps, pour finir par se comprendre. La philosophie politique académique a d’ailleurs tendance à endosser ce mythe, ce qui la rend de moins en moins intéressante. On veut faire du tragique une catégorie historique périmée. Ou du moins, on peine à en comprendre la signification et la portée politique. Mais l’humanité n’est pas ainsi faite : elle est irréductiblement plurielle – que l’on pense à la diversité des peuples, des nations, des religions, des civilisations. Cette diversité, naturellement, est appelée à se traduire politiquement.
Surtout, dans ce monde pluriel, où les intérêts s’entrechoquent inévitablement, il faut identifier les siens, sans les dissoudre dans je ne sais quelle tocade mondialisée.
Je suis de ceux qui croient que l’État-nation demeure la forme politique la plus achevée, et la plus à même de permettre aux hommes de conjuguer la souveraineté populaire et les libertés publiques. À tout le moins, l’État-nation me semble être la forme politique spécifique à la civilisation européenne, la mieux à même de permettre à la diversité des peuples qui coexistent sur le continent de jouir de l’indépendance nationale.
RPP – L’Europe refuse politiquement ses racines chrétiennes, mais est par ailleurs fondamentalement travaillée par un inconscient chrétien lorsque justement elle pose cette question de l’universalité et de ce messianisme. N’y a-t-il pas un paradoxe ?
Mathieu Bock-Côté – Il y a à tout le moins une tension. D’un côté, le message chrétien s’adresse à l’ensemble de l’humanité et ne peut pas par définition se définir à la manière d’une religion identitaire européenne – c’est d’ailleurs ce que lui reprochent depuis toujours les nostalgiques du paganisme, pour qui l’Europe se serait condamnée à l’effacement historique en embrassant le christianisme. De l’autre côté, le christianisme s’est historiquement incarné dans la civilisation européenne au point de s’y identifier : on a longtemps parlé de la chrétienté. C’est ainsi qu’on appelait l’Europe. Cette tension est-elle en train de se dissoudre, comme si l’humanité entrait dans un nouvel âge ? On s’est inquiété, avec raison, ces dernières décennies, de la déchristianisation de l’Europe.
Mais on devrait aussi s’inquiéter de la déseuropéanisation du christianisme, qui change de nature en s’affranchissant de la civilisation qu’il a marquée, et qui l’a marqué.
De ce point, l’histoire des deux derniers pontificats est parlante. Benoît XVI était conscient du lien intime entre la civilisation européenne et le christianisme. Il les savait indissociables. Le pape François voit manifestement les choses autrement : pour lui, le christianisme doit s’affranchir de l’Europe pour renouer avec sa dimension missionnaire. C’est ainsi qu’il pourrait se redéployer à la grandeur du monde. François se montre ainsi indifférent à la détresse identitaire des peuples européens. Mais il trahit ainsi le christianisme qui a toujours su l’importance des médiations et des cultures comme l’a remarquablement démontré Laurent Dandrieu dans son ouvrage sur la question.
RPP – Diriez-vous que la question migratoire aujourd’hui est à la fois la plus grande crise que traverse l’Europe depuis le traité de Rome, mais également une opportunité de bâtir un projet politique qui ne fasse pas l’impasse sur son passé et redonne un peu de rêve à l’Europe ?
Mathieu Bock-Côté – Il s’agit certainement de la question la plus importante de notre temps. L’Europe est victime d’une immigration massive qui entraîne une transformation en profondeur de la composition de sa population. Notons au passage que la démographie diversitaire pratiquée par certains idéologues nous explique que cette mutation est fantasmée et rédemptrice, tout à la fois. Le matin, ils nous disent que l’immigration massive est une lubie de la droite dure. L’après-midi, ils nous disent qu’elle a transformé le vieux continent en profondeur et qu’il faut se réjouir de cette mutation désormais irréversible. Nos progressistes devraient décider à laquelle des deux affirmations ils tiennent le plus !
Dans les faits, l’immigration massive, qu’elle soit légale ou illégale, bouleverse la civilisation européenne. Partout, on sent naître une angoisse fondamentale, qu’il serait bien mal avisé de mépriser : celle de devenir étranger chez soi. On serait bien mal avisé aussi d’y voir le symptôme d’une profonde xénophobie, ou même du racisme. Convenons toutefois qu’aujourd’hui, la tentation est forte d’assimiler au racisme le refus d’un peuple de se faire expulser symboliquement de chez lui, comme le soutiennent ceux pour qui nous sommes tous des immigrés, ou de devenir minoritaire chez lui, comme on le constate pourtant dans de nombreuses villes européennes, Bruxelles étant en la matière dans une situation particulièrement critique. Comme j’aime dire, le racisme est odieux, mais l’assimilation au racisme du simple désir de demeurer soi-même l’est aussi. Chose certaine, il faut prendre l’intégration au sérieux en renouant avec ce vieux principe : à Rome, on fait comme les Romains.
RPP – Le problème aujourd’hui de la question migratoire est celui de la présence massive de populations qui pratiquent une religion, l’islam, qui a une distinction totalement différente du rapport à la politique qui est celle de la distinction européenne qui est profondément marquée par la culture chrétienne séparant le temporel et le spirituel. N’est-ce pas aujourd’hui le sujet essentiel ? La question migratoire n’est-elle pas l’une des figures in fine de ce que Huntington appelait le choc des civilisations ?
Mathieu Bock-Côté – Nous sommes ici devant une évidence historique que les théories progressistes font tout pour occulter. Le conflit millénaire entre l’Occident et l’islam est transformé en fantasme idéologique propre à la pensée réactionnaire – il s’agit par ailleurs d’une stratégie rhétorique de plus en plus convenue, dès qu’une part du réel déplaît, on l’assimile à l’extrême-droite et il devient très dangereux de s’en approcher. Qui rappelle néanmoins l’existence du réel est transformé en infréquentable, même en paria. Dans son Histoire de l’islamisation française 1979-2019, l’auteur, anonyme, faut-il le préciser, se désole du « renoncement à un savoir établi depuis des siècles sur l’islam ».
Nous sommes obligés, aujourd’hui, au nom d’une forme d’irénisme diversitaire, de chanter la communion imaginaire des religions, qui seraient appelées à se fondre dans une même spiritualité mondiale.
Nuançons : seules les religions chrétiennes semblent emportées par le bavardage interreligieux, alors que l’islam, à ce qu’on en sait, n’entend pas renoncer à sa singularité, et pour certains de ses courants, à ses ambitions hégémoniques et impériales.
Mais évitons les grandes discussions théologiques dont le fond nous échappe. Dans l’espace qui est historiquement le sien, l’islam est naturellement légitime et je ne suis pas de ceux qui diabolisent une des grandes traditions spirituelles de l’humanité qui me semble absolument respectable. Mais dans le monde occidental, l’islam doit accepter sa situation minoritaire et se plier aux codes élémentaires de l’hospitalité – c’est-à-dire qu’il ne doit pas chercher à s’imposer, qu’il doit prendre les mœurs du monde où il s’installe, qu’il doit s’occidentaliser culturellement. Reste à voir si une telle espérance, minimale et raisonnable, est néanmoins imaginable dans le monde qui est le nôtre. Le politique devrait y contribuer et ne pas se contenter de gérer paresseusement la coexistence des communautés.
Mathieu Bock-Côté
Sociologue et essayiste
Propos recueillis par Arnaud Benedetti