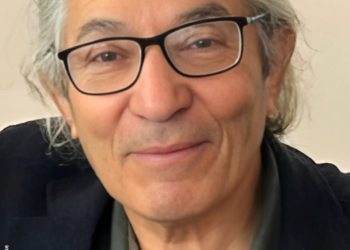Le 1er mars 2022, Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union prononçait ces trois mots : « Nouvel ordre mondial ». Dressant un parallèle avec 1946, date de la conférence de Yalta et de la partition du monde en deux grands blocs rivaux, l’analogie peut-être trompeuse. S’agissait-il d’une énième promesse d’un nouvel ordre mondial relevant du constat politique davantage que de la réalité ? Mais M. Biden a fait encore plus fort, si l’on ose dire : « Putin has no idea what’s coming … and I’ve told Xi Jinping : it’s never been a good bet to bet against the American people ». Churchill n’avait-il pas dit que « la Russie c’était un rebus enveloppé de mystère à l’intérieur d’une énigme » ?
Parions que le président américain a voulu développer son analyse géopolitique du rapport des forces, dans une ligne de calcul non sentimentale pour comprendre qu’actuellement l’ordre se heurte à la realpolitik des puissances. Dans cet ordre régi par l’équilibre des forces, mais aussi par leur déséquilibre lorsque les relations se crispent, une première question, qui est aussi la plus importante du fait de sa nature existentielle, est celle du type de forces ? S’agit-il du recours au droit ou bien du recours à la force ? Formulé autrement assistons-nous à un ordre qui reste régi par le droit international ou bien par le droit du plus fort ?
Là encore, avec la prudence du recul, admettons que les États-Unis ainsi que la « famille occidentale » dixit Nicolas Sarkozy, ne peuvent plus régenter le monde. Malheureusement, la nouvelle donne a peu de chance d’être favorable aux intérêts des Occidentaux et même s’ils peuvent encore peser sur cet ordre avec les attributs qui sont les leurs face aux épreuves à venir. Au moment où nous publions cet article, la guerre se poursuit en Ukraine, on vient à se demander si l’hiver octroiera une trève ? L’épreuve géopolitique à laquelle on assiste aujourd’hui curieusement nous apparait comme tout le contraire d’une guerre classique. Observons le mélange de plusieurs guerres : une guerre militaire, une guerre géoéconomique et une résilience de la société dans la guerre. C’est intéressant sur ce point de voir la société taïwanaise mener une mobilisation générale rendue encore plus impérative par la guerre en Ukraine.
Mais revenons un instant aux enseignements dans l’ordre d’aujourd’hui. Plusieurs questions essentielles se posent alors que la guerre en Ukraine, en réalité, souligne la traduction de la puissance en influence, au risque de se prolonger bien au-delà de sa simple géographie.
Primo, comment l’ordre mondial se définit-il ? Scrutons les péripéties géopolitiques pour l’hégémonie mondiale, dues à la remise en cause des valeurs fondamentales et en définitive du droit international qui sous-tend l’ordre mondial mis en place en 1945 par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.
Présentons ensuite les réalités sans perdre de vue les ressorts de l’ordre mondial : les rapports de force, l’intérêt national, la souveraineté nationale pour conclure que plus que jamais cet ordre est instable, car soumis à des jeux d’alliances variés. Gardons-nous de tracer trop de parallèles, mais comment la notion d’intérêt pour la sécurité nationale dans cet ordre, rappelant plus le monde de la fin du XIXe siècle que celui du XXIe siècle, constitue-t-elle un fil conducteur pour l’analyser ?
L’Ukraine, le nouvel ordre du XXIe siècle
En réponse à la première question, il faut d’abord rappeler que l’ancien Secrétaire d’État américain Henry Kissinger publiait un livre influent en 1994 : Diplomatie, qui donne un diagnostic à la fois synthétique et implacable sur la logique d’équilibre des puissances dans l’ordre mondial. Ce que nous apprend la guerre en Ukraine, c’est que nous changeons d’époque et de paradigme : les réalités du XXIe siècle sont plus associées à la puissance qu’au consensus.
Puis on a assisté au vote de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) en faveur d’une résolution le 2 mars 2022.
Chaque pays a regardé dans la même direction sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais chacun n’a pas vu la même chose.
Dans cette comptabilité un peu plus de quarante pays se sont pleinement entendus sur l’imposition de sanctions envers la Russie, ce qui donne la mesure d’un désenchantement durable de l’ordre. Un nombre significatif de pays se sont abstenus et certains comme l’Inde sont loin d’être négligeables.
Vu d’Afrique, dix-sept pays n’ont pas pris position sur ce conflit lors du vote en s’abstenant tandis que la moitié des autres n’a pas pris part au vote. S’agissant de ces derniers, c’est l’expression de plus en plus réelle des interactions diplomatiques que chacun veut peser dans le jeu traditionnel. Là comme ailleurs, il ne faut pas négliger le message que les pays africains et plus largement les pays du Sud renvoient à l’ordre mondial sur leur refus de s’enrôler dans la campagne antirusse. Un exercice de lucidité qui nous conduit a écrire que l’on voit se former une sorte de seconde alliance « de Bandung », du même nom que la conférence d’avril 1955, réunissant les représentants de pays africains et asiatiques choisissant une neutralité et le non-alignement sur les conflits Est-Ouest. Par exemple, le 2 juin 2022, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine s’est entretenu avec le Président russe Vladimir Poutine en rappelant que « le conflit affecte particulièrement les pays africains mais se déroule sur un autre continent ».
Au Moyen-Orient, c’est au moins aussi vrai et arrêtons-nous sur la visite du président américain Joe Biden de juillet 2022 en Arabie saoudite avant de participer au sommet des pays membres du Conseil de coopération du Golfe à Jeddah . Là encore, que recouvre le positionnement des pays du Golfe et du régime saoudien ? Pays aux allures de banque centrale du pétrole dont toute hausse du gallon d’essence aura mécaniquement un réel impact à la pompe et dans les bureaux de vote lors des élections de mi-mandats aux États-Unis.
Quant le président Biden a répondu par « I made my view crystal clear... » sur les relations entre Washington et Riyad, c’est logiquement que domine dans le Golfe un autre sentiment appuyé par le silence sur l’invasion russe de l’Ukraine. Depuis la création de l’OPEP +, en 2016 , qui associe Moscou et Riyad aux négociations sur le niveau de production de pétrole, cette entente promet, au contraire, d’être un acte fondateur de ce que sera le futur géoéconomique de cet ordre géopolitique. Aussi, les pays du Golfe défendent-ils leurs intérêts vitaux en tentant de ne pas compromettre leurs relations avec la Russie au respect de maintenir un ordre fondé sur le droit, car peu de perspectives seraient aussi menaçantes que celui d’un OPEP rendu instable si la Russie le quittait ou en était ejectée.
La rencontre des ambassadeurs du G7 au Caire ajoute un autre élément de compréhension en bien tant qu’en mal sur ces visions de la conflictualité qui secouent les relations diplomatiques entre États.
La stratégie de l’Égypte est claire et avant de resserrer les rangs avec les Occidentaux, le président égyptien Fatah Al-Sissi n’ignore pas que les printemps arabes de 2011 furent précédés par plusieurs vagues de mécontentement social dues à l’augmentation des prix des denrées alimentaires de base.
Face à un enjeu d’une telle ampleur, c’est au nom de sa sécurité alimentaire que l’Égypte, premier importateur mondial de blé, blinde sa relation stratégique avec Moscou sur fond de dépendance des marchés russe et ukrainien (90%).
source OEC
C’est un ordre mondial, où au moment de l’ambivalence diplomatique, de gérer les désaccords entre acteurs et en particulier entre les alliés du camp occidental ce sont les intérêts des États qui priment. Même l’Égypte, alliéautrefois fidèle de Washington, n’a pas répondu à l’injonction de condamner l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes.
Ici intervient un nouvel enjeu : celui du jeu diplomatique indirect de la position de la Chine sur la notion de souveraineté et qui témoigne d’un point de vue historique une inflexion majeure de sa politique qui jusqu’à présent considérait le respect de l’intégrité territoriale des nations comme la pierre angulaire des relations internationales. Dans la déclaration que les ambassadeurs du G7 ont publiée en juin, ils ont rappelé que l’Ukraine « c’est un pays souverain dont la souveraineté et l’intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale de la Russie ».
Une Chine souveraine ? Oui, parce qu’elle y a intérêt sur beaucoup de sujets et notamment pour l’être demain avec Taïwan. La brèche stratégique que lui a ouverte la Russie en Ukraine justifie que lors du vote du 2 mars aux Nations unies, la Chine se soit abstenue en des termes concordant avec ceux de la Russie, rejetant l’expansion de blocs militaires et l’impérialisme occidental. La diplomatie chinoise bilatérale et multilatérale se révèle extrêmement habile à gagner la confiance dans cette moitié du monde que souligne la crise ukrainienne en deux camps idéologique. Il ne fait aucun doute que la Chine va poursuivre dans cette voie avec constance, en associant souveraineté et nationalisme pour justifier une bonne partie de ses revendications territoriales dans sa sphère d’influence et autour de ses propres valeurs.
C’est ce qu’on appelle défendre ses intérêts et le plus bel exemple est que la Chine a exercé son droit de veto à huit reprises soit autant que depuis 1971, date de son entrée à l’ONU et 2013, date de l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir.
Cette accélération qui va à l’inverse de sa tradition de n’apposer que très rarement son veto au Conseil de sécurité de l’ONU est de ce point de vue révélateur et particulièrement instructif .
Macron se rend à Cotonou au Bénin le 27 juillet et il ne ménage pas ses mots pour la Russie qu’il accuse d’être « une des dernières puissances impériales coloniales… une guerre afin d’envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts ». Au moment où le président achève sa visite en Afrique, le jeu dynamique des acteurs continue d’évoluer : l’arrivée prochaine d’un nouveau premier ministre au 10 Downing Street remet à l’ordre du jour le Commonwealth, sa sphère d’influence de cinquante-six États hérités de l’Empire britannique comme un rempart face à la Chine. Telle une puissance coloniale du XXIe siècle, le Royaume-Uni démontre que la souveraineté n’est pas un vain mot, mais le moyen de formuler sa stratégie mondiale et de consolider les intérêts du royaume avec en son centre le projet pour le Global Britain en recomposant l’un des plus grands blocs économiques du monde (représente un PIB collectif de 12 000 milliards de livres sterling, soit 14% du PIB mondial et 30% des voix aux Nations unies ).
Dans cette guerre, d’autres pays sont actifs et aimeraient bien occuper une place importante comme la Turquie et son rêve impérial que limite la mer noire. À l’image de la Chine, la Turquie joue un rôle de facilitateur diplomatique comme lors du sommet de Antalya Diplomacy Forum 2022 et affiche son indépendance vis-à-vis du camp occidental . Le leadership régional auquel pourrait prétendre Ankara peut-être analysé à l’aune de l’esprit de conquête turque de la Syrie à la mer d’Egée, mais aussi à l’absence des retraits européen et américain.
Jamais autant qu’aujourd’hui une crise marque une rupture dans le ronronnement stratégique patiemment construit selon des règles connues et acceptées d’avance, mais qui bouleversent le rapport de force initial.
En réaffirmant l’attachement indéfectible à la souveraineté de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières et de ses eaux territoriales internationalement reconnues, en paroles, d’abord dans les ors du Palais de Versailles, c’est davantage que le destin de l’Ukraine ou les positions de la famille européenne sur les questions d’ordre mondial qui sont en jeu depuis le sommet du 11 mars 2022. Les racines de la guerre que nous vivons vont plus loin. On voit bien en actions, un peu partout et plus encore, que l’on est plus dans un monde tranquille. Il faudrait être aveugle, ou obstinément partisan pour ne pas relever un fait en direction de cet ordre : une certaine destruction de l’ordre et subrepticement la relecture de ses textes fondamentaux (p. ex., l’accord de Potsdam). On peut dans cet ordre d’idée raisonnablement considérer que la distribution mondiale de la puissance va se modifier avec le scénario possible de l’avènement d’une architecture des relations internationales scindée en deux blocs d’influence.
Le Conseil de sécurité : que faire ? Continuer…
La guerre en Ukraine, pays souverain et démocrate, et l’action militaire qui s’en est suivie, a vu le Conseil de sécurité face à une impasse diplomatique et déconnecté par rapport aux réalités géopolitiques. Vue du Grand Jeu, cette guerre cristallise le spectre d’un Conseil de sécurité « tétraplégique » et on peut ne pas aimer le mot, car dans les faits, on y dialogue mais dans l’incapacité à s’accorder ou agir. La réalité est que la puissance reste l’apanage des États au sens classique du terme de puissance dure et de la cœrcition. Parallèlement, les cinq membres permanents du Conseil agissent en bon rentier diplomatique mais incapables de s’accorder sur les principes de paix qu’ils préconisent pour l’ordre mondial, ce qui les rend très vulnérables.
Ces temps-ci des responsables politiques, encore trop peu nombreux, commençent à parler de puissance d’équilibre. Il est grand temps et c’est urgent. Conscient de sa force relative dans cet ordre interconnecté, le président Macron a porté ce concept qui consiste à revenir au cœur du jeu diplomatique, il faut entendre selon le président le fait de « ne pas être une puissance alignée. La France reste une puissance influente dans cet ordre et membre permanent du Conseil de sécurité. C’est cela le Conseil de sécurité en 2022.
Indéniablement il est mal-en-point et il vit une crise qui aura de redoutables conséquences qui détermineront les rapports de forces du XXIe siècle.
Chez Raymond Aron, contemporain des fondateurs de l’école réaliste américaine, au sujet de la puissance, il disait « J’appelle puissance, sur la scène internationale, la capacité d’une unité politique, à imposer sa volonté aux autres unités ». On touche au fond des choses et le Conseil de sécurité n’est pas un État. À priori, on pourrait rajouter qu’aujourd’hui plus rien ne marche quand on songe qu’un principe de base dans la diplomatie est de respecter sa parole et de s’accorder à partir de la véracité des faits pour parvenir à trouver des compromis, ce à quoi devrait servir la diplomatie onusienne. Entendons-nous : depuis vingt ans se sont succédé en Europe des précédents de diplomatie morale constitués comme le bombardement de Belgrade et la destruction de la Serbie par l’OTAN en 1999, sans avoir obtenu l’approbation du Conseil de sécurité. Un exemple retenu par la Russie aujourd’hui. Dès 2001, l’OSCE avait vocation à unir, à ménager les souverainetés et à se doter d’un outil pour construire un nouvel ordre et pour conserver la paix. Rappelons que Poutine fût le premier chef de l’État à proposer son aide à George W. Bush après les attentats du 11 septembre en prônant le retour au réalisme en politique étrangère. Vingt ans après, comme disait Alexandre Dumas, les protagonistes ont vieilli et les temps ont changé.
Force est de constater qu’aujourd’hui il faut refaire de la diplomatie en innovant dans la méthode, laquelle ne consiste pas qu’à tracer des lignes rouges, à moraliser ou vouloir punir, car ce multilatéralisme est en deuil et la guerre en Ukraine comporte dès lors une dimension historique et restera le symbole d’un fossé entre les cinq membres permanents et la fin de cet ordre-là. Ainsi le Conseil de sécurité voit éclater une guerre impliquant l’un des cinq membres, sur fond de leurs divisions et de leurs désaccords, symbolisés par l’escalade verbale formulée par Joe Biden, qui déclara que Vladimir Poutine « ne peut pas rester au pouvoir », face à l’agression de la Russie.
Pour l’auteur de ces lignes, il n’existe pas le moindre doute que l’histoire reste contemporaine et indispensable pour comprendre le manque d’alignement stratégique propre au Conseil de sécurité et de sa diplomatie de coulisses compte tenu de la grande question oubliée. Comment réhausser le poids moral et la valeur d’expression collective par opposition à la puissance et les intérêts nationaux quand les risques de dérapages du présent sont multiples ?
En diplomatie, il existe incontestablement un bon usage de l’Histoire, et la crise du Conseil de sécurité, c’est la crise des États et de leur capacité à gérer les rapports de force au mieux de leurs intérêts.
Les stratèges de Moscou en ont conclu que l’intérêt national russe est mieux servi par l’absence de règles que par l’ordre de sécurité érigé en 1945. Là est tout le malheur : la résolution 2758 de 1971 pour justifier l’exclusion de Taïwan mettant au ban Taïpei, qui de manière souveraine et indépendante réclame ce droit de regard sur son destin, aura-t-elle les mêmes conséquences que l’impasse de Tiananmen en 1989 en accélérant le déclin des nations libres d’une part, en renforçant les empires idéocratiques d’autre part ? Quand bien même il y aurait une certaine injustice dans ce fait, il ne peut y avoir qu’un seul siège pour représenter la Chine. Tel est bien le cas.
Au terme de notre réflexion, le désarroi au sein du Conseil de sécurité apparait cruellement avec la prise de conscience sucitée par la guerre en Ukraine montrant que le camp occidental est incapable de jouer son jeu de contre-puissance. Cinq membres permanents en opposition et sans la moindre stratégie alternative lorsqu’il faut créer une position de force ou que les nations de l’ordre mondial viennent à en manquer.
Le Japon et le partage de l’ordre
Confronté de plein fouet aux soubresauts entre les États-Unis et la Chine, le Japon se trouve opposé au même défi : se repenser comme un partenaire souverain et non plus seulement de se trouver réduit à la rivalité des empire de l’ordre du XXIe siècle. Dans ce bouleversement de l’ordre et de sa rhétorique anti-occidentale, le Japon reste la seule puissance asiatique membre du G7. Compte tenu du rôle qui est le sien dans cette géographie des rapports de force, Tokyo doit se fixer des priorités et c’est en soit ce que le réalisme diplomatique de l’administration Kishida suggère.
Au Japon, l’heure est venue d’un inventaire sérieux sur lui-même, étant donné que les fondements de sa stratégie intégrale qui se veut pacifique et sur la défensive se trouve cernés par des crises sur trois fronts, la Russie au nord, la Corée du Nord à l’est, la Chine au sud-ouest sans cesse plus agressives.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’au même moment l’ordre mondial est privé de leadership et cet ordre de 1945 dont le centre est désormais au cœur des intérêts nationaux du Japon se désintègre avec la remise en cause des règles en place.
Pour n’avoir pas su le refonder en prenant acte de la nouvelle donne placée sous le signe de la fin de l’occidentalisation, le rapport de force de la guerre russe contre l’Ukraine et son déchaînement de destruction ne nous font pas oublier les excès du Japon à la toute-puissance et la démesure de son ambition impériale avec pour conséquence la destruction d’un ordre mondial suite à son retrait de la Société des Nations en 1933. Dans ce contexte de guerre, où l’ordre s’affaiblit devant la loi du plus fort, semblable aux années 1930, le Japon est contraint à repenser les fondamentaux de sa diplomatie et à remettre sur le métier son alliance militaire avec les États-Unis conçue entre autre pour le ramener dans le bon sens de l’histoire et le protéger de l’imperium soviétique en l’arrimant à l’univers atlantique entre « ni dépendance ni soumission ».
Soyons franc : compter sur un effondrement russe à l’instar de celui de la Russie tsariste en 1904 n’est pas une stratégie pour le Japon. La question importante est de savoir comment le Japon, peut continuer d’apporter sa contribution à l’ordre mondial comme il sut le faire en plongeant au tréfonds de ses ressources pour y puiser l’énergie de sa force suite à la suite de sa reddition en 1945. À New York, le 9 juin, le Japon a été réélu pour la douzième fois membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour poursuivre ses intérêts nationaux et soutenir le leadership régional auquel il pourrait prétendre. La nouvelle réalité créée par la guerre en Ukraine implique de rendre la position du Japon au sein d’un ordre plus stable et ses positions souveraines bien representées. Malheureusement, la condition du rang de membre permanent du Japon au sein du cercle des puissances dépend, pour l’essentiel, de l’attitude de Pékin. Plus fondamentalement, concluons avec cette conviction forte du général de Gaulle « qu’il n’y a pas de stratégie ou de politique qui vaillent en dehors des réalités ».
Hervé Couraye