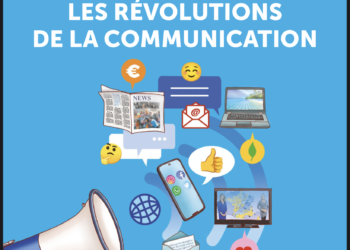Lors de son voyage officiel au Canada en juillet 1967, le général de Gaulle prononce un discours enflammé ponctué de « Vive le Québec libre ! » devenu historique.
Deux thèses se répandent dans les heures qui suivent le « Vive le Québec libre ! », lancé le 24 juillet 1967 du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal. Première idée, tenace, le général de Gaulle se serait laissé emporter par l’émotion de la foule après une journée de retrouvailles. Son goût prononcé pour les formules chocs, une anglophobie assumée, une manie un peu gênante de confondre quelques vieilles lubies personnelles à la politique étrangère de son pays, une volonté mal maîtrisée de défier à nouveau le géant américain expliqueraient le vivat gaullien, largement improvisé. Deuxième idée, corollaire de la première, un tel discours serait forcément sans lendemain et sans conséquences. Coup de gueule d’un vieil homme dont les années au pouvoir étaient comptées, le « Vive le Québec libre ! » marquerait la chronique mais certainement pas la politique étrangère de la France. Futur Premier ministre canadien (1993-2003), Jean Chrétien déclarait dans les heures qui suivirent le discours du balcon : « d’ici une semaine, tout le monde aura oublié cet incident ». Une fois disparu le fondateur de la Ve République, une fois l’accalmie retrouvée, plus rien ne subsisterait de la geste gaullienne, sinon quelques paragraphes dans des livres d’histoire. À coup sûr, ses successeurs retrouveraient la raison !
Alors que nous commémorons le 50e anniversaire du décès de Charles de Gaulle, il est désormais possible de démontrer que ces deux idées étaient complètement fausses. Des témoignages nombreux livrés par des proches – notamment Alain Peyrefitte, Jacques Foccard et Philippe de Gaulle –, un examen attentif de ses archives, de sa correspondance, de discours écrits de sa main mais jamais prononcés font voler en éclat la thèse de l’improvisation.
Mais plus important encore, l’action menée par les successeurs du Général, y compris François Mitterrand, montre que le cri du balcon entendu aux quatre coins du monde résumait bel et bien une politique, c’est-à-dire des actions concrètes et structurantes qui ont permis aux Québécois de construire un État moderne, présent sur la scène du monde.
Si l’on excepte la très courte parenthèse Sarkozy, sans lendemain, tous les présidents et gouvernements français depuis de Gaulle ont accompagné et soutenu le Québec dans son développement et sa quête de liberté.
« Ni improvisation, ni préméditation »
Charles de Gaulle avait-il prévu le « Vive le Québec libre ! » ? À bord du croiseur Colbert, affairé à préparer ses discours alors qu’il traverse l’Atlantique pour contourner un protocole qui l’aurait forcé à commencer son voyage dans la capitale canadienne, il teste la formule devant un témoin qui, selon Alain Peyrefitte, tente de le dissuader. « Ça dépendra de l’atmosphère » laisse-t-il tomber. Cette atmosphère, on le sait maintenant, sera survoltée, les foules nombreuses et enthousiastes. Dans ce qui conclut une journée mémorable de fierté française, de Gaulle jugea que le climat se prêtait à ce vivat spectaculaire qui résumait un état d’esprit, un élan, une volonté. Pour le dire comme Maurice Vaïsse, il n’y avait dans ce discours historique et dans cette phrase particulière « ni improvisation, ni préméditation ». Si le matin du 24 juillet 1967, il ne sait peut-être pas encore s’il allait lancer cette formule, une chose est absolument claire cependant, de Gaulle souhaitait que le Québec puisse accéder au concert des nations souveraines. Tous les discours prononcés le 24 juillet 1967 allaient dans ce sens.
Charles de Gaulle est probablement le chef d’État français le plus au fait de l’histoire du peuple canadien, devenu canadien-français au XIXe siècle, puis québécois durant la « Révolution tranquille » des années 1960. Dans sa bibliothèque privée de la Boisserie, tout un rayon était consacré à cette histoire. Un père historien, des études chez les Jésuites, une connaissance fine des batailles menées par les armées françaises en Amérique du nord durant la Guerre de Sept ans ont certainement nourri son intérêt pour l’histoire du Québec. En 1913, dans une conférence sur le patriotisme, le jeune Charles de Gaulle considérait le marquis de Montcalm, général français durant l’historique bataille des plaines d’Abraham du 13 septembre 1759, comme l’un des trois plus grands patriotes de l’histoire de France, avec Jeanne d’Arc et Bertrand du Guesclin.
L’histoire de ce peuple lâchement abandonné par le gouvernement de Louis XV – c’est ainsi que de Gaulle voyait les choses – s’était poursuivie, malgré les embûches, les velléités assimilationnistes des Anglais, l’infériorité économique.
La survivance de ce peuple dans la durée tenait à ses yeux d’un véritable « miracle » qui attestait du meilleur de l’esprit français fait notamment de fidélité au passé et d’attachement à la foi des ancêtres. Occupée par les troupes allemandes, une France qui doutait d’elle-même devait s’inspirer de cet esprit français, d’où l’appel qu’il lança aux Canadiens français le 1er août 1940 sur les ondes de la BBC : « l’âme de la France cherche et appelle votre secours, parce qu’elle trouve dans votre exemple de quoi ranimer son espérance en l’avenir ».
C’était une chose de connaître et de comprendre le destin du peuple canadien-français, une autre de soutenir la cause indépendantiste québécoise. On retrouve certes chez de Gaulle une idée de réparation, de dette, une claire volonté de mettre fin à l’asservissement des « Français du Canada » dans un régime fédéral qui, à ses yeux, cherchait à masquer la domination d’un peuple sur un autre.
Les notes prises par Alain Peyrefitte ne laissent planer aucun doute : de Gaulle, dès le début des années 1960, considérait que l’accession du Québec à l’indépendance était inéluctable.
Mais le mouvement de pensée du général de Gaulle durant les années 1960 sur cette question participe alors d’un faisceau d’explications qui dépassait le cas québécois. Après les accords d’Évian, le président français, en plein contexte de décolonisation, se fit le champion de l’autodétermination des peuples et défendit avec vigueur l’ancrage national, malgré le contexte de guerre froide qui figeait alors le monde en blocs.
S’il se garde bien de révéler publiquement ses vues personnelles sur l’avenir du Québec avant le 24 juillet 1967, il multiplie les actions qui, mises bout à bout, attestent d’une vraie « politique québécoise » gaullienne. Le 5 octobre 1961 on inaugure à Paris une « Maison du Québec », transformée trois ans plus tard en « Délégation générale » et bientôt dotée de l’immunité diplomatique d’une ambassade d’un État souverain. La France et le Québec mettent aussi en place une Commission permanente de coopération franco-québécoise qui planifie le développement de stages et d’échanges. L’ÉNA réserve quelques places à des fonctionnaires d’un État québécois en train de se moderniser. En 1965, le Québec signe sa première entente internationale en éducation avec la France. Toutes ces actions en faveur du Québec sont pensées, parfois initiées et mises en vigueur par un « lobby québécois » extrêmement actif en France, fait de fonctionnaires, de diplomates, de parlementaires, de journalistes et de militants de la cause française dans le monde. Sans contredit, le travail en coulisses de Philippe Rossillon, Bernard Dorin, Xavier Deniau, Pierre-Louis Mallen, Jean-Daniel Jurgensen et quelques autres ont rendu possible cette politique québécoise du Général.
Dès son retour au pays, de Gaulle donne des conseils clairs à son gouvernement. Ses discours du 24 juillet doivent s’incarner dans une politique encore plus active à l’égard du Québec. En septembre 1967, son ministre de l’Information rencontre le Premier ministre Daniel Johnson pour lui proposer une liste de mesures qui permettront un approfondissement de la coopération France-Québec. Les accords Peyrefitte-Johnson prévoient un accroissement des budgets et la création de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Quelques mois plus tard, la France impose la présence du Québec lors d’une conférence internationale sur l’éducation organisée par le Gabon à Libreville. Le Général propose au Premier ministre Johnson d’assister à la tribune d’honneur, à ses côtés, au grand défilé du 14 juillet 1968 mais ce dernier préfère se défiler.
Avant de quitter le pouvoir précipitamment, de Gaulle constate, non sans dépit, qu’il semble plus pressé de réaliser l’indépendance du Québec que les dirigeants québécois.
« Rester dans la ligne »
Si, s’agissant du Québec, les successeurs du Général n’ont pas le même style, ni la même ambition d’accélérer l’Histoire, il n’est pas question non plus de revenir en arrière et de « normaliser » les relations avec le Canada en faisant fi du Québec, malgré les efforts du gouvernement canadien et l’inclination naturelle du Quai d’Orsay à ne traiter qu’avec des États souverains.
Jusqu’à son décès prématuré en 1974, le Président Georges Pompidou poursuit la politique québécoise du Général. Comme il l’expliqua à ses conseillers, il fallait « rester dans la ligne » du Général tout en évitant de provoquer inutilement le gouvernement fédéral canadien. Il confirme le statut particulier de la Délégation du Québec à Paris et maintient la politique de coopération active avec le Québec. Dans la toute nouvelle Agence de coopération culturelle et technique, créée en 1970, le président Pompidou voit à ce que le Québec dispose d’un siège et soit membre à part entière. En 1971, plus de 10 000 jeunes Québécois et Français ont déjà participé à un stage ou à une mission organisée par l’Office franco-québécois pour la jeunesse. En éducation, du primaire à l’université, les échanges se développent à un rythme plus rapide que prévu.
L’élection de Valéry Giscard d’Estaing aurait pu changer la donne pour le Québec. Issu du centre libéral et pro-européen, le nouveau Président avait condamné le « Vive le Québec libre ! », assimilant cette déclaration à l’une des trop nombreuses manifestations d’un « exercice solitaire du pouvoir ». À la fin des années 1940, il avait enseigné dans un collège français à Montréal alors que le réseau éducatif québécois était sous l’emprise de l’Église. Il connaissait mal le processus de modernisation et de sécularisation à l’œuvre au Québec. Or malgré une nette volonté de se distinguer de son illustre prédécesseur, Valéry Giscard d’Estaing poursuivit la politique québécoise du Général. En 1974, un accord de coopération linguistique est signé avec le Québec qui vient tout juste d’adopter une loi historique, laquelle fait du français la langue officielle de l’État. Un chantier coordonné par le linguiste Alain Rey est mis en place pour enrichir la langue française de termes et de concepts techniques et scientifiques. Le 15 novembre 1976, quelques mois après la démission fracassante du Premier ministre Jacques Chirac, le Parti Québécois de René Lévesque prend le pouvoir, ce qui ravive le souvenir du « Vive le Québec libre ! ». À droite, le soutien au Québec atteste d’une fidélité à l’héritage du Général. Pour ne pas se laisser damner le pion sur ce terrain par le tout nouveau Rassemblement pour la République fondé par son Premier ministre démissionnaire, Valéry Giscard d’Estaing donne des gages à la politique québécoise de la France. En juin 1977, le Premier ministre René Lévesque est reçu en grandes pompes en France comme s’il était déjà un chef d’État. Le président assure également aux souverainistes québécois une reconnaissance d’un OUI en cas de victoire lors d’une consultation référendaire qui aura lieu en 1980 – cette promesse de reconnaissance prévaudra également lors du référendum de 1995 sous la présidence de Jacques Chirac. Sur cet enjeu sensible, Giscard d’Estaing inaugure la politique de la « non ingérence et non indifférence », poursuivie par tous ses successeurs.
La prise du pouvoir par les socialistes fait craindre le pire aux représentants québécois. C’est que François Mitterrand, dès l’élection présidentielle de 1965, s’était présenté aux Français comme l’antigaulliste en chef. En juin 1972, une rencontre entre Mitterrand et Lévesque lors d’assises du Parti socialiste s’était plutôt mal passée. Sa connaissance du Québec et de l’histoire de l’Amérique française était limitée. Devenu président, il confie au philosophe Régis Debray la mission d’organiser un grand sommet de la francophonie. Le Canada de Pierre Elliott Trudeau est favorable au projet mais à la condition de parler au nom du Québec. Le Président est sur le point d’aller de l’avant mais en coulisses le lobby québécois menace d’accuser le gouvernement socialiste d’abandonner à nouveau les Français d’Amérique. Une note du conseiller Hubert Védrine datée du 28 juin 1983 aurait fait pencher la balance. Il dit craindre que Pierre Elliott Trudeau cherchât à humilier le Québec après la victoire du NON de 1980 et la réforme constitutionnelle de 1982 obtenue sans le consentement des élus québécois. Or une telle humiliation ne serait pas souhaitable puisque « le Québec demeure malgré tout notre principal point d’appui en Amérique du nord, évidemment sur le plan culturel mais aussi sur le plan économique. Cette province continue ainsi à représenter 50 % de toutes nos exportations au Canada ». Grâce à un changement de garde politique à Québec et à Ottawa, le premier Sommet de la francophonie sera finalement tenu à Paris en février 1986 en présence du Québec. Outre ce premier sommet, la présidence de François Mitterrand est aussi marquée par un renforcement de la coopération de la France avec le Québec. En 1983, l’entreprise française Pechiney annonce l’ouverture d’une usine d’aluminium à Trois-Rivières. L’année suivante est fondé le Centre de coopération interuniversitaire franco-québécois.
Après François Mitterrand, tous les présidents vont « rester dans la ligne » du Général et poursuivre sa politique québécoise, même Nicolas Sarkozy, pourtant agacé par le soi-disant « sectarisme » et le « repli sur soi » des souverainistes québécois. Cette continuité, d’aucuns diraient cette permanence gaullienne, comment l’expliquer ?
En premier lieu, ne sous-estimons pas les multiples initiatives de la société civile. Les vols de ligne, de plus en plus nombreux, ont accru le tourisme de façon exponentielle au cours des dernières décennies. Les associations France-Québec et Québec-France, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoires communs, soutenues grâce à l’action de bénévoles dans toutes les régions de France et du Québec, avec leurs voyages organisés, leurs quêtes de grands espaces, leurs pèlerinages généalogiques, leurs conférences publiques ont favorisé un vrai rapprochement. Aussi, fondés en 1987 par des personnalités de la région Rhône-Alpes, les Entretiens Jacques-Cartier en étaient à leur 32e rencontre en 2019. En 2011, leur coordonnateur principal, le professeur Alain Bideau, estimait que plus de 45 000 personnes avaient pris part à 500 colloques qui portaient sur des questions économiques et des enjeux de société.
En second lieu, insistons sur les intérêts communs, à la fois culturels et économiques, partagés par la France autant que par le Québec. À l’ère de la mondialisation des échanges et de l’ouverture des frontières, de Youtube et de Netflix, le danger de l’homogénéisation guette toutes les cultures. Issue d’une grande civilisation qui a marqué l’Occident, encore parlée sur tous les continents, la langue française reste un trésor dont il faut assurer le rayonnement.
Alors que les États-Unis, la Chine et l’Inde entendent imposer leur hégémonie culturelle, les francophones doivent se serrer les coudes et développer des institutions qui assurent au monde une vraie diversité.
C’est dans cet esprit que la France et le Québec ont fondé la chaîne TV5 en 1984 et ardemment soutenu la Convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles en 2005 sous l’égide de l’Unesco. Au plan économique, les entrepreneurs du Québec ont pu avoir accès au vaste marché européen grâce à l’Accord économique et commercial global adopté officiellement en octobre 2016 à Bruxelles. Initié par le gouvernement québécois de Jean Charest, soutenu par les gouvernements canadien et français, cet accord consacre le libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. S’ils souhaitent conquérir le marché nord-américain, les entrepreneurs français ont tout intérêt à prendre pied dans un Québec acquis au libre-échange depuis la fin des années 1980.
Enfin, et sans rien enlever à toutes ces initiatives et à tous ces acteurs qui, dans les hautes sphères des organisations internationales ou dans les associations de la société civile, ont permis aux Québécois et aux Français de se rapprocher, nul doute que l’impulsion inaugurale donnée par le général de Gaulle eut un impact déterminant. C’est d’ailleurs la thèse forte de Frédéric Bastien qui, dans Le poids de la coopération : le rapport France-Québec (Québec/Amérique, 2006), montrait à quel point les liens institutionnels entre la France et le Québec, initiés durant les années de Gaulle, avaient pesé lorsque certains dirigeants français hésitaient à approfondir cette relation privilégiée.
Sans l’ombre d’un doute, la jeunesse a énormément contribué à ce rapprochement grâce notamment à l’Office franco-québécois pour la jeunesse qui célébrait en 2018 son 50e anniversaire. En cinq décennies, c’est plus de 150 000 Français et Québécois qui auraient voyagé grâce à cette vénérable institution créée par le gouvernement de Charles de Gaulle. À ces voyages qui forment la jeunesse, il faut ajouter l’exceptionnelle coopération éducative et universitaire qui n’a cessé de s’accroître depuis les années 1960, facilitée depuis 2015 par une nouvelle entente de mobilité très profitable aux étudiants de part et d’autre de l’Atlantique. En 2016, 44 % des étudiants étrangers au Québec détenaient un passeport français, soit l’équivalent de 18 000 jeunes.
La coopération franco-québécoise lancée par l’homme du 18 juin a un riche passé mais tout indique qu’elle soit également appelée à un brillant avenir.
Éric Bédard
Historien, professeur à l’Université du Québec (TÉLUQ)
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Survivance. Histoire et mémoire du XIXe siècle canadien-français (Boréal, 2017) et L’Histoire du Québec pour les nuls (First, 2019).