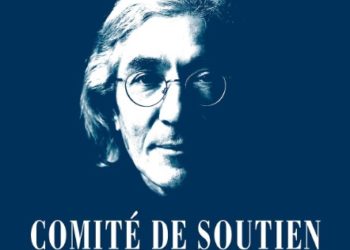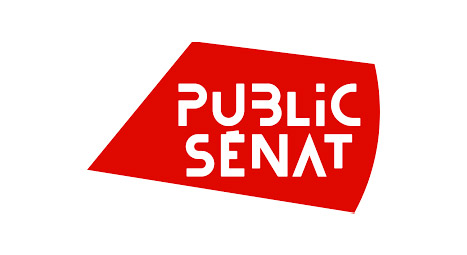Que les sociétés de l’Antiquité grecque soient, ou ne soient pas, tout du moins totalement, des sociétés de violence est une question avec laquelle on ne peut que difficilement trancher, tant cette dernière, la violence, s’y exprimant pourtant de manière structurante – nous y reviendrons – et diffuse, ne cesse d’être à la fois affirmée, justifiée, exaltée et, dans le même mouvement, critiquée, niée et conjurée. Du reste, encore faut-il être capable de définir la notion ô combien problématique de violence que la présente publication entend interroger, à partir de ses manifestations diverses, et à l’aune des enjeux socio-politiques actuels.
D’évidence, si les formes et les modalités de la violence varient dans le temps, tout autant que le degré de sensibilité de ceux qui y sont confrontés – de ce fait, la violence, en tant que concept, ne saurait se passer d’une historicisation, elle a son hic et nunc – ; si la Violence s’est, paradoxalement sans doute, incarnée au moment précis où l’Homme, roi aveugle du progrès, fut certain d’être parvenu à l’aboutissement du lent processus de « civilisation des mœurs », c’est-à-dire dans le déchaînement qu’ont constitué les Guerres du XXe siècle, avec le caractère absolu, « paroxystique », que les historiens et philosophes ont décrit ; il convient cependant de se garder de deux principaux écueils.
Le premier consiste en un relativisme – principe de variabilité des violences dans le déroulement de l’Histoire – ; le second consiste en une essentialisation historique : la violence, « c’est Auschwitz ». Les camps de la mort et, plus largement, les politiques d’anéantissement de populations, entreprises depuis le génocide arménien en 1915 jusqu’au génocide au Rwanda en 1993, constituent des exemples terrifiants. Terrifiants, parce qu’ils constituent autant d’évènements « catastrophiques », au sens que donne Georges Bataille à cette notion, dont on ne sut contenir le déchaînement et tout en supposant l’adhésion – tout du moins la participation – des masses. Dès lors, penser la violence après Auschwitz, est-ce encore possible ? Pourtant, les Grecs, eux aussi, ont connu les massacres gratuits, tel le siège de Mélos par Athènes en 416 avant l’ère commune conduisant à la mise à mort de la population insurgée, pour « l’exemple ». À cette époque, la violence de masse s’y exprime déjà. Les exactions commises par les Perses, notamment en Asie Mineure, font l’objet de longues descriptions, très largement commentées, qui confortent le mythe d’un « étranger » nécessairement barbare, car « sauvage » dans son usage de la violence.
Aussi conviendrait-il, d’ores et déjà, de différencier la violence en tant que « moment » de l’Histoire, et la violence en tant que donnée ou caractéristique d’une histoire, d’une société voire d’une population. Autrement dit, notre réflexion s’attachera moins à penser les épisodes de violence dans leur enchaînement, dans leurs discontinuités et dans leurs hypothétiques mutations afin d’en faire sourdre le sens, qu’à analyser le fonctionnement et l’utilité de la violence au sein des sociétés de la Grèce antique et ce, notamment, à partir des textes littéraires et philosophiques de l’époque. Fonction et utilité : c’est sous cet angle que la violence des Grecs peut servir d’exemple pour nos contemporains, tandis que notre société, relativement pacifiée, est confrontée à un « sentiment » de violence et de brutalité, sentiment auquel il demeure difficile, et ce pour plusieurs raisons, notamment statistiques, de donner un fondement rationnel.
Cependant, c’est moins le quantum de violence qui surprend actuellement, que la diffusion de la violence, que sa banalisation au sein de la société, notamment au-travers des rapports interindividuels ainsi que la disproportion entre le motif déclenchant la violence et le déferlement consécutif de violence. Plutôt que de parler d’une violence gratuite, nous parlerons ici d’une violence sans fondement. Car, au contraire, si la violence est présente chez les Grecs, elle participe le plus souvent du fonctionnement global de la société : soit qu’elle nourrisse l’imaginaire et justifie moralement la culpabilité (fonction théologique et philosophique), soit qu’elle structure l’ordre social et politique (fonction sociologique), soit qu’elle purge les citoyens de leurs « mauvaises intentions » (fonction cathartique). Dans cette perspective, nous ferons usage de la grille conceptuelle développée par Georges Bataille, afin de qualifier la violence grecque et sa fonction, notamment à partir de la notion de dépense. Nous verrons ainsi que la violence, durant l’Antiquité grecque, est un moyen efficace d’assurer la permanence d’une structuration sociale fondée sur l’être-en-commun des citoyens grecs, excluant du corps de la cité l’Autre, c’est-à-dire le barbare, l’esclave et la femme.
Ordre grec
Au sujet de la violence dans les sociétés de la Grèce antique, une polémique oppose – tout du moins en apparence – l’historien André Bernand à l’helléniste Jacqueline de Romilly : l’un affirmant que les sociétés grecques sont des sociétés de violence(s), l’autre tentant de démontrer que, si la violence est bien présente au sein des sociétés grecques, elle ne cesse cependant jamais – et comme dans le même temps – d’être niée et conjurée ; plus qu’une caractéristique, la violence est ce contre quoi la société grecque se tourne et s’élève.
Ces positions sont en réalité complémentaires, l’une étant la conséquence de l’autre. L’omniprésence de la violence justifie le fait que les Grecs aient tenté de conjurer, au moins en partie, des manifestations de cruauté et de barbarie, afin de bâtir un ordre socio-politique plus harmonieux et surtout plus efficient. Témoins des dérives, de la guerre, des tyrannies, des tentations impériales, ils ont inlassablement recherché à bâtir et à assurer une protection réelle, notamment par la loi, contre ces phénomènes. Aussi, sans chercher à départager ces positions, nous entendons ici penser la violence comme une modalité constitutive et structurante de l’ordre grec ; c’est-à-dire, plus précisément, de l’organisation sociale en Grèce antique.
Les sociétés grecques sont des sociétés exclusives : si certaines cités adoptent des constitutions de type démocratique, telle Athènes, le démos n’est en aucun cas le pouvoir de tous, ou de n’importe qui. Il est pouvoir du citoyen contre les Autres. Qui est l’Autre ? Les sociétés grecques ne s’entendent guère à ce sujet ; divers critères existent. Dès le VIe siècle avant l’ère commune, la question de l’identité participe de la qualité des relations entre les cités, et notamment de leur brutalité en tant que caractéristique. En effet, s’il n’existe pas, tout de moins pas totalement, de panhellénisme avant la formation de la Ligue de Délos, dont Athènes prend la tête, la conception de l’étranger dépend, par exemple, de l’organisation sociale adoptée : l’ethnos, forme socio-politique jugée archaïque, très répandue dans le nord-ouest de la Grèce, est ainsi perçue comme une forme dégradée – et donc indigne – d’ordre politique. Contrairement aux habitants des Cités (polis), ordre politique structuré autour d’institutions et d’un pouvoir central, les habitants des ethnè font l’objet de violences nombreuses. On perçoit ici combien le politique prime dans la définition d’une identité, et dans la reconnaissance de l’ami/ennemi.
D’une certaine façon, les violences exercées à l’encontre de ces habitants, de ces quasi-étrangers, peuvent être analysées comme un moyen de renforcer la légitimité de l’organisation civique de type cité et donc d’assurer sa persistance.
L’ordre grec prime, et il abhorre le désordre. Chez les Grecs, la question de l’harmonie a une place centrale : elle sert de figure, ou d’étalon, pour juger de l’efficacité, c’est-à-dire du caractère optimal, d’une organisation voire d’un rapport social. Cette recherche de l’harmonie, qui est en partie liée à une ontologie sociale de type circulaire, intégrant les différentes strates de la réalité dans un ensemble structuré, permet ainsi de justifier l’esclavage et de penser la violence en tant que dénaturation temporaire – et comme décorporation – de l’homme.
Si l’on prend la question du respect ou de la chose respectable voire admirable, on conçoit l’écart qui sépare – absolument – les sociétés grecques de notre société. En effet, Aristote lui-même ne remet pas en question le rapport maître-esclave : l’esclave est esclave par essence, le maître est maître essentiellement. Si le philosophe grec se veut le défenseur d’une société juste, c’est-à-dire éthique, c’est-à-dire, plus exactement, justement organisée et donc harmonieuse, cette société juste s’accommode de l’esclavage : ce qui compte, c’est donc l’ensemble, le collectif, la collectivité ou le fonctionnement global de la société en tant qu’unité organisée et où les individus ne sont que les membres d’un même corps. La violence ici présente est nécessaire pour le maintien de cet ordre grec. Chaque membre du corps social a ainsi, dans ce système, sa propre fonction, sa fonction naturelle et on ne saurait outrepasser cette fonction – c’est pourquoi les Grecs, s’ils s’accommodent de la guerre, de l’esclavage, voient cependant d’un très mauvais œil les soulèvements populaires : la stasis – c’est-à-dire la crise, ou ce qui vient perturber et amoindrir l’harmonie.
Nos contemporains verraient sans doute dans le témoignage d’un ancien esclave devenu libre, le parcours « poignant » d’un homme et son admirable émancipation socio-politique. Regard individualiste. Au contraire, les Grecs regarderaient, sinon avec horreur, au moins avec mépris cet ancien esclave, car on ne s’échappe guère de la nature, entendue au sens large, on ne s’arrache pas à son essence. L’esclave devenu maître n’est pas vertueux, l’émancipation en ce sens n’est pas juste, elle se fait au détriment de l’ordre. Respecter un homme parce qu’il a été esclave s’oppose à toute idée de justice aristotélicienne. Bien au contraire, le respect se trouve dans la juste reconnaissance des essences de chacun, dans la proportionnalité d’égard et d’attention vis-à-vis de l’autre. Évidemment Aristote suppose que la morale trouve son accomplissement le plus parfait dans la société politique. Les individus sont fonctionnels, utiles au regard de l’ensemble, de l’ordre grec, c’est-à-dire de la Cité. Respecter son maître, se soumettre, ce n’est pas se nier soi-même, c’est au contraire faire preuve de vertu, de justice. L’égalité n’est ici que géométrique. Le respect réside dans la concrétude, dans la réalité des caractères constitutifs. Il n’y a pas de dialectique qui tienne, Hegel n’est pas encore né : le respect, en tant que dévolution forcée, est une nécessité, car il n’est pas rationnel, il ne se pense pas, il n’est pas une capacité libératoire, il est un devoir absolu non pas en tant que respect-du-devoir mais en tant que devoir-pur.
Si l’on file l’analogie, cette question de l’harmonie se retrouve à toutes les échelles de la société : ainsi, dans Éthique à Nicomaque, Aristote décrit le respect qui unit les membres d’une famille : le respect de l’enfant à son père est plus grand, dit-il, que la tendresse paternelle. Le respect est naturel en tant que l’enfant doit à son père son existence. Le respect est ici immanent aux relations qui unissent les sujets. Aristote parle ainsi de « l’autorité naturelle du père », de cette autorité découle des hommages, des honneurs, qui sont autant de preuve de respect. Ce qui semble violence est donc moins le marqueur d’une société brutale, que la modalité nécessaire au maintien d’un ordre particulier.
Être-en-commun, l’éthique et les dieux
Chez les Grecs, la violence est aussi celle des dieux : ces derniers pillent, mentent, trahissent, violent. Ils sont concupiscents et impuissants face à la toute-puissance de leurs désirs. Un simple regard sur le mythe d’Éricthonios, fils d’Héphaïstos et de Gaïa, nous le confirme – et les exemples ne manquent pas, il suffit de consulter les fameuses Métamorphoses d’Ovide.
Il est possible d’expliquer pourquoi ces divinités violentes, par la brutalité même de la condition de l’homme grec : ce dernier est frappé par la force de la nature, à commencer par les maladies, mais également par ses phénomènes, aussi imprévisibles que redoutables à l’instar du tremblement de terre qui vient frapper Sparte en 464 avant l’ère commune – et dont les conséquences sont catastrophiques pour la cité car elles se traduisent par la fuite des hilotes, nous y reviendrons. Ces catastrophes naturelles sont, chaque fois, associées à l’expression de la colère divine (nemesis), le plus souvent en réponse à l’outrecuidance des hommes (hubris). La nature brutale est recouverte d’une mystique : c’est ainsi que l’homme apprend à habiter le monde et à manœuvrer dans le magique ou le divin de ses phénomènes.
Plus intéressant encore, les divinités sont utilisées afin de justifier des actes de violence entre les citoyens : on parle alors de possession ; tout comme la folie d’un citoyen grec est le plus souvent interprétée comme étant le fait d’un dieu, d’un maléfice.
L’explication du réel, le logos grec servant à la justification de la violence interindividuelle, entre les membres d’une même cité, ne conduit pas à une justification de la violence en tant que telle, et encore moins à sa banalisation, mais bien plutôt à une forme d’externalisalisation. Si la violence est utilisée comme modalité de formation du collectif – ou du corps social – lorsqu’elle surgit à l’intérieur de ce corps et en bouleverse l’unité fondamentale, elle devient l’objet d’une dénégation, d’une déculpabilisation. Ce qui dérange les sociétés grecques réside moins dans la violence en tant que telle que dans l’usage individualiste de la violence. Si cette dernière est une modalité du social, une caractéristique de la spiritualité – et des liturgies, notamment de certains mystères dionysiaques –, elle ne doit en aucun cas être le fait d’une volonté personnelle : elle n’est pas privatisable.
Dans le célèbre dialogue de Platon, Calliclès incarne la violence arbitraire et son exaltation la plus totale : il est un tyran, préférant aux lois de la raison celles de la nature. Immoral et cynique, il est le parfait représentant du vain prestige de la force et de la puissance. Sa puissance, réelle, nous dit Platon, est cependant une impuissance : elle n’est pas faite pour durer. D’abord, et comme naturellement, car tel est le tragique de l’être qui vit, parce qu’elle finira par s’éteindre dans un dernier souffle. S’il est vrai que l’entreprise philosophique de Socrate et, à travers lui, de Platon est mise au moins temporairement en échec, face aux arguments de l’apprenti-tyran, elle témoigne du danger, perçu déjà à cette époque, que représente l’individualisation de la force – et donc, de la violence. Les sociétés grecques, en particulier aux VIIe et VIe siècles ont connu les tyrannies – notamment celle des Pisistratides – et en mesurent les conséquences pour une société.
Si la force – et donc la violence – n’est pas un mal en soi, au contraire, il y a de bons usages de la force, i.e naturels – ces usages ne doivent s’opérer que dans le cadre de la loi et, en l’occurrence, dans le cadre des lois athéniennes. Dès lors qu’un usage de la violence volontaire est exercé, au sein de la cité, dès lors qu’il s’exprime contre la collectivité, il menace de faire s’effondrer l’ordre grec ; cette modalité de la violence s’oppose nécessairement à l’être-en-commun qui est, d’une certaine façon, la finalité, et comme la perfection, de la cité grecque.
Identité et rituel
L’être-en-commun grec, c’est-à-dire la dimension homogène du corps social, du Citoyen, dépend par ailleurs d’une conception très particulière de l’identité. Le découpage de l’espace cartographique, tel que le monde est perçu alors à cette époque, n’est pas manichéen. Il définit des régimes de légitimité, en fonction du degré d’appartenance estimé des différentes populations, depuis le Péloponnèse jusqu’aux cités d’Asie Mineure, au genos grec.
Nous l’avons dit, à partir de l’idée de défense de l’ordre grec, on peut trouver une explication à la violence s’abattant contre ce qui peut s’opposer à l’harmonie souhaitée comme finalité des sociétés grecques. Les ethnè, parce qu’elles sont des fédérations de villages, sans organisation politique particulière, le plus souvent mobiles, incarnent donc une forme anarchique de la cité et représentent des modèles ou des types contraires aux lois d’une organisation politique vertueuse. Dès lors, la violence qui s’abat sur les ethnè est moins une violence d’anéantissement, c’est-à-dire une violence destinée à mettre un terme à ce type d’organisation politique, qu’une violence servant à consolider, par la légitimité, le modèle polis dont les assaillants sont le plus souvent issus.
Si Pierre Clastres considère la violence de certaines sociétés comme un moyen de lutter contre l’apparition de l’État, on peut ici supposer que la violence est un moyen au contraire de consolider l’État et la citoyenneté comme socles d’appartenance et de solidité du corps social sur lequel l’État agit. Le partage d’une violence légitime et illégitime, toujours au regard d’actions collectives, conserve en outre un caractère rituel qui vient assurer les liens d’identité entre les membres d’une même société. D’une certaine façon, la société contemporaine, à travers l’État, procède de la même manière en régulant, voire en supprimant, un certain nombre de modèles sociaux qui se voudraient « en concurrence » par l’établissement et la régulation d’illégalismes et de normes qui referment, en la structurant, la société.
L’identité grecque (genos) ne s’adresse qu’au citoyen grec, l’homme pur, à l’exclusion de tout ce qu’il n’est pas : un enfant, jugé demi-citoyen, ou citoyen-en-devenir (télos aristotélicien) à condition qu’il soit de sexe masculin ; la femme, sous-citoyenne et maintenue comme telle dans nombre de cités grecques, à commencer par Athènes ; l’esclave, le plus souvent grec, qui peut être le fruit d’un abandon, d’un butin de guerre, d’une piraterie ; l’étranger, ou le barbare. Les sociétés grecques, celles des cités, sont ainsi organisées en plusieurs cercles, tel celui des citoyens et des futurs citoyens, soit le premier cercle : un cercle avec des prérogatives religieuses, des obligations fiscales, des privilèges sociaux, et des obligations notamment militaires, celles de défendre la Cité en cas d’attaque. En tant que privilégiés, les citoyens doivent trouver les moyens d’affirmer leur suprématie, et ce de façon à maintenir en place les structures sociales perçues comme des lois naturelles. On retrouve, sans doute davantage qu’à notre époque, ce que Foucault (1997) entendait par un racisme sans race et par une guerre des races, voire « de race » : le social devient, est fait, biologique par la force des lois. La structuration du social s’effectue à partir des différentes législations mises en œuvre dans la Cité, ainsi que du concours légitimateur du discours mythologique, et donc religieux. Le réel est comme découpé, les individus, en fonction de leur place – de leur nature politique – déterminée, sont ainsi amenés à participer ou non aux diverses activités collectives – cérémonies religieuses, combats, discussions dans l’Agora. De façon à ce que se maintienne cette fiction, l’idée d’une « nature sociale », la violence est utilisée comme un moyen de faire société, de légitimer les inégalités, d’en faire des inégalités justes.
C’est ainsi que fonctionne la cité athénienne, c’est-à-dire comme une membrane, particulièrement sélective : le corps social ne cesse d’être régulé, et ce sont les lois qui, parfois sous la menace de la violence – réduction en esclavage par exemple – s’appliquent à partager et à départager le citoyen du non-citoyen et à lutter contre toute forme d’usurpation. Si l’on prend l’exemple du métèque, étranger résidant dans la cité : ce dernier est de fait placé sous tutelle, i.e le prostates. En cas d’absence de tuteur, il se rendra alors coupable d’aprostasie. Le métèque doit également s’acquitter du metoikon, taxe spécifique qui le discrimine. En cas de non-paiement, le métèque se verra accusé d’avoir cherché à usurper une place de citoyen, à s’identifier à un citoyen grec et donc à agir contre /la/ nature : il risque l’esclavage.
Plus révélateur encore est le cas de Sparte : certains rituels sont mis en place de façon à maintenir le statut d’infériorité de l’esclave – aussi appelé hilote, c’est-à-dire l’ensemble des populations asservies au moment où Sparte s’est emparé de la Laconie. Les hilotes sont nombreux, et leur asservissement relativement semblable au servage. Avec l’objectif de maintenir l’infériorité de ces derniers, les citoyens de la cité spartiate – les homoioi – ont le devoir de les humilier et de les frapper en pleine rue. De surcroît, au sein de cette impitoyable oligarchie, un rituel est par ailleurs mis en place, prenant le nom de cryptie. Ce dernier a fait l’objet de nombreux commentaires de la part des historiens : lors de ce rituel, le futur citoyen spartiate a le droit de tuer les hilotes, sans que leur meurtre ne conduise à une sanction. Cette violence ritualisée, qui pouvait avoir une fonction stratégique, telle qu’éliminer certains meneurs parmi les hilotes, capables de sédition, constitue cependant une forme particulière de ce que Georges Bataille nomme la « dépense ».
Tout comme les sociétés grecques sont particulièrement attachées à l’aménagement d’espaces théâtraux au sein desquels comédie et tragédie viennent émouvoir et déclencher, de manière cathartique, les passions des citoyens – et ainsi, les expurger de leur violence –, la cryptie constitue un moment particulier où la société spartiate s’expurge de la violence intrinsèque par un déferlement contrôlé. Ce déferlement est d’autant plus nécessaire qu’il joue un rôle vital dans le cadre de la régulation du corps social spartiate : les hilotes représentent, au Ve siècle avant l’ère commune, environ 175 000 à 200 000 individus, pour à peine 25 000 homoioi. Le danger d’une rébellion est donc élevé, et à ce danger constant répond une violence d’institution : celle de la dépense.
Faire un panorama de la violence des sociétés de la Grèce antique suppose nécessairement d’effectuer des choix, parfois douloureux. Le matériel littéraire, à commencer par l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, apporte autant de témoignages d’une violence constante, d’une « cosmogénèse violente », qui tend à prouver que les Grecs ne sauraient concevoir une société sans violence. Violence dont ils savent penser la légitimité, les limites, et la fonction – régulatrice – notamment au regard des lois et des principes d’une Cité vertueuse.
De fait le concept de violence pour les Grecs anciens se constitue en tant que principe régulateur dans une société qui se pense comme unité et dont les parties, les citoyens ainsi que l’ensemble des Autres qui y gravitent – jusqu’à parfois la mettre en danger – sont autant d’agents régulateurs.
La société grecque n’existe qu’en tant qu’elle se décompose en un système impliquant un rapport de force(s) complexe, dont il convient de préciser les modalités. Ainsi, l’expression de corps social prend tout son sens dans la cité grecque : depuis la famille, et le pouvoir du père, qui est un pouvoir de violence – et d’autorité légitime –, jusqu’aux différentes formes de gouvernement, formalisées progressivement par des textes de loi. En effet, à regarder les modalités de la violence s’exprimer – violences légales et justifiées, à commencer par celles de l’esclavage et de la soumission des femmes – on comprend aisément combien l’idée d’un système politique global, quoique soutenable du fait de la relative petitesse démographique des cités, suppose de violence régulatrice.
Ainsi ce dont la violence chez les Grecs témoigne, réside avant toute chose dans sa capacité à « tenir » le corps social, et non seulement à le tenir, mais à le vitaliser, à l’actualiser, en d’autres termes, à le rendre « fonctionnel ». Que ce soit à travers la guerre, fréquente entre les cités, ou bien plus largement à travers leur organisation politique, les sociétés ne cessent de se stimuler et d’assurer ainsi leur pérennité, parfois à leur propre péril. D’une certaine façon, à l’instar des réflexions de Pierre Clastres s’agissant du rôle de la guerre dans les sociétés primitives comme facteur de production de la tribu, la violence chez les Grecs peut apparaître comme étant moins une question politique, y compris lorsqu’elle est légale, qu’une question sociale. Elle est un opérateur de société.
La dépense comme nécessité
La pensée de Georges Bataille peut ici être rapprochée des analyses de Pierre Clastres, en ajoutant que la violence, en tant que nécessité sociale, constitue également pour les tribus un moyen de renforcer la vitalité interne de leur organisation. Chez les Grecs, la violence fonctionne sur le même mode, elle constitue en propre un moyen de « dépense ». Par la constitution d’une identité grecque au travers de la lutte contre les Perses, par l’idée d’un combat sacrificiel, c’est bien souvent la dépense qui s’exprime et donc, plus exactement, la nécessité pour une organisation sociale de concevoir les modalités de sa propre exsudation, de sa propre expurgation. L’homme grec est indissociablement lié à une forme de frénésie qui, quoique contrôlée, s’exprime au travers de différents rituels – rituels contre lesquels, et en particulier s’agissant des mystères, le pouvoir politique tentera de s’opposer. On ne fera cependant pas des sociétés grecques des sociétés de dépense à part entière dans la mesure où l’ordre, et en particulier l’ordre militaire, tend à domestiquer cette violence et à la transformer en violence « utile ». Comme l’écrit Georges Bataille, l’ordre militaire « fait de la conquête une opération méthodique en vue de l’agrandissement d’un empire ». La lutte pour la violence, chez les Grecs, s’inscrit ainsi dans le cadre d’une dialectique, plus ou moins fortuite, entre gratuité de l’acte violent et nécessité de canalisation de la frénésie dilapidatrice.
Le corps social est un ensemble que la violence régule doublement. D’abord, de manière interne, par la force s’accomplissant sur chacun de ses membres, au sein des relations interindividuelles. Durant l’Antiquité, la collectivité importait bien plus que l’individu, pour autant, malgré l’apparition d’un droit positif et de lois écrites, on constate que la violence s’exprime autant entre les membres de la société – citoyens contre esclaves, par exemple – qu’entre le pouvoir politique et les membres de la dite-société. Autrement dit, l’externalisation de la violence ne s’opère qu’à des degrés variables et très relatifs.
Nos sociétés contemporaines témoignent d’un renversement du rapport violence interne/violence externe, à partir de la notion d’État, laquelle induit le transfert de la violence interne légitime à une entité supérieure, de façon à ce que la contrainte soit appliquée de manière uniforme, proportionnée et donc juste. Cette redéfinition de la violence légitime, consubstantielle de la naissance de l’individualisme – et donc de la liberté individuelle, de sa protection autant que de ses limites –, prend corps avec la construction d’une police et, plus exactement, d’une « force » policière : la force – ou violence – publique.
La régulation externe de la société s’effectue ainsi, de nos jours, au travers de la capture du « monopole de la contrainte légitime ».
On voit cependant combien cette violence structurante, la contrainte, ne répond en rien aux nécessités d’une dépense et est même contradictoire avec celle-ci : en effet, comment penser au sein d’une société ordonnée la possibilité du désordre – aussi transitoire soit-il ? Les sociétés contemporaines, imprégnées d’un rationalisme puissant, ne peuvent ainsi penser la dépense que comme un gaspillage, c’est-à-dire comme une aberration. Une violence dilapidatrice ne saurait être qu’une barbarie.
Pour autant, nos sociétés ont fait face à des guerres inédites, de par leur ampleur et leurs brutalités, et plus récemment à des phénomènes de privatisation de la violence, se traduisant par des formes des démonstrations de forces toujours plus conflictuelles, des incivilités quotidiennes et des agressions bien souvent gratuites. Dans cette perspective, l’effroi qui nous saisit face à l’impression d’un accroissement des actes de barbarie, des agressions voire des meurtres gratuits, serait moins le symptôme d’une société devenue tout à coup plus brutale, que d’un dysfonctionnement des forces internes, circulant au sein du corps social. Souligner la place de la crise des institutions dans le délitement de la « solidarité » interindividuelle ainsi que l’exaltation de l’individualisme au sein de la société de consommation
peuvent servir afin d’expliquer la progressive privatisation de la violence – c’est-à-dire la violence légitime non plus en tant que monopole externe, ou public, mais en tant que droit individuel. Pour autant, et c’est également une « leçon » de l’usage de la violence chez les Grecs, bien comprise par le philosophe Georges Bataille, l’absence d’aménagement de la dépense dans la société contemporaine en constitue une cause sans doute plus fondamentale.
*
* *
Par la catharsis, par les Olympiades, par la guerre, les Grecs savaient combien de violence il fallait pour nourrir, et expurger, une société. Pour autant, comme le souligne Georges Bataille, le capitalisme, et plus largement le rationalisme moderne par son culte de l’accumulation, ne permet plus de penser des phénomènes de perte pure, telle que la dilapidation des ressources – c’est-à-dire la suppression volontaire de l’excédent, une suppression sans but, injustifiée. Ce que le philosophe nomme encore la part maudite, c’est-à-dire la condamnation par les sociétés modernes de la dépense, serait une cause fondamentale du dysfonctionnement des sociétés – tout du moins occidentales. Les guerres du XXe siècle, toujours selon le philosophe, constitueraient ainsi des formes « catastrophiques » de la dépense, puisque tout à coup, l’énergie excédentaire qui cherche à se dilapider sans qu’on le lui permette, provoque un conflit mondial.
Notons, plus précisément, que les guerres mondiales ne sont pas des formes de dépense, elles sont à proprement parler des catastrophes, c’est-à-dire des dépenses avortées, ou des conséquences de la non-dépense.
Elles traduisent le mal-de-dépense, son absence autant que son impérieuse nécessité.
La violence dite « gratuite » ne constitue pas non plus une forme de dépense : elle en est la reproduction désubstantialisée, l’ersatz de la dilapidation ; elle cherche, mais ne trouve rien, c’est une violence a-symbolique, amorale, une forme pure et paroxystique du nihilisme contemporain. La dépense est vitale, à la fois parce qu’elle vitalise mais également parce qu’elle assure plus largement la (sur)vie de l’organisme concerné. Reste à concevoir une modalité de la dépense qui ne passe pas nécessairement par la violence. Georges Bataille proposait le jeu, l’oisiveté, l’augmentation des cérémonies fastueuses et de l’ordre politique souverain – dont il concevait cependant le dangereux pouvoir de fascination sur les masses. Il semble ainsi tout autant nécessaire, pour une société, de disposer de manière rituelle d’une capacité de dépense improductive. Cette dépense peut prendre la forme rituelle de cérémonies, exaltant la « force » des institutions, mais également de dispositifs économiques qui, l’espace d’un instant, viennent trancher dans la compétition interindividuelle, par la distribution pure de moyens de dépense. Rêvant d’un monde où la guerre serait remplacée par une économie mondiale, prenant la forme de l’économie générale de la dépense, Georges Bataille écrit ainsi à propos du Plan Marshall : « Les êtres que nous sommes ne sont pas donnés une fois pour toute, ils apparaissent proposés à une croissance de leurs ressources d’énergie (…). Mais dans cette subordination à la croissance, l’être donné perd son autonomie, il se subordonne à ce qu’il sera dans l’avenir, du fait de l’accroissement de ses ressources. En fait, la croissance doit se situer par rapport à l’instant où elle se résoudra en pure dépense ».
La dépense n’est pas utile : elle est nécessaire. Demeure donc, toujours en suspens, la question de sa modalité ; modalité que la société contemporaine peine encore à établir. Toute la difficulté semble résider, actuellement, dans la rénovation de l’être-en-commun, dans le maintien de ce dernier et, s’il le faut, dans sa réformation. Le philosophe, désespérant, conclut ainsi : « Je suis ce fou. Très précisément en ce sens que, de deux choses l’une : ou l’opération manquera, et le fou que je suis se perdra dans un monde qui ne sera pas moins insensé que lui ; ou elle aura lieu, et seul en effet le fou arrivera alors à la conscience de soi dont je parle ».
Catherine de La Robertie
Préfète de l’Ain
Victor Dumiot
ENS Lyon