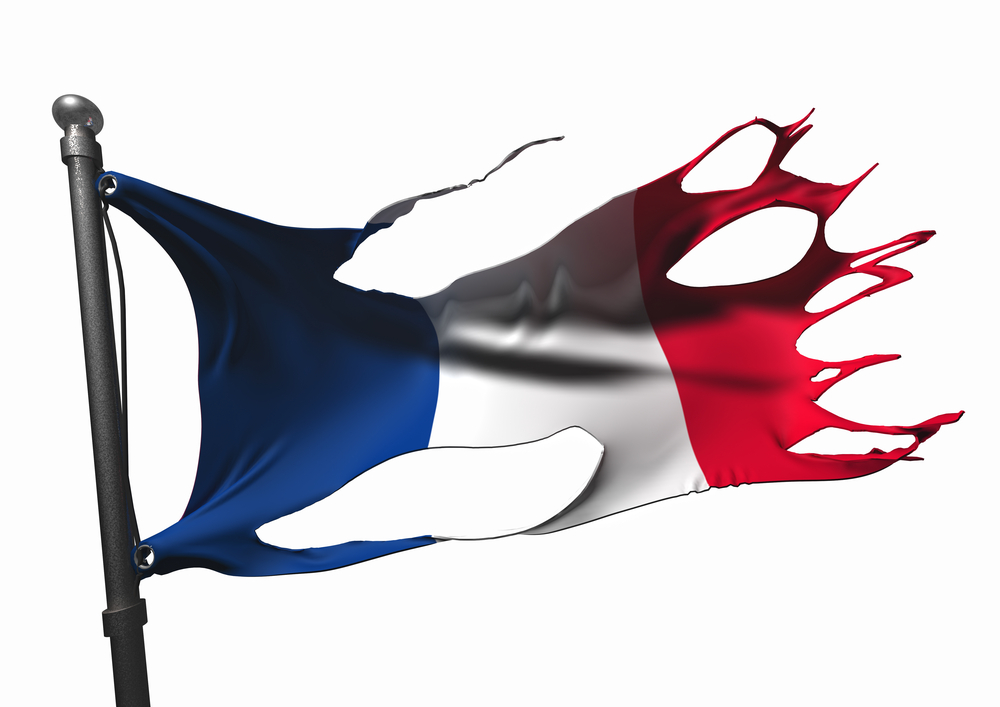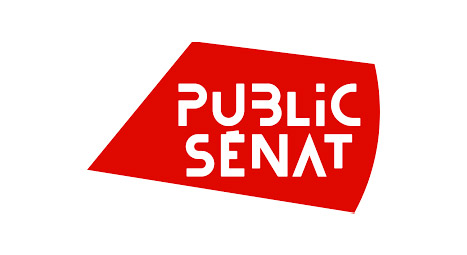Au début des années 1950, alors que les Français commençaient de s’enthousiasmer pour la voiture automobile – c’était le temps de la 4 CV Renault, de la 2 CV Citroën, on avait coutume de dire que le réseau national de France était le meilleur d’Europe, sinon du monde, et qu’il n’était nul besoin de construire des « autostrades » ou « autoroutes » comme les USA, l’Allemagne et l’Italie avaient entrepris depuis deux décennies de le faire.
La France disposait effectivement d’un excellent réseau, tracé par les ingénieurs du XVIIIe siècle et construit grâce à la corvée, macadamisé puis bitumé au fil de la modernisation des techniques ; cet excellent réseau, jamais adapté à la circulation de lourds camions, ne résista pas au catastrophique hiver 1962-1963, obligeant ensuite, durant près de trente ans, à une politique de remise à niveau longue et contraignante – les renforcements coordonnés. Mais ce réseau n’était pas mieux adapté à la circulation de plus en plus importante ; on lança péniblement les radiales autour de Paris, le périphérique à l’aide d’un outil financier, le Fonds spécial d’investissement routier, garantissant en théorie l’affectation d’une part de la TIPP à la création de nouveaux itinéraires. Las ! dès 1952, deux ans après sa création, le fonds cédait aux coups de butoir des budgétaires, finissant par fondre progressivement.
Les débuts
Dès 1952, Antoine Pinay, ministre des Travaux Publics, proposa une loi envisageant la nécessité – dans le futur – d’un réseau d’autoroutes interurbaines ; mais dans l’immédiat, il mettait au débat la création d’une autoroute entre Paris et Lille. Pour la première fois, conscient de la nécessité d’un financement extra-budgétaire, il évoqua le recours à la concession à péage, dérogeant ainsi au sacro-saint principe établi par les révolutionnaires en 1792, suivant lequel tout péage (féodal) était abrogé et désormais interdit.
Après bien des débats, une loi fut prise en 1955, instituant en préalable que l’usage d’une autoroute est, en principe, gratuit, mais que dans des cas exceptionnels, l’État peut mettre en place des concessions, dont les cahiers de charge « peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages pour assurer l’intérêt et l’amortissement des capitaux investis par lui, ainsi que l’entretien et éventuellement l’extension des autoroutes ». Deux points très importants doivent en être retenus.
En premier lieu est établi ainsi le principe même de la concession, suivant lequel le concessionnaire s’endette à la place de l’État pour construire une infrastructure qui appartient à l’État dès sa mise en service, et pour l’entretenir jusqu’à la fin de la concession, à ses risques et périls ; la durée de la concession est calculée pour qu’il rentre dans ses frais en remboursant et rémunérant le capital investi.
En second lieu, le législateur envisage, dès 1955, la prolongation de la durée de la concession pour couvrir l’extension éventuelle du réseau ; il s’agit clairement de ce que l’on a appelé, bien plus tard, l’ « adossement », basé sur un constat cynique, mais combien réaliste : une ressource ne peut être durablement affectée que lorsque l’affectation est régie par un contrat, faute de quoi la guerre d’usure des budgétaires est toujours gagnante.
Les débuts furent lents : 1957, création de la société Estérel-Côte-d’Azur – un peu loin du projet d’autoroute Paris-Lille d’Antoine Pinay, mais c’était une première pierre de l’édifice, suivie en 1958 par la société de l’autoroute Vienne-Valence, ratifiée en 1961 seulement car le même Antoine Pinay, cette fois ministre des Finances, bloqua tout projet d’investissement en 1958-59 pour mener sa politique de rigueur. Pour la petite histoire, il aurait emprunté la route nationale le Vendredi Saint avant Pâques 1958, et constatant la fluidité du trafic sur la nationale, aurait décrété qu’il n’y avait nul besoin d’autoroute ; les ingénieurs parlèrent de l’ « enchantement du Vendredi Saint ».
Une première accélération
Après la rigueur, la relance : le premier schéma directeur, instituant 2000 km d’autoroutes concédées, fut approuvé en 1960. Désormais, le principe de la concession à péage était admis – on n’ira pas jusqu’à dire accepté – comme système de financement pérenne, et l’on supprima le caractère « exceptionnel » du péage dans la loi.
Deux ans plus tard, le schéma directeur fut complété ; on décida d’accélérer la réalisation, et l’on utilisa pour la première fois le principe d’adossement, en passant des avenants avec les sociétés pour prolonger leur réseau – et la durée de leur concession. Mais les sociétés concessionnaires n’étaient encore que des faux nez de l’État, la construction était assurée par la maîtrise d’ouvrage des services des Ponts et chaussées.
À la fin 1969, le réseau atteignait péniblement 1010 km de longueur ; l’année suivante, l’axe Paris-Marseille était achevé, inauguré par le président Pompidou sur une aire au-dessus de Beaune qui comporte encore le mémorial de cet événement magique pour la France. Un seul autre axe était terminé, le Paris-Lille ; pour le reste n’existaient que des tronçons ici et là.
La libéralisation
L’arrivée d’Albin Chalandon, ministre de l’équipement en juillet 1968, libéral dans l’âme, et méfiant vis-à-vis de l’administration des Ponts et chaussées, vint bousculer à nouveau ce cadre ; conscient de l’énorme retard pris par rapport aux pays voisins en matière de desserte des territoires, le ministre mena la réforme sur deux fronts. Le premier était le recours au financement privé, pour accélérer la mise en place de financements non garantis par l’État ; le second était la transformation des sociétés concessionnaires publiques, désormais détachées des services territoriaux des Ponts et chaussées pour devenir – en théorie – autonomes. Cofiroute fut la première société privée de plein exercice, pour desservir l’ouest ; le seconde, AREA, fut chargée de concessions d’autoroutes à l’est de Lyon vers les Alpes ; une troisième, APEL, eut à relier Paris avec l’est de la France – non sans une bataille homérique entre Metz et Nancy, et un passage obligé par Reims, qui rendit sa vie difficile ; enfin la quatrième, ACOBA, devait relier Bayonne à la frontière espagnole. Quant aux sociétés concessionnaires publiques, elles virent à nouveau leurs durées de concession prolongées pour assumer la construction de nouvelles sections d’autoroutes. Et l’on n’oubliera pas la création des deux sociétés tunnelières, celle du Mont-Blanc et du Fréjus.
Le rythme de construction s’accéléra dès lors de façon importante : à la fin des années 1970, le réseau atteignait désormais 3800 km ; la liaison autoroutière était continue de Paris à Perpignan, à la frontière italienne, vers Metz ou vers Bâle, vers Lille et le Pas-de-Calais, vers Tours et Rennes. Une seule transversale existait alors, de Perpignan à Bordeaux en passant par Toulouse.
La crise pétrolière de 1973
Mais la première crise pétrolière de 1973 eut un effet délétère pour les sociétés les plus jeunes, tout particulièrement celles, comme APEL, dont les travaux se déroulèrent pour l’essentiel après sa survenue, augmentant le coût des travaux de plus de 25 %, et baissant la courbe d’évolution des trafics prévus initialement. Paradoxalement, ce fut au premier septennat de François Mitterrand qu’il appartint de résoudre la crise posée par les difficultés financières des concessionnaires, alors même que la suppression du péage de concession figurait parmi les priorités du ministre communiste des transports Charles Fitterman. Mais le principe de réalité prévalut à l’époque : racheter l’ensemble des concessions n’était pas une priorité lorsque des pans entiers de l’industrie, de la banque et de l’industrie étaient en cours de nationalisation.
Une importante réforme fut alors entreprise pour mieux solidariser les sociétés publiques entre elles, en particulier pour aider les plus jeunes d’entre elles en les adossant à un établissement public alimenté par les plus matures ; les sociétés privées en difficulté furent absorbées par les sociétés les plus matures, ce qui était en définitive un moyen de les nationaliser à bon compte pour l’État.
Une reprise flamboyante
L’année 1986 allait entraîner une brutale inversion du cycle économique, grâce à une baisse importante du prix du carburant, permettant une reprise spectaculaire et une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années du trafic automobile. Ce fut, enfin, l’occasion de transformer tant d’incantations sur la nécessité de casser le radio-concentrisme parisien, en une politique ambitieuse de desserte des territoires: un comité interministériel d’aménagement du territoire réuni en 1987 dressa enfin sur la carte de France les axes transversaux qui lui manquaient, un premier au sud de la Loire, choisi entre Lyon et Bordeaux, et un autre plus au nord formant une très grande rocade de Paris par Troyes, Sens et Tours, enfin un troisième au nord par Amiens, Rouen, Alençon. Et l’on décida de doubler le rythme de construction annuel, en passant à 240 km en moyenne par an. Un nouveau schéma directeur fut mis en chantier ; approuvé en 1988, il fut complété en 1990, puis à nouveau en 1992, pour porter le réseau national à 9540 km d’autoroutes de liaison (essentiellement à péage).
Pour cela, une nouvelle réforme du système concédé public fut entreprise, et l’on utilisa à nouveau le principe de l’adossement pour dresser ce plan très important ; les autoroutes à construire furent inscrites en principe dans les cahiers des charges, en attendant la négociation de l’allongement nécessaire à leur prise en charge, qui intervint dans les années suivantes, les portant, suivant les cas, entre 2015 et 2018. L’important, et c’était vraiment tout l’enjeu de ce plan, était de parier sur le futur de ces nouvelles infrastructures, en faisant supporter le risque d’un trafic de départ plus faible par des sections déjà rentables. Mais l’État confirma, au passage, un principe jamais remis en question : les tarifs sont fixés par lui, sur proposition des sociétés concessionnaires, et en fonction de règles bien établies dans leurs cahiers des charges. La liberté de fixation des tarifs par les sociétés concessionnaires n’a jamais été qu’un mythe entretenu par les détracteurs du système.
Cette réforme considérable fut suivie, en 1994, par la mise en place des trois groupes publics afin de permettre la péréquation financière entre les sociétés les plus importantes (ASF, APRR, SANEF) et les sociétés plus petites (ESCOTA, AREA, SAPN) qui avaient à faire face à des engagements très importants en regard de leur chiffre d’affaire.
Ainsi, en 1997, atteignait-on une longueur de réseau de 7 365 km. Il restait encore à boucler la grande transversale Lyon-Bordeaux, déjà concédée à ASF, ainsi que des tronçons d’autoroutes concédés en principe par la réforme de 1988 à certaines sociétés, mais non encore contractualisés.
Les grandes réformes
Mais le système de l’adossement était en butte aux coups de boutoir répétés de la Cour des Comptes et de la Commission Européenne. La première, au motif que le système était considéré comme permissif, autorisant à tordre les mécanismes comptables pour satisfaire les besoins des ingénieurs en mal de construire, et ceux des élus en mal de desservir leurs territoires : la seconde, au motif que le système était considéré comme anti-concurrentiel, permettant à des sociétés d’engranger de nouvelles concessions sans qu’il y ait eu d’appel à concurrence. Pour satisfaire la Commission, un accord passé en 1998 entre le Gouvernement et le Commissaire à la concurrence de l’époque, Mario Monti, excluait de l’adossement toutes les concessions non encore négociées, en les réservant à une mise en concurrence nouvelle. Pour satisfaire la Cour des comptes, une réforme considérable du système comptable des sociétés concessionnaires publiques fut menée en 2000, les faisant devenir des sociétés privées nationales de plein exercice, désormais privées de la garantie de leurs emprunts, mais dotées d’un capital suffisant pour leur permettre d’assumer leurs échéances, et d’une durée de concession adaptée, prolongée de 2028 à 2032 suivant les sociétés.
Ces deux réformes quasi simultanées eurent deux effets opposés. La première conduisit à la mise en concession « autonome » de tronçons plus ou moins longs, allant d’une vingtaine à une centaine de kilomètres ; à vrai-dire, de nouveaux acteurs se sont positionnés dans ce créneau, ce qui est bien, mais la communauté publique est perdante. En effet, la rentabilité aléatoire de telles sections rend nécessaire des concessions longues avec des péages élevés, alors que le système de l’adossement permettait, moyennant des prolongements limités (de l’ordre d’un an ou deux), de construire de telles sections en y appliquant des tarifs proches des tarifs pratiqués sur le reste du réseau. De plus, l’adossement permettait la mutualisation du risque trafic des sections ajoutées avec celui du réseau existant, permettant ainsi de diminuer d’autant le coût transféré à l’usager.
La deuxième réforme, dès lors qu’elle avait transformé les sociétés publiques en sociétés de plein droit, les rendait… privatisables.
La privatisation
Cette privatisation, commencée en 2002 sous le gouvernement de Lionel Jospin, intervint en 2005, sous le gouvernement de Dominique de Villepin. Elle rapporta 22,5 Mds d’euros à l’État, et lui permit de transférer 30 Mds de dettes sur le secteur privé, opération qu’on a tendance, 15 ans après, à minimiser dans son aspect positif pour l’État ; les meilleurs experts furent alors sollicités, de part et d’autre, et l’ensemble des autorités en charge donnèrent leur avis.
Après la crise de 2008, dans le cadre de la loi de relance, les sociétés concessionnaires furent mises à contribution par le Gouvernement pour mettre en place un « plan vert » de relance spécifique de 1 Md d’euros, financé par adossement et prolongement des concessions ; ceci fut possible après un processus long conduisant à une décision de non-opposition par la Commission européenne, les travaux réalisés ne pouvant être disjoints du réseau pour faire l’objet d’une concession autonome.
Une crise politique aiguë et un dénouement en forme de relance
On ne peut évidemment, dans cette petite histoire, ne pas évoquer la crise « autoroutière » de 2014-2015, engendrée par la succession d’un rapport de la Cour des comptes et d’un autre du Conseil de la concurrence, tous deux à charge sur la gestion des rapports contractuels entre l’État et ses concessionnaires, puis de la décision de la ministre de l’Environnement de mettre fin à l’écotaxe, enfin de la décision de la même ministre de geler l’augmentation contractuelle annuelle de 2015.
Les remous politiques, à la suite de ces événements, ont été intenses, au point de conduire le gouvernement de Manuel Valls à s’interroger sur l’opportunité d’une nationalisation du secteur, sur l’initiative d’un groupe de députés de la majorité.
D’une façon assez aiguë, cette crise a montré la contradiction entre un système d’État régi par le contrat pluriannuel et la confiance des parties, qui échappe nécessairement à l’annualité et au vote budgétaire puisqu’il a été construit comme tel, et le souhait des élus de la Nation et du gouvernement de contrôler ou d’infléchir le déroulement du contrat par les processus habituels législatifs et exécutifs ; une contradiction encore renforcée par les gardiens sourcilleux du dogme de l’annualité budgétaire que sont la Cour des comptes et Bercy. Ici encore, comme en 1981, le réalisme a prévalu : nationaliser les sociétés aurait équivalu à une mise de fonds de 40 à 50 Mds d’euros, pour se retrouver avec un réseau de 10 000 km à entretenir, sans ressource pour financer cet entretien, et en perdant les recettes fiscales engendrées par le secteur, soit près de 4 Mds annuels… Il convient de ne pas oublier que l’impôt sur les bénéfices des sociétés représentait en 2018 près de 2 Mds, soit 5 % du montant total de l’IS encaissé par l’État cette année.
Si la voix de la raison a prévalu, elle a néanmoins conduit à des réformes profondes, avec l’extension aux autoroutes de la compétence d’une autorité de contrôle indépendante, l’ARAFER, ainsi que l’extension du pouvoir du Parlement à qui doivent être soumis avenants aux concessions existantes et projets de concessions nouveaux ; de plus, les sociétés concessionnaires comptant des entreprises de BTP dans leur actionnariat ont accepté de mettre en place un observatoire commun pour suivre la passation des marchés de travaux. Ceci a permis la mise en place d’un plan de relance de 3,3 Mds d’euros décidé en 2015, consistant essentiellement en intégrations de sections de réseau national « orphelines », d’élargissements, et de constructions d’échangeurs et de diffuseurs attendus par les élus. Un deuxième plan, moins ambitieux, de 700 M d’euros, a été lancé à la fin de la mandature de François Hollande, cette fois basé sur une légère augmentation tarifaire.
Et maintenant, la concession : pourquoi et pour quoi ?
La longueur du réseau atteint désormais 9 200 km ; on peut considérer que l’essentiel est fait en matière de liaisons interurbaines. Alors, doit-on se contenter d’attendre la fin des concessions, en 2031-2036, et regarder passivement les voitures rouler, qu’elles soient à moteur thermique comme aujourd’hui, électrique comme demain, avec chauffeur aujourd’hui ou sans chauffeur demain ?
Les enjeux d’une mobilité décarbonée accessible à tous les citoyens sont considérables ; paradoxalement, on les voit toujours majoritairement aux abords des métropoles où, il est vrai, la décarbonation est un enjeu fondamental, mais l’accessibilité de proximité doit être aussi au cœur de la réflexion de tous.
La concession est un outil, fabuleux en ce qu’il permet de gérer sur le long terme, avec une ressource affectée ; mais aujourd’hui son domaine, restreint au champ de l’infrastructure, doit être élargi pour pouvoir traiter d’enjeux connexes et désormais de la même échelle d’importance que l’infrastructure elle-même.
Les services de la mobilité ; la gestion de l’intermodalité et des passerelles entre modes, qu’elles soient servicielles ou infrastructurelles ; la fourniture des relais nécessaires à l’approvisionnement en énergie, bornes électriques ou stations à hydrogène sont autant de champs sur lesquels devraient s’étendre les concessions dites autrefois d’autoroutes.
Au-delà de ces aspects fondamentaux, un autre doit être présent à l’esprit de tous : qu’en est-il de la résilience de nos réseaux d’infrastructure ? Pour certains, ce n’est d’ailleurs même pas de résilience qu’il s’agit, mais simplement et basiquement de l’entretien ou des grosses réparations, que les budgets publics ont de plus en plus de mal à mettre en place. Ici encore, pourquoi ne pas réfléchir à une extension des concessions trop strictement limitées à l’objet autoroutier ? Des exemples existent déjà, l’un des plus récents étant le prolongement de l’autoroute A40 avec la reprise par la société concessionnaire du fameux viaduc des Égratz vers Chamonix et le tunnel du Mont Blanc ; il faut aller plus loin.
Mais on ne doit pas, en cela, oublier le déclencheur de la crise de 2015 : ce sentiment que les concessions s’allongent pour le seul bénéfice des concessionnaires, ancré depuis des lustres dans l’esprit des médias, et malheureusement de beaucoup de décideurs, par méconnaissance des réalités chiffrées et l’oubli de la fiscalité sans cesse alourdie. Il faut certainement que l’adossement, qu’il soit en durée, en tarif ou en extension de domaine de compétence, soit encadré par une régulation et un partage des profits comme des risques entre l’État et son concédant. C’est à ce prix que le système de la concession devrait participer utilement à la mise en place d’une mobilité décarbonée et accessible à tous.
Jean Mesqui
Ingénieur général des Ponts et chaussées (e.r.)
Président de l’Union routière de France