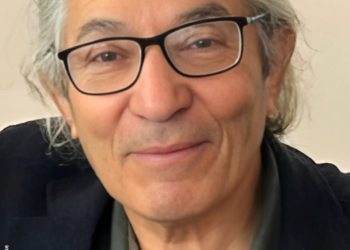Au premier semestre 2021, les députés du Parlement espagnol devront approuver ou non la nouvelle loi de « Mémoire Démocratique », visant à clore définitivement le chapitre de la Dictature franquiste ayant commencé avec la Guerre civile. Mais il n’est pas certain que cette loi permettra à l’Espagne de mieux accepter son passé, comme le souligne Nathan Le Guay, qui y voit davantage le fruit d’une époque où l’unité et l’identité de la Nation espagnole sont remises en cause.
Le 15 septembre dernier, a été présenté et approuvé en Conseil des Ministres un projet de loi dit « de la Mémoire Démocratique », qui se veut une réactualisation de la loi de Mémoire Historique portée en 2007 par le gouvernement de José Luis Zapatero. Le présent projet de loi, dans la continuité de la précédente loi, a pour objet la « récupération, la sauvegarde et la diffusion de la mémoire démocratique ».
Cette nouvelle loi a pour objet les victimes de la Guerre Civile espagnole et du franquisme en général ; elle cherche également à débarrasser l’Espagne des derniers vestiges de la dictature, et des symboles à sa gloire encore présents sur le territoire espagnol.
Le gouvernement semble donc vouloir mettre de l’ordre dans l’histoire nationale. Cependant, si elle entend déloger Franco de son piédestal, la loi de Mémoire Démocratique ne revient nullement sur la loi d’amnistie votée en 1977, qui, tout en libérant les prisonniers politiques de la dictature, protégeait par la même occasion les cadres de l’Etat franquiste de toute poursuite judiciaire.
Jeter un regard nouveau sur les décennies de franquisme
En 66 articles répartis en 5 parties, la loi de Mémoire démocratique revient sur l’héritage laissé par la dictature.
Elle témoigne d’une volonté de l’Etat espagnol de reprendre en main cet héritage encombrant et d’en changer le sens.
Cette volonté se traduit par plusieurs mesures concrètes.
L’une des plus notables est l’interdiction des sociétés faisant l’apologie des dictatures et des figures dictatoriales. La Fondation Francisco Franco, la plus célèbre d’entre elles, deviendrait donc illégale. Cette association, dont le but est « d’exalter la figure du général Franco », gêne, et gêne d’autant plus qu’elle a reçu plusieurs subventions de fonds publics, entre autres pour la numérisation de plus de 30 000 documents officiels, qui restent scellés dans les archives privées de la Fondation.
L’autre point important de cette loi est la question du statut du Valle de los Caidos, l’abbaye bénédictine que le dictateur a fait construire entre 1940 et 1958. Actuellement administré par les moines bénédictins à qui Franco l’a confié et dans lequel il était naguère enterré, le Valle de los Caidos deviendrait selon la loi de Mémoire Démocratique un cimetière civil public.
Depuis 2018, le gouvernement de Pedro Sánchez essayait de modifier le statut du Valle de los Caidos, pour en faire un musée et un lieu de mémoire. La polémique engendrée par le déplacement des restes de Franco, puis l’épidémie de coronavirus, ont retardé les projets du gouvernement socialiste.
Enfin, l’on peut aussi noter le projet de déchéance de 37 familles anoblies pendant la dictature, selon une loi promulguée par Franco lui-même qui l’autorisait à attribuer des titres de noblesse.
Toutes ces mesures illustrent certains changements de paradigme dans la relation de l’Etat espagnol à son passé. Cependant, elles relèvent essentiellement du symbole, sans changer grand-chose pour les espagnols ni abolir la loi d’amnistie de 1977.
Des vœux pieux
C’est là sans doute le problème de cette loi : ses auteurs déploient toute une armée de métaphores et d’expressions parfois assez floues pour combattre les discours et les symboles franquistes, mais ne changent rien concrètement.
On en reste au stade de la polémique, on se contente de lui donner un cadre et de restreindre la parole de ceux qui louent l’ancien dictateur, restrictions qui ne sont d’ailleurs pas clairement définies.
En fait de mesures de réparation aux victimes, la loi proclame bien des grands principes, sans toutefois donner de précisions quant aux moyens envisagés pour les mettre en application. Les législateurs parlent volontiers de « réparation morale » et de « garanties de non-répétition », mais cette demande de pardon n’a de sens que si elle se traduit par des actes concrets.
Dans cette perspective, la loi prévoit la possibilité, pour les descendants d’exilés nés à l’étranger, de se faire naturaliser ; de même pour les anciens volontaires des Brigades Internationales ayant soutenu la République espagnole pendant la Guerre Civile. Toutefois, aucune précision n’est apportée sur les moyens, et surtout sur les conditions d’obtention de la nationalité.
De plus, de telles dispositions semblent moraliser l’histoire, comme si la bonne Espagne avait été cette nation démocratique défaite par une mauvaise Espagne affiliée au fascisme, qu’il fallait louer la première, et se repentir pour la seconde.
Cette loi puise dans un héritage résolument républicain, ce qui est d’ailleurs passablement embarrassant pour l’actuelle lignée royale qui, si elle a contribué à rétablir la démocratie, doit tout de même son trône au dictateur.
En outre, on peut s’interroger sur les attributions concrètes du nouveau ministère public de Mémoire Démocratique et des Droits de l’Homme, dont la création au sein du Tribunal Suprême est prévue par la loi. Bien plus, on peut craindre certaines prises de position idéologiques versant dans une lecture partisane de l’Histoire.
Plus qu’une loi sur le passé, le signe d’une crise politique contemporaine
En vérité, la loi de Mémoire Démocratique nous en dit plus sur le présent que sur le passé, notamment parce qu’elle s’inscrit dans un contexte politique spécifique. En effet, depuis le 4 janvier 2020, l’Espagne est dirigée par un gouvernement de coalition entre les socialistes du PSOE et l’extrême-gauche représentée par Podemos auxquels sont mêlés les écologistes catalans. Ne disposant pas de majorité absolue au Congrès des Députés, le gouvernement Sánchez est dépendant des indépendantistes catalans.
La disposition de la loi visant à révoquer certains jugements rendus pendant la dictature, et notamment celui de Lluis Companys, figure de l’indépendantisme catalan fusillé en 1940, peut donc apparaître comme une forme de flatterie opportune pour plaire à cette frange des députés.
Peut-être une telle disposition est-elle nécessaire, mais dans les faits elle alimente des débats idéologiques, et donne plus de légitimité à un mouvement anticonstitutionnel, que le gouvernement, en tant que gardien de cette même Constitution, devrait réprouver.
De même, la volonté d’intégrer dans les programmes scolaires des cours de « mémoire démocratique » n’est pas anodin.
La forme de ce projet de loi semble bien montrer que c’est l’émotion qui guide les dirigeants espagnols, et qui devrait selon eux guider toute la société.
Un cours de « mémoire démocratique », c’est une manière de recouvrir de bons sentiments le récit national, mais ça ne constitue en aucun cas un travail historique, dont la rigueur scientifique est la condition sine qua non de la recherche de la Vérité, hors de toute considération morale.
Nathan Le Guay
Etudiant en histoire à l’Université Sorbonne Paris 4
Photo : Enrique Garcia Navarro/Shutterstock.com