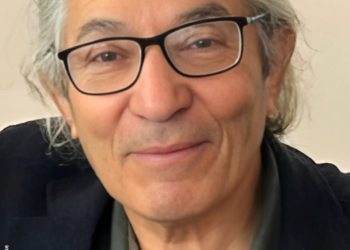Le 5 décembre 2013, disparaissait Nelson Mandela, une personnalité politique parmi les plus marquantes et les plus inspirantes également du XXè siècle. En cette journée commémorative, et dans un contexte international marqué par des crises politiques diverses dans différents pays, il n’est pas superfétatoire de rappeler la vision et l’action politiques de celui qui aura consacré 67 précieuses années de sa vie à la lutte pour la justice sociale, l’égalité, la réconciliation nationale, le respect de la diversité, la paix, etc.
Il est presque logorrhéique de dire que traiter de la vision et de l’action politiques d’une personnalité de la carrure de Nelson Mandela est un exercice extrêmement délicat à plus d’un titre. Cependant, de l’immense œuvre politique de Nelson Mandela en plus de 67 années d’engagement, il est possible d’en retenir certaines actions parmi les plus marquantes qui resteront à jamais gravées dans la mémoire du peuple sud-africain et dans celle, plus collective, de l’humanité.
Un sens élevé de l’engagement politique et du service de la nation
Bien évidemment, l’histoire retient fondamentalement et primordialement de Nelson Mandela le sens élevé de l’engagement politique et du service de la nation. Sa fameuse déclaration lors du procès historique de Rivonia de 1963 en est la parfaite illustration : « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J’ai combattu contre la domination blanche et j’ai combattu contre la domination noire. J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C’est un idéal pour lequel j’espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »
C’est cet idéal, marqué pour ainsi dire du sceau de l’inaliénabilité, qui caractérise toute la vison politique de Nelson Mandela et aura irrigué l’ensemble de ses actions au service de son pays.
Homme politique mondialement respecté, Nelson Mandela s’était toujours efforcé d’agir en homme d’État et, à ce titre, l’un de ses hauts faits était sans doute d’avoir réussi à éviter à l’Afrique du Sud une guerre civile dont toutes les conditions étaient pourtant réunies et qui allait plonger ce pays d’Afrique australe dans un drame sans précédent. C’était dans un contexte de fin du système d’apartheid et, pour réussir une telle prouesse politique, Nelson Mandela usera inlassablement de l’arme du dialogue en acceptant des compromis qui étaient indubitablement des plus douloureux, pour lui-même, pour son camp politique et surtout pour l’immense majorité du peuple sud-africain qui avait tant souffert de ce système ségrégationniste.
Aussi, ne faisait-il aucun doute que lorsque les dirigeants du monde entier étaient venus assister à la cérémonie d’investiture de Nelson Mandela en tant que premier président démocratiquement élu de la Nouvelle Afrique du Sud, le 10 mai 1994, c’était également pour rendre un hommage mérité à une personnalité politique exceptionnelle qui venait de conduire avec succès son peuple à la destination démocratique que personne ne pouvait imaginer.
Le dialogue et l’inclusivité comme mode de gouvernement
Devenu le président de la Nouvelle Afrique de Sud à l’issue des premières élections multiraciales de toute l’histoire mouvementée de ce pays, après 27 années de détention comme prisonnier politique et également 48 ans de système de ségrégation raciale, Nelson Mandela érigera le dialogue et l’inclusivité en mode de gouvernement dans la noble perspective de préserver l’intérêt supérieur de la nation sud-africaine.
En effet, alors même que l’African National Congress (Anc) dont il était le leader avait obtenu sans encombre la majorité absolue pour gouverner seul le pays, Nelson Mandela a eu la grande intelligence situationnelle et la sagesse politique de former un gouvernement d’unité nationale en y associant ses principaux adversaires politiques dont Frederik W. de Klerk, le dernier président du système d’apartheid, ou encore Mangosuthu Gatsha Buthelezi, le redoutable et controversé leader du parti ethno-nationaliste Inkata Freedom Party, etc.
En réalité, au-delà des actions politiques précises, il sied de mentionner au même titre le leadership éclairé et la méthode Nelson Mandela que l’on peut traduire notamment par le respect inconditionnel de l’adversaire en dépit des divergences idéologiques, la gestion concertée de la chose publique ainsi que le principe du leading from behind, etc.
Préserver définitivement l’Afrique du Sud et les générations futures du fléau de l’apartheid
Nelson Mandela savait mieux que quiconque que l’un des plus grands chantiers de l’Afrique du Sud post-apartheid, sans doute l’un des plus délicats également, était la réconciliation nationale. Or, une telle démarche n’était pas envisageable sans un travail de relecture objective du passé douloureux de ce pays. C’était précisément le sens du mandat dévolu à la Commission Vérité et Réconciliation que le leader charismatique de l’Anc décida avec raison de confier à une autre figure emblématique de la lutte contre l’apartheid, à savoir le Prix de la Paix 1984 Desmond Tutu (auteur, entre autres d’un célèbre ouvrage sur ce sujet : Il n’y a pas d’avenir sans pardon, Paris, Albin Michel, 2000). En effet, Nelson Mandela savait que toute paix demeure fragile si elle n’est pas fondée sur la vérité et la justice, qui sont parmi les conditions sine qua non pour une réconciliation véritable.
Assurément, pour préserver définitivement l’Afrique du Sud (la « Nation arc-en-ciel » dont la devise est pertinemment : « L’unité dans la diversité » !) et les générations futures du fléau de l’apartheid ou de tout système totalitaire, il fallait nécessairement doter ce pays d’institutions démocratiques justes, solides et suffisamment inclusives. Comme le dira d’ailleurs Desmond Tutu dans son ouvrage précité, c’était sans doute le moyen le plus sûr de donner la garantie à tous les citoyens sud-africains et à toutes les communautés nationales que plus personne ne serait persécuté, à l’avenir, sur cette terre d’Afrique du Sud pour des raisons quelconques qui seraient liées à son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou autres.
En dépit de toutes ces garanties, gravées dans le marbre de la Constitution du pays, les Sud-Africains savent mieux que quiconque qu’aucune société n’est totalement à l’abri de la régression et que le combat pour la liberté, la justice et la démocratie est en réalité une sorte de révolution permanente.
C’est encore Nelson Mandela lui-même qui le rappelle métaphoriquement à ses compatriotes et sans doute au monde entier : « Après avoir gravi une haute colline, on se rend seulement compte qu’il y a encore beaucoup de collines à gravir. »
Un héritage politique vivant et inspirant
Indéniablement, c’est toute cette vision de Nelson Mandela qui a permis à l’Afrique du Sud de préserver la paix, l’unité nationale, la stabilité et l’intégrité territoriale alors même que toutes les conditions étaient réunies pour provoquer un drame national à l’instar de ce qui s’était produit, durant la même période d’ailleurs, en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou encore au Libéria, etc.
C’est également tout cet héritage politique et cette vision drapeautique de l’homme d’État qu’était Nelson Mandela, qui a toujours su mettre l’intérêt général au-dessus de toute autre considération partisane, qui a permis à ce pays fragile d’échapper si heureusement à tant de crises politiques qui auraient pu le plonger dans l’instabilité ou encore dans un désordre généralisé aux conséquences difficiles à imaginer.
Le dernier exemple en date vient de la capacité de la classe politique sud-africaine à surmonter en un temps record les querelles de clocher et à s’accorder sur l’essentiel, en formant un gouvernement d’unité nationale rendu incontournable par les élections générales du 29 mai dernier où aucune formation politique n’a réussi à obtenir la majorité requise pour gouverner seule ce pays aux réalités complexes.
Ce sursaut patriotique, qui a animé la classe politique sud-africaine et qui a permis de surmonter rapidement les divergences que l’on disait pourtant irréconciliables, n’est pas le fruit du hasard. En toute logique, cela découle d’une tradition politique instituée dès la fin officielle de l’apartheid en 1994 par un homme d’Etat et un homme de vision, Nelson Mandela, qui a fait du service de la nation et de l’intérêt général un véritable sacerdoce.
Pour la promotion d’une culture de paix inspirée de la philosophie politique et de l’œuvre Nelson Mandela
C’est justement pour valoriser la contribution de Nelson Mandela à la promotion d’une culture de paix que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) a instauré, depuis le 10 novembre 2009, une journée spéciale célébrée le 18 juillet de chaque année en hommage à cette personnalité politique parmi les plus marquantes et les plus inspirantes du XXè siècle. Effectivement, l’Unesco invite par ce biais chacun à être un acteur de la transformation de nos sociétés respectives et à œuvrer pour un monde qui soit meilleur que celui d’aujourd’hui.
D’ailleurs, Nelson Mandela lui-même en a constamment donné l’exemple en rappelant que pour changer le monde, aucune compétence ne doit être négligée : « Chacun de nous en tant que citoyen a un rôle à jouer pour créer un meilleur monde. », disait-il.
À juste titre…
Roger Koudé
Professeur de Droit international à l’Institut des droit de l’homme de Lyon (Idhl) et Titulaire de la Chaire Unesco « Mémoire, Cultures et Interculturalité » à l’Université Catholique de Lyon. Son dernier ouvrage, intitulé La justice pénale internationale : Un instrument idoine pour raisonner la raison d’Etat ?, est publié aux Éditions L’Harmattan (Paris, 2023) et préfacé par Fatou Bensouda (Procureure générale de la Cour pénale internationale, 2012-2021).
Source : Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com