Environnement, beaucoup de lois mais un maigre bilan
Les lois se succèdent depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, mais le bilan du président de la République reste maigre...
La situation des partis politiques en France est paradoxale. D’un côté, ils constituent une des institutions les plus discréditées en France. Dans les enquêtes d’opinion, 85 % des citoyens ne leur font pas confiance. Leur utilité est mise en cause. Ils sont associés aux pires maux de la démocratie, à la « vieille politique » et à ce titre, voués aux gémonies.
Le terme même de « militants » apparaît disqualifié ou « ringardisé » (Jean-Luc Mélenchon qui prend ses distances avec l’imaginaire partisan, après l’avoir célébré, lui préfère désormais explicitement celui d’ « insoumis »). Les partis sont considérés comme des machines de pouvoir, qui reproduisent des logiques d’appareil et sont repliés sur leurs jeux et enjeux propres, très éloignés des préoccupations des citoyens profanes. Cette clôture des partis est considérée par la science politique comme une des manifestations les plus éclatantes de l’autonomisation du champ politique et de sa professionnalisation, au cœur de la crise du politique.
Cette défiance n’est pas nouvelle. Une culture anti-partisane a toujours existé en France mais elle apparaît plus vivace que jamais, d’autant que les soutiens des partis dans la société se sont largement désagrégés. Les partis eux-mêmes se sont transformés. Ils apparaissent comme évidés de leurs fonctions traditionnelles. Leur ancrage social et leur capacité à porter des intérêts sociaux et des revendications collectives se sont érodés.
Les bases militantes n’ont jamais été aussi faibles numériquement et aussi peu représentatives socialement. Les partis n’apparaissent plus comme porteurs d’identités idéologiques, d’alternatives politiques réelles, de visions du monde propres.
Les différences politiques qu’ils cultivent apparaissent artificielles. Ils ne structurent plus le débat public qui s’est déplacé vers les arènes médiatiques, les cercles d’expertise, les institutions publiques ou les réseaux sociaux sur Internet. Ils n’exercent même plus pleinement leur fonction de sélection du personnel politique et des candidats. Au niveau national, les primaires les ont dépossédés de cette prérogative et au niveau local, les notables (poids des sortants, logique de cooptation) s’imposent aux partis qui peinent à les encadrer et à les discipliner. Les nouvelles expérimentations citoyennes se construisent contre les partis et valorisent des formes d’horizontalité participative contre la verticalité des appareils partisans au risque de ne pas parvenir à inscrire durablement leur action. Le devenir éphémère du mouvement Nuits debout qui s’est construit notamment contre la confiscation de la parole par les partis est ici emblématique. De nouveaux partis émergent (Nouvelle donne, Nous citoyens…), à gauche comme à droite, valorisant de nouvelles méthodes plus participatives et rejetant les phénomènes de leadership classique, mais ils peinent à s’institutionnaliser ou à conserver leur fonctionnement démocratique initial (Fretel, 2015)1.
 D’un autre côté, les partis apparaissent toujours centraux dans la vie politique qui est, plus que jamais, une affaire de partis. Max Weber l’écrivait à la fin du XIXe siècle : les partis sont les enfants du suffrage universel. Ils concourent à l’expression du suffrage, lit-on dans la Constitution de 1958, la première à les avoir consacrés. Ce rôle n’est pas remis en cause. Les partis sont encastrés dans la démocratie représentative : ils sont les structures collectives qui organisent le cœur de la démocratie, qui restent les élections même si l’aspiration à une démocratie participative entre les scrutins se fait jour. Certes l’identification partisane a reculé (moins d’un Français sur trois se dit proche d’un parti et encore moins vote pour lui régulièrement2) mais le jeu électoral reste dominé par les partis. Les partis sont toujours des marques et des labels sur le marché électoral qui identifient les candidats et servent de point de référence aux électeurs (le passage de l’UMP à LR en 2014 traduit une volonté de recréditer la « franchise » partisane de ce point de vue). Au niveau local ou au niveau national, il est difficile de solliciter les électeurs sans s’appuyer sur une structure partisane. Les ressources partisanes restent essentielles dans la compétition électorale (de ce point de vue le devenir d’un Emmanuel Macron sera à suivre attentivement : peut-il construire une candidature présidentielle sans réelle organisation autre qu’un réseau lâche de soutiens comme son mouvement En Marche ?). Les lois de financement des partis politiques ont consacré les partis et les ont institutionnalisés. Elles ont sécurisé leur fonctionnement interne mais aussi accru leur distance à la société. Les théories du parti cartel (Aucante, Dezé, 2008) mettent l’accent sur le processus d’étatisation des partis politiques qui tirent de plus en plus leurs ressources financières de l’État (ce qui ne les incite pas à faire adhérer) et s’appuient sur les ressources institutionnelles que confère l’exercice du pouvoir. Le parti lorsqu’il accède au pouvoir tend à se dissoudre dans les institutions dont il assure le gouvernement. Les partis dominants, devenus des machines professionnalisées qui exercent alternativement les affaires, se structurent de plus en plus par rapport au pouvoir et aux élections (le paradoxe étant qu’ils sont au pouvoir de moins en moins longtemps, l’alternance s’étant banalisée). Le vieux syndrome du parti godillot s’est sans doute accentué comme on l’a vu avec l’UMP ou le PS lors des deux derniers mandats présidentiels. Le parti est aux abonnés absents quand ses cadres accèdent aux responsabilités. Les arènes partisanes au PS ont été largement désinvesties ou démonétisées depuis 2012 : les deux derniers congrès du PS de Toulouse ou Poitiers ont été des théâtres d’ombre, les instances internes sont délaissées, le parti n’organise même plus d’université d’été en 2016 ; faute de régulation partisane, les « frondeurs » ont déplacé leur contestation du parti vers l’enceinte parlementaire… Le parti est néanmoins réinvesti quand il entre dans l’opposition mais il est en quelque sorte débordé par le processus des primaires qui est désormais la règle au PS et chez LR. Les partis dominants tendent à verrouiller le jeu autour d’eux et cherchent à tirer le meilleur parti de la rente de position dominante dont ils jouissent et que conteste le FN (d’où le refus d’instiller ne serait-ce qu’une dose de proportionnelle ou les règles plus strictes récemment décidées en matière de parrainage pour l’élection présidentielle ou d’équité dans la médiatisation de la campagne). D’un certain point de vue, les primaires renforcent les deux partis dominants (le PS et LR), face au FN, puisque leurs enjeux est bien de trancher la question du monopole par un candidat de la revendication légitime du label partisan et d’accéder au second tour de l’élection présidentielle en forçant l’union (Lefebvre, Treille, 2016). Ce sont bien les partis qui définissent les règles du jeu des primaires, les filtres qui conditionnent les candidatures, le calendrier, le nombre de bureaux de vote3… Enfin, face à ces partis dominants, la stratégie de Marine Le Pen est bien assise sur une entreprise partisane en voie de consolidation. On le voit avec la volonté de construire une base militante et des réseaux locaux d’élus : il s’agit bien de faire parti.
D’un autre côté, les partis apparaissent toujours centraux dans la vie politique qui est, plus que jamais, une affaire de partis. Max Weber l’écrivait à la fin du XIXe siècle : les partis sont les enfants du suffrage universel. Ils concourent à l’expression du suffrage, lit-on dans la Constitution de 1958, la première à les avoir consacrés. Ce rôle n’est pas remis en cause. Les partis sont encastrés dans la démocratie représentative : ils sont les structures collectives qui organisent le cœur de la démocratie, qui restent les élections même si l’aspiration à une démocratie participative entre les scrutins se fait jour. Certes l’identification partisane a reculé (moins d’un Français sur trois se dit proche d’un parti et encore moins vote pour lui régulièrement2) mais le jeu électoral reste dominé par les partis. Les partis sont toujours des marques et des labels sur le marché électoral qui identifient les candidats et servent de point de référence aux électeurs (le passage de l’UMP à LR en 2014 traduit une volonté de recréditer la « franchise » partisane de ce point de vue). Au niveau local ou au niveau national, il est difficile de solliciter les électeurs sans s’appuyer sur une structure partisane. Les ressources partisanes restent essentielles dans la compétition électorale (de ce point de vue le devenir d’un Emmanuel Macron sera à suivre attentivement : peut-il construire une candidature présidentielle sans réelle organisation autre qu’un réseau lâche de soutiens comme son mouvement En Marche ?). Les lois de financement des partis politiques ont consacré les partis et les ont institutionnalisés. Elles ont sécurisé leur fonctionnement interne mais aussi accru leur distance à la société. Les théories du parti cartel (Aucante, Dezé, 2008) mettent l’accent sur le processus d’étatisation des partis politiques qui tirent de plus en plus leurs ressources financières de l’État (ce qui ne les incite pas à faire adhérer) et s’appuient sur les ressources institutionnelles que confère l’exercice du pouvoir. Le parti lorsqu’il accède au pouvoir tend à se dissoudre dans les institutions dont il assure le gouvernement. Les partis dominants, devenus des machines professionnalisées qui exercent alternativement les affaires, se structurent de plus en plus par rapport au pouvoir et aux élections (le paradoxe étant qu’ils sont au pouvoir de moins en moins longtemps, l’alternance s’étant banalisée). Le vieux syndrome du parti godillot s’est sans doute accentué comme on l’a vu avec l’UMP ou le PS lors des deux derniers mandats présidentiels. Le parti est aux abonnés absents quand ses cadres accèdent aux responsabilités. Les arènes partisanes au PS ont été largement désinvesties ou démonétisées depuis 2012 : les deux derniers congrès du PS de Toulouse ou Poitiers ont été des théâtres d’ombre, les instances internes sont délaissées, le parti n’organise même plus d’université d’été en 2016 ; faute de régulation partisane, les « frondeurs » ont déplacé leur contestation du parti vers l’enceinte parlementaire… Le parti est néanmoins réinvesti quand il entre dans l’opposition mais il est en quelque sorte débordé par le processus des primaires qui est désormais la règle au PS et chez LR. Les partis dominants tendent à verrouiller le jeu autour d’eux et cherchent à tirer le meilleur parti de la rente de position dominante dont ils jouissent et que conteste le FN (d’où le refus d’instiller ne serait-ce qu’une dose de proportionnelle ou les règles plus strictes récemment décidées en matière de parrainage pour l’élection présidentielle ou d’équité dans la médiatisation de la campagne). D’un certain point de vue, les primaires renforcent les deux partis dominants (le PS et LR), face au FN, puisque leurs enjeux est bien de trancher la question du monopole par un candidat de la revendication légitime du label partisan et d’accéder au second tour de l’élection présidentielle en forçant l’union (Lefebvre, Treille, 2016). Ce sont bien les partis qui définissent les règles du jeu des primaires, les filtres qui conditionnent les candidatures, le calendrier, le nombre de bureaux de vote3… Enfin, face à ces partis dominants, la stratégie de Marine Le Pen est bien assise sur une entreprise partisane en voie de consolidation. On le voit avec la volonté de construire une base militante et des réseaux locaux d’élus : il s’agit bien de faire parti.
Les partis sont donc à la fois décriés et incontournables, centraux et frappés d’illégitimité, anémiés et asséchés intellectuellement mais incrustés dans le jeu politique et électoral.
Ce paradoxe apparent est une aporie centrale de ce qu’il est convenu d’appeler « crise de la représentation » et un aspect central du blocage et verrouillage du jeu démocratique. Les réformateurs, adeptes de la « politique autrement », cherchent à faire l’économie de partis qui apparaissent pourtant inévitables dans le jeu politique tel qu’il est défini (Ethuin, Lefebvre, 2015). On reviendra ici sur quelques aspects de la transformation ou « crise » des partis avant d’aborder les primaires qui cherchent à dépasser les limites actuelles des partis au risque de nouveaux effets pervers.
Un déficit d’ancrage social
L’assise sociale des partis s’est incontestablement érodée. Leur « périmètre d’action » s’est rétréci (Offerlé, 2002). Leur capacité à mobiliser des segments de la société s’affaiblit et l’activisme militant s’est dévalué. Les partis n’existent que parce qu’ils prennent appui et entretiennent des oppositions sociales et par-delà mobilisent des groupes sociaux plus ou moins spécifiques, à travers leur base militante notamment. Ils portent des intérêts sociaux qu’ils contribuent à traduire, à défendre et à structurer même si les contraintes du jeu électoral les incitent à s’adresser à un large public. Par milieu partisan, Frédéric Sawicki entend « l’ensemble des individus et des groupes – ainsi que les réseaux qui les lient – dont les activités contribuent, sans que cet objectif soit nécessairement visé, à faire exister un parti donné » (Sawicki, 1997). Force est de constater néanmoins que les milieux partisans qui fondent l’assise sociale des partis se sont fortement affaiblis. Les partis ne vivent certes pas en apesanteur sociale. Ils sont encastrés dans des territoires marqués par de fortes spécificités. Ils maintiennent des relations privilégiées avec certains groupes sociaux et font l’objet d’investissements socialement situés. Le PS recrute ses militants plutôt dans la fonction publique (près de 60 %) quand 62 % des adhérents UMP appartiennent au secteur privé4. Les militants centristes restent proches de la nébuleuse catholique (Fretel, 2004). Mais leur ancrage dans la société s’est affaibli pour des raisons qui tiennent à la fois à l’évolution de la société et aux transformations endogènes des partis. Les clivages traditionnels (de classes sociales notamment) ont perdu de leur force dans la société. Les partis politiques ont contribué eux-mêmes à ce phénomène, notamment à gauche, en déconflictualisant leur discours. Les formations partisanes ont en quelque sorte perdu leur fonction « expressive » en raison de leur faible réceptivité sociale. Ils semblent défendre avant tout les intérêts de ce qui reste de leurs membres, à savoir des professionnels de la politique et des aspirants à l’élection.
La « fonction » d’intégration sociale et d’encadrement des catégories populaires dévolue aux partis de gauche apparaît largement en crise (le déclin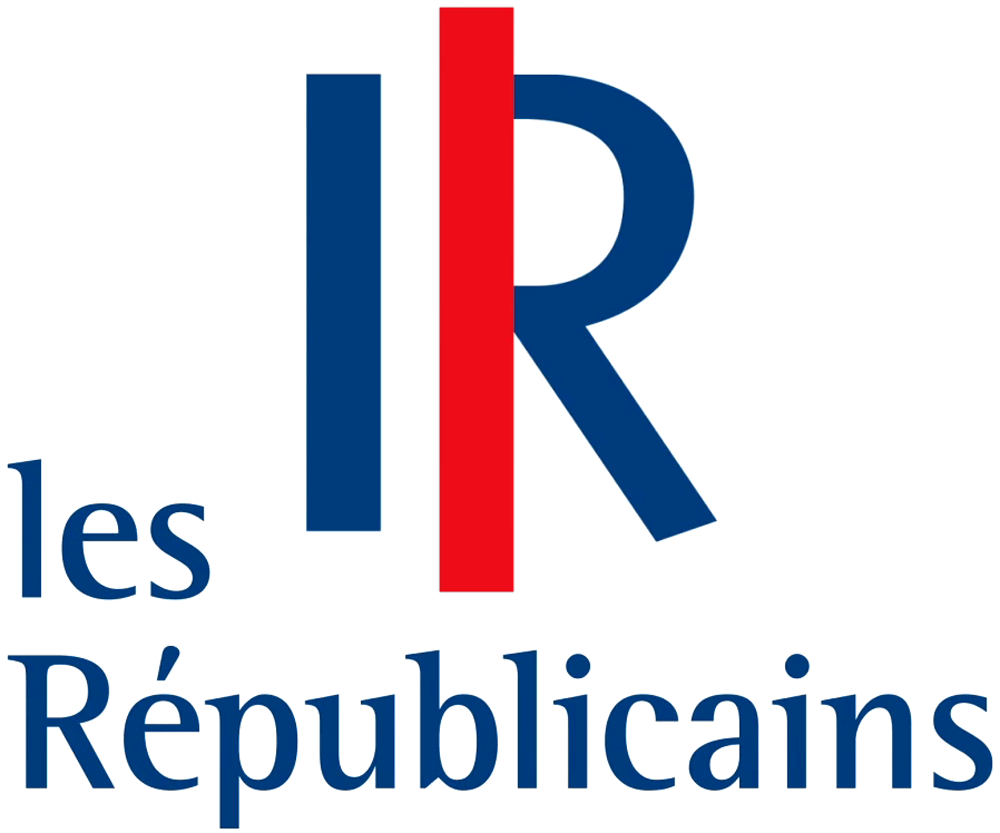 du PCF a accentué ce phénomène). La formation de l’opinion politique des milieux populaires doit sans doute moins que dans les années 1960 ou 1970 au travail de politisation des organisations de gauche. Les liens développés avec les syndicats et la « société civile » se sont relâchés. Les associations qui fonctionnent souvent comme des structures professionnalisées adoptent une rhétorique d’indépendance de plus en plus marquée à l’égard du pouvoir politique. Les réseaux du parti socialiste dans le monde enseignant, ouvrier, syndical, associatif… se sont ainsi largement décomposés (Lefebvre, Sawicki, 2006). Le PS n’est pas parvenu à s’implanter dans les populations d’origine immigrée (issu du Maghreb notamment) qui lui sont pourtant plutôt favorables électoralement (jusqu’en 2012…). Le recrutement militant apparaît au PS de plus en plus endogène, familial et local. Près de 40 % des encartés socialistes ont en 2011 (dernière enquête disponible) 60 ans ou plus. On observe un déclin du polyengagement qui contribue à l’affaiblissement de l’ancrage social du parti. Être adhérent socialiste implique moins que par le passé d’être syndiqué (les statuts l’exigent pourtant toujours), membre d’une association de parents d’élèves, de militer dans l’éducation populaire. 38 % des adhérents sont syndiqués en 2011 (avec une nette préférence pour la CFDT) contre 64 % en 1998 et 71 % en 1985 (Dargent, Rey, 2011).
du PCF a accentué ce phénomène). La formation de l’opinion politique des milieux populaires doit sans doute moins que dans les années 1960 ou 1970 au travail de politisation des organisations de gauche. Les liens développés avec les syndicats et la « société civile » se sont relâchés. Les associations qui fonctionnent souvent comme des structures professionnalisées adoptent une rhétorique d’indépendance de plus en plus marquée à l’égard du pouvoir politique. Les réseaux du parti socialiste dans le monde enseignant, ouvrier, syndical, associatif… se sont ainsi largement décomposés (Lefebvre, Sawicki, 2006). Le PS n’est pas parvenu à s’implanter dans les populations d’origine immigrée (issu du Maghreb notamment) qui lui sont pourtant plutôt favorables électoralement (jusqu’en 2012…). Le recrutement militant apparaît au PS de plus en plus endogène, familial et local. Près de 40 % des encartés socialistes ont en 2011 (dernière enquête disponible) 60 ans ou plus. On observe un déclin du polyengagement qui contribue à l’affaiblissement de l’ancrage social du parti. Être adhérent socialiste implique moins que par le passé d’être syndiqué (les statuts l’exigent pourtant toujours), membre d’une association de parents d’élèves, de militer dans l’éducation populaire. 38 % des adhérents sont syndiqués en 2011 (avec une nette préférence pour la CFDT) contre 64 % en 1998 et 71 % en 1985 (Dargent, Rey, 2011).
Le déclin du militantisme est le « symptôme » le plus communément avancé pour établir l’affaiblissement des partis.
Les effectifs militants ont fortement baissé ces dernières années au-delà des mouvements conjoncturels liés à l’exercice du pouvoir. Le Parti a perdu plus de la moitié de ses adhérents depuis 2012 et a atteint un niveau historiquement faible (autour de 80 000 adhérents). Les Républicains revendiquent 250 000 membres mais il s’agit plus d’adhérents que de militants. Les Verts n’en comptent que quelques milliers. Le NPA et le Parti de gauche ont perdu beaucoup de leurs militants ces dernières années… Les partis politiques sont de moins en moins attractifs. L’image sociale dominante du militantisme partisan reste celui de l’embrigadement. Les nouvelles formes d’engagement ne se développent pas en leur sein mais dans le monde associatif, l’humanitaire, le caritatif, l’altermondialisme…
On assiste autant à un déclin du militantisme qu’à une dévaluation de leur activisme. Se développe la croyance chez les élites partisanes que les médias font l’élection plus que la mobilisation militante. Les dirigeants ont intériorisé l’idée que les médias se sont substitués aux partis dans le rôle de médiation entre l’opinion, le public et les gouvernants. La communication se substitue à la médiation partisane. Aussi les partis pratiquent une forme d’« autorestriction des répertoires d’action » qu’ils mobilisent (Offerlé, 2002). La revalorisation ponctuelle du porte à porte au PS lors des élections présidentielles de 2012 (Lefebvre, 2016) ne saurait occulter une dévaluation plus générale des ressources militantes. Les partis politiques tolèrent voire encouragent un militantisme de faible intensité, entérinant leur faible attractivité. Le modèle de « l’engagement distancié » (Ion, 1997) a été intégré comme l’horizon indépassable du militantisme (Lefebvre, 2013). Il conditionne fortement l’offre d’engagement. Les partis encouragent un engagement intermittent, par internet (Greffet, 2011), valorisant fortement le débat et la prise de parole (Lefebvre, Roger, 2009). Même si la définition de l’adhérent (droit et devoirs) demeure variable selon les partis, on observe une tendance générale à l’assouplissement de l’engagement partisan (moins onéreux et contraignant) qui rend plus poreuse les frontières entre militants et sympathisants. La capacité de mobilisation des partis ne leur permet plus d’entretenir la loyauté de leurs groupes sociaux de référence et explique, parmi d’autres facteurs, la progression de la volatilité.
 Une part considérable des adhérents des partis sont aujourd’hui des élus locaux, des collaborateurs d’élus et des auxiliaires politiques, ce qui nuit là encore à leur représentativité (le phénomène est très marqué chez les écologistes qui se sont largement professionnalisés politiquement même s’ils ont perdu une bonne partie de leurs mandats depuis 2012). Les partis réunissent désormais surtout des agents directement « intéressés » à l’obtention de profits électoraux ou professionnels, surtout au niveau local. La décentralisation a démultiplié les opportunités pour faire carrière. « En se conjuguant aux effets de la présidentialisation, le fort localisme des partis politiques affaiblit leurs capacités à élaborer des programmes d’action, à être des lieux de réflexion doctrinale et d’éducation populaire et à infléchir leur composition sociale » (Sawicki, 2013, page 48). La place numérique et stratégique occupée par les professionnels de la politique dans le PS, croissante depuis une vingtaine d’années, en a ainsi bouleversé progressivement l’économie interne et l’économie morale. Le PS est devenu une « société d’élus », locaux principalement entre 2002 et 2012. Pendant cette période, les élections intermédiaires ont été favorables au PS qui a accru considérablement son implantation locale (il capitalise avec la conquête du Sénat en 2011 dix ans de victoires locales). Arrivé au pouvoir, le PS a perdu une partie importante de ses positions locales. La droite a connu le phénomène inverse. Depuis 2012, et surtout la victoire historique des élections municipales de 2014, LR s’est reconstitué comme parti d’élus locaux. Ce mouvement pendulaire de la vie politique française structure désormais les stratégies des acteurs partisans. Les cadres socialistes attendent impatiemment pour beaucoup d’entre eux le retour dans l’opposition pour retrouver un contexte électoral localement plus favorable. Pour l’élu local socialiste, l’exercice du pouvoir (national) est une mauvaise période à passer. Les intérêts électoraux sont ainsi devenus prépondérants à tous les niveaux du parti, ce qui cantonne les tâches d’élaboration programmatique et le travail militant le plus quotidien (en dehors des phases de mobilisation électorale) au plus bas de l’échelle des pratiques.
Une part considérable des adhérents des partis sont aujourd’hui des élus locaux, des collaborateurs d’élus et des auxiliaires politiques, ce qui nuit là encore à leur représentativité (le phénomène est très marqué chez les écologistes qui se sont largement professionnalisés politiquement même s’ils ont perdu une bonne partie de leurs mandats depuis 2012). Les partis réunissent désormais surtout des agents directement « intéressés » à l’obtention de profits électoraux ou professionnels, surtout au niveau local. La décentralisation a démultiplié les opportunités pour faire carrière. « En se conjuguant aux effets de la présidentialisation, le fort localisme des partis politiques affaiblit leurs capacités à élaborer des programmes d’action, à être des lieux de réflexion doctrinale et d’éducation populaire et à infléchir leur composition sociale » (Sawicki, 2013, page 48). La place numérique et stratégique occupée par les professionnels de la politique dans le PS, croissante depuis une vingtaine d’années, en a ainsi bouleversé progressivement l’économie interne et l’économie morale. Le PS est devenu une « société d’élus », locaux principalement entre 2002 et 2012. Pendant cette période, les élections intermédiaires ont été favorables au PS qui a accru considérablement son implantation locale (il capitalise avec la conquête du Sénat en 2011 dix ans de victoires locales). Arrivé au pouvoir, le PS a perdu une partie importante de ses positions locales. La droite a connu le phénomène inverse. Depuis 2012, et surtout la victoire historique des élections municipales de 2014, LR s’est reconstitué comme parti d’élus locaux. Ce mouvement pendulaire de la vie politique française structure désormais les stratégies des acteurs partisans. Les cadres socialistes attendent impatiemment pour beaucoup d’entre eux le retour dans l’opposition pour retrouver un contexte électoral localement plus favorable. Pour l’élu local socialiste, l’exercice du pouvoir (national) est une mauvaise période à passer. Les intérêts électoraux sont ainsi devenus prépondérants à tous les niveaux du parti, ce qui cantonne les tâches d’élaboration programmatique et le travail militant le plus quotidien (en dehors des phases de mobilisation électorale) au plus bas de l’échelle des pratiques.
Les partis sont censés être des « intellectuels collectifs » qui portent une vision du monde, une « idéologie », administre un sens politique et politise la société. Ils doivent être appréhendés en cela comme des « entreprises culturelles » pour reprendre l’expression de Frédéric Sawicki. Ces dimensions de l’activité partisane et du travail militant se sont aussi largement affaiblies. Les différenciations idéologiques entre les partis dominantes se sont considérablement atténuées (ce qui ouvre au FN le statut de parti de « la seule alternative »). La droitisation tant sur le plan économique que sécuritaire du PS au pouvoir depuis 2012 a accentué ce brouillage.
Les partis politiques à vocation gouvernementale n’apparaissent plus porteurs de visions du monde clivantes et réellement discriminantes.
Le bagage idéologique de ces partis professionnalisés s’est considérablement réduit.
Le clivage gauche/droite garde certes une partie de sa pertinence. Les candidats des différentes familles politiques s’inscrivent dans des traditions politiques identifiantes, activent des symboles et des emblèmes partisans et mobilisent des mots marqueurs (assistanat, responsabilité, travail, mérite… pour LR, justice sociale, égalité, solidarité… pour le PS). Des options économiques divergentes, de plus en plus subtiles, distinguent toujours gauche et droite (notamment en matière fiscale). Mais les rhétoriques de campagne ne s’enchâssent plus dans de réelles constructions idéologiques. Le rapport aux intellectuels s’est relâché à gauche et les dirigeants lisent peu. À gauche, il existe des dissensions entre les divers partis de gauche, mais les différences idéologiques sont beaucoup moins marquées que dans les années 1970 ou 1980 (les « frondeurs » du PS, les écologistes ou les communistes partagent de nombreuses convergences tout en peinant à dépasser leurs frontières partisanes). Les logiques de reproduction d’appareil expliquent, bien plus que les différences idéologiques, la fragmentation du paysage partisan à gauche.
Les marqueurs partisans sont par ailleurs sans cesse transgressées et l’heure est à la « triangulation » (à gauche avec Manuel Valls ou Emmanuel Macron qui dénonce une « gauche statutaire et contestatrice »…). La prise de distance avec le patrimoine idéologique de son propre parti devient une posture banalisée et porteuse sur le plan médiatique. Les questions de doctrine ne sont plus objets de controverses internes au PS. Les partis cherchent désormais à toucher le plus grand public, ce qui les amène à mettre l’accent sur des enjeux consensuels.
Il s’agit d’ailleurs moins de produire des visions du monde que de construire des programmes d’action publique crédibles dont la dimension technique devient centrale (d’où l’externalisation de plus en plus courante de la fonction programmatique à des think tanks). Mais les partis ne sont-ils pas en train de faire le deuil de leur fonction programmatique ? Lors du conseil national de février 2016, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, annonce qu’il n’y aura pas de programme produit par le PS pour les prochaines élections présidentielles. Il déclare à la tribune : « Notre parti n’a aucun intérêt à rejouer la pièce des élections précédentes, où le temps passé à discuter et à se disputer pour élaborer un programme est inversement proportionnel au temps que le candidat passe à le lire et à le reproduire ». Plutôt qu’un programme, et pour ne pas donner l’impression de s’effacer totalement, le PS prévoit alors de produire « un champ d’idées et de débats » pour fixer « les enjeux de l’action future ». Pour cela, le texte adopté qui établit sa « feuille de route pour 2016 » prévoit la rédaction de sept « cahiers de la présidentielle » et la tenue de deux conventions nationales : « Pour l’emploi, pour l’avenir » (avril 2016), « République, notre bien commun » (janvier 2017).
technique devient centrale (d’où l’externalisation de plus en plus courante de la fonction programmatique à des think tanks). Mais les partis ne sont-ils pas en train de faire le deuil de leur fonction programmatique ? Lors du conseil national de février 2016, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, annonce qu’il n’y aura pas de programme produit par le PS pour les prochaines élections présidentielles. Il déclare à la tribune : « Notre parti n’a aucun intérêt à rejouer la pièce des élections précédentes, où le temps passé à discuter et à se disputer pour élaborer un programme est inversement proportionnel au temps que le candidat passe à le lire et à le reproduire ». Plutôt qu’un programme, et pour ne pas donner l’impression de s’effacer totalement, le PS prévoit alors de produire « un champ d’idées et de débats » pour fixer « les enjeux de l’action future ». Pour cela, le texte adopté qui établit sa « feuille de route pour 2016 » prévoit la rédaction de sept « cahiers de la présidentielle » et la tenue de deux conventions nationales : « Pour l’emploi, pour l’avenir » (avril 2016), « République, notre bien commun » (janvier 2017).
De fait le développement des primaires privatise la fonction programmatique désormais assurée par chaque candidat qui doit justifier sa candidature par une offre politique propre. Le principe de la primaire tend à la dévaluation du caractère contraignant du projet porté par le parti. Nicolas Sarkozy président d’LR n’est pas parvenu à imposer en 2015-2016 un socle programmatique commun à l’ensemble des candidats à la primaire. « Une formation politique sans projet collectif ne serait qu’une addition d’écuries présidentielles » soutient-il au Figaro, le 6 mai 2015. Il fixe la remise du projet au mois de juin 2016, soit cinq mois avant la primaire. Un débat s’engage à partir de 2015 sur le statut de ce document programmatique : « trame commune » qui sert de référentiel aux candidats, ensemble de réformes précises, revue d’objectifs à atteindre, socle commun, stock d’options… ? Le 7 mars, Nicolas Sarkozy annonce que les candidats à la primaire devront s’engager à appliquer en cas de victoire en 2017 un « socle de dix à quinze mesures très fortes » qui auront été ratifiées par les militants. Les proches d’Alain Juppé suggèrent quant à eux que le parti ne soit qu’un « laboratoire intellectuel » pour les primaires qui permette d’établir des diagnostics en auditionnant des spécialistes, de proposer différents scénarios et hypothèses, leur coût, leurs conséquences, et de dégager sur chaque thème une palette de solutions dans laquelle les candidats piocheraient leurs idées (entretien avec Benoist Apparu). Au final, le projet est voté en juin 2016 mais les challengers de Nicolas Sarkozy déclarent qu’ils ne sont pas engagés par son contenu.
Les partis conservent une certaine maîtrise sur une troisième fonction, celle de sélection des candidats même si, là encore, les logiques médiatiques et d’opinion tendent à mettre en cause leur monopole. L’investiture partisane est une dimension essentielle de la construction de la légitimité des candidats au niveau local comme au niveau national. Au niveau local, le PS est devenu essentiellement une machine à produire des investitures locales. Les labels partisans confèrent ressources identitaires, organisationnelles et financières aux candidats qui s’en réclament. Les partis contribuent très peu au renouvellement des élites politiques, consacrant le pouvoir des élus en place ou renforçant le cumul des mandats qui semble plus efficace électoralement. Le système des primaires ouvertes perturbent néanmoins la donne (au niveau national plus qu’au niveau local où le système des primaires reste marginal)5.
Les primaires constituent une des réponses aux transformations des partis politiques et à leur déficit de légitimité. Depuis les années 1990, on observe une « démocratisation » et une individualisation (multiplication des votes militants) des processus de désignation des candidats dans les partis politiques. Cette tendance participe du développement d’une culture plus participative dans la définition des choix collectifs, censée renforcer l’attractivité de l’adhésion militante en crise et correspondre à de nouvelles attentes démocratiques, celle d’un militant plus « distancié » et « critique » (Lefebvre, 2013). Le développement des primaires fermées conduit parfois à leur élargissement aux sympathisants et aux électeurs (le calcul peut être de contourner une base militante trop radicale avec parfois des résultats très contre-intuitifs6). Le préalable de la primaire ouverte c’est la primaire fermée (pour le PS comme pour l’UMP). Pourtant, le passage de l’une à l’autre n’a rien de naturel ni linéaire. La procédure « directe » de désignation du candidat par les militants leur confère un nouveau pouvoir et ouvre une rétribution symbolique de nature à redynamiser le militantisme et à le rendre plus attractif. La primaire ouverte conserve le caractère direct de la sélection mais conduit à un phénomène inverse : elle retire une prérogative au militant et tend à démonétiser son statut en égalisant les droits de l’adhérent et du sympathisant.
 Les primaires ouvertes constituent une réponse à l’affaiblissement des partis politiques dans un contexte de développement de la démocratie participative. Le rétrécissement de la base militante, le déclin de la représentativité et de l’ancrage social des partis conduisent alors à délégitimer les modes de sélection traditionnels. Les primaires apparaissent d’autant plus « démocratiques » que, dans un contexte de « crise » du militantisme, l’implantation des partis dans la société s’est fortement érodée. Comment la surface sociale des partis, de plus en plus étroite, pourrait-elle justifier que la production du candidat soit le seul fait de ses militants ? Les partis cherchent aussi à améliorer leur image à travers les primaires qui constituent une stratégie de rénovation de leur « façade » institutionnelle et de « monstration » de la modernité démocratique. À mesure que se fragilise l’identification partisane, que s’effritent les allégeances de classe sur lesquelles elle était indexée, les liens entre électeurs et partis s’affaiblissent d’autant plus que leurs périmètres d’action se rétrécissent. Dans ce contexte, les primaires constituent une manière de resserrer ces liens en intégrant les électeurs dans le choix. Le renforcement de la dimension électorale des partis, évolution centrale dans le modèle du parti-cartel, conduit de fait les partis politiques, selon une logique analytique proche, à externaliser la fonction de sélection de leurs candidats. Il s’agit dans cette perspective d’optimiser le choix du candidat, d’accroître la légitimité des partis et leur crédibilité dans l’opinion publique, d’enrichir le choix des électeurs jusque-là limité, de pré-mobiliser les électeurs ou renforcer le sentiment de participer à un projet politique commun.
Les primaires ouvertes constituent une réponse à l’affaiblissement des partis politiques dans un contexte de développement de la démocratie participative. Le rétrécissement de la base militante, le déclin de la représentativité et de l’ancrage social des partis conduisent alors à délégitimer les modes de sélection traditionnels. Les primaires apparaissent d’autant plus « démocratiques » que, dans un contexte de « crise » du militantisme, l’implantation des partis dans la société s’est fortement érodée. Comment la surface sociale des partis, de plus en plus étroite, pourrait-elle justifier que la production du candidat soit le seul fait de ses militants ? Les partis cherchent aussi à améliorer leur image à travers les primaires qui constituent une stratégie de rénovation de leur « façade » institutionnelle et de « monstration » de la modernité démocratique. À mesure que se fragilise l’identification partisane, que s’effritent les allégeances de classe sur lesquelles elle était indexée, les liens entre électeurs et partis s’affaiblissent d’autant plus que leurs périmètres d’action se rétrécissent. Dans ce contexte, les primaires constituent une manière de resserrer ces liens en intégrant les électeurs dans le choix. Le renforcement de la dimension électorale des partis, évolution centrale dans le modèle du parti-cartel, conduit de fait les partis politiques, selon une logique analytique proche, à externaliser la fonction de sélection de leurs candidats. Il s’agit dans cette perspective d’optimiser le choix du candidat, d’accroître la légitimité des partis et leur crédibilité dans l’opinion publique, d’enrichir le choix des électeurs jusque-là limité, de pré-mobiliser les électeurs ou renforcer le sentiment de participer à un projet politique commun.
La stratégie des primaires est néanmoins lourde d’effets pervers. Elles créent une atmosphère de campagne permanente, affaiblissent la capacité du parti à définir un cadre commun, exacerbent la personnalisation politique et les ambitions politiques même si elles peuvent encourager le renouvellement par la promotion d’outsiders, s’adressent plutôt à des électeurs politisés qui ne sont pas forcément représentatifs des électeurs dans leur ensemble… Le développement des primaires interroge aussi la nature et le statut même des militants dans les partis dans la mesure où elles les privent d’un droit et donc d’une rétribution symbolique essentielle (Lefebvre, 2011). Cette procédure renforce la dévaluation des ressources partisanes et affaiblit, on l’a vu, la fonction idéologique. Elles annoncent peut-être des « Parties without partisans » pour reprendre l’expression de R.J. Dalton (2000), centrés sur des logiques de communication et l’organisation de scrutins ouverts aux sympathisants.
Rémi Lefebvre
Professeur de science politique, université Lille 2
———-
Les lois se succèdent depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, mais le bilan du président de la République reste maigre...
C’est sans aucun doute la première manifestation politique de Bruno Retailleau comme président de parti. Elle a pris la forme...
Au moment de la relance d’un débat national initié par le Premier ministre François Bayrou sur « l’identité nationale »,...
Écrire une contribution sur Jacques Pilhan, ce communicant politique qui traversa la vie sociale et politique de 1981 à 1998,...

La Revue Politique et Parlementaire
10 rue du Colisée 75008 Paris
Email : contact@revuepolitique.fr
Téléphone : 01 76 47 09 30