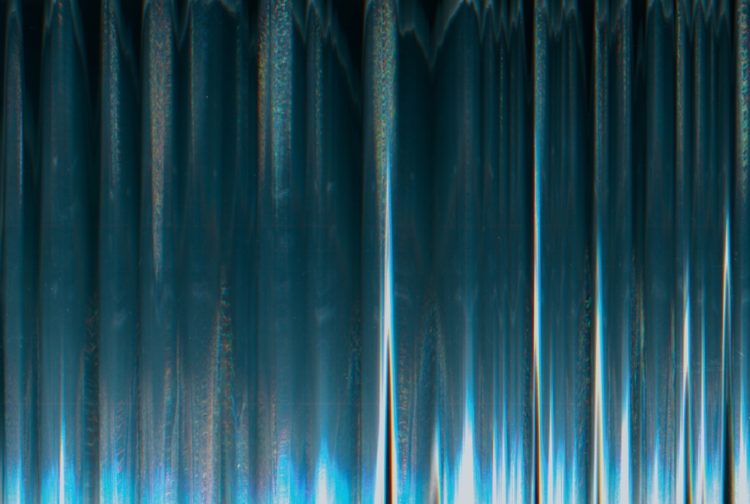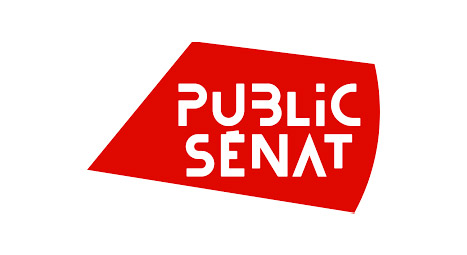Le 24 septembre 2024, le président Joe Biden prenait la parole, pour la quatrième et dernière fois, devant l’Assemblée générale des Nations unies . Il le faisait dans un contexte international pour le moins tourmenté, alors que les hostilités entre la Russie et l’Ukraine se poursuivaient, que l’Etat d’Israël lançait des frappes aériennes sur le Liban et que le Soudan continuait d’être déchiré par la guerre civile.
Les spectateurs et les acteurs du théâtre mondial pouvaient attendre du président Biden qu’il fît entendre une voix d’autorité pour assumer le rôle prêté aux États-Unis de garant de l’ordre international, ouvrir des perspectives intellectuelles et pragmatiques à la stabilisation des crises mondiales. Il n’en fut rien. La formule bien connue de La Fontaine s’appliquait parfaitement à l’événement : la montagne accoucha d’une souris.
Les journalistes directement confrontés aux crises en cours pouvaient s’interroger quant au sens de ce retrait relatif de la puissance américaine, telle Laure-Maïssa Farjallah dans L’Orient-Le Jour, le 25 septembre 2024. La question du degré d’engagement des États-Unis dans les affaires internationales est, en effet, centrale pour comprendre les évolutions qui affectent l’ordre mondial.
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer l’apparente réserve des plus hauts responsables américains. Celle-ci tient, pour une part, au contexte particulier de la campagne présidentielle, qui leur interdit de prendre des positions trop tranchées par crainte de réactions propres à faire basculer l’élection. Elle semble révéler également, et plus profondément, une évolution structurelle de la posture de l’Amérique vis-à-vis du monde, un positionnement durable de stricte rationalisation de ses engagements à l’étranger.
Selon cette hypothèse, il faudrait admettre que, par-delà l’opposition de leurs discours, Joseph Biden et Donald Trump suivraient peut-être des trajectoires structurellement comparables en matière de politique internationale. L’intérêt national s’imposerait ainsi, encore et toujours, comme un facteur bien plus déterminant que les options personnellement affichées pour conduire une politique étrangère.
Pour être plutôt convenu, le discours prononcé par Joe Biden devant l’Assemblée générale des Nations unies n’en pose pas moins la question centrale de notre temps, celle des conditions de pérennité de l’ordre mondial.
Le président Biden ne lui apporte, pour autant, aucune réponse concrète. Le discours composite qu’il prononce le laisse, avec la puissance américaine, au milieu du gué.
Ce retrait de la superpuissance américaine et ce refus d’envisager des solutions aux problèmes des nations sont de nature à permettre la prolifération d’affrontements endémiques aux marches des systèmes d’alliance principaux, à leurs points de contact, qui sont révélateurs de l’absence d’une légitimité unanimement reconnue dans un ordre mondial travaillé par des forces centrifuges.
Tout en semblant projeter sur un avenir bien incertain les invariants du rêve américain, le discours du président Biden devant l’Assemblée générale des Nations unies procédait, en fait, d’une figure imposée, dissimulant mal la réalité d’une rationalisation marquée et désormais structurelle de l’engagement des États-Unis dans le monde.
Un discours largement écrit au passé
Largement écrit au passé, il se présente surtout comme un bilan personnel de fin de parcours et presque, si l’on nous permet cette référence triviale, comme un discours de départ à la retraite. Selon le sens du spectacle mâtiné de pathos dont les Américains peuvent être coutumiers, ce discours se concevait avant tout comme le moment de Joseph Biden.
De fait, le président des Etats-Unis commence son discours en remontant à l’année 1972, lorsqu’il fut élu sénateur pour la première fois, puis il décrit, décennie par décennie, les grandes épreuves internationales auxquelles son pays a été confronté, les défis qu’il a surmontés tant bien que mal, la guerre froide certes, mais aussi la guerre du Kippour, la guerre du Vietnam, puis l’apartheid en Afrique du Sud, les guerres de Yougoslavie, enfin l’ère du terrorisme de masse hypermédiatisé.
Toutefois, après avoir procédé à ce retour en arrière, il évoque deux décisions qui semblent révéler sa vision du monde et son souhait de tempérer la propension américaine à l’extraversion : d’une part, il souligne l’importance qu’il y avait à réduire la présence des États-Unis en Irak sous la présidence de Barack Obama, d’autre part, il évoque la décision, qui fut, selon ses termes, juste, difficile et tragique, d’ordonner le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, sur laquelle s’est ouvert son mandat. Joe Biden assume ainsi la rationalisation et la réorientation imposées au dispositif d’engagement américain.
Il lie ces décisions, dont l’intérêt national est le dénominateur commun, à la volonté prioritaire de rebâtir le réseau d’alliances de son pays et cite le Quad, auquel ont part les puissances alliées des États-Unis bordant la zone Indo-Pacifique, le Japon, l’Australie et l’Inde. L’on comprend, à tel détour, que l’Europe n’est plus depuis longtemps une priorité pour Washington ; et l’on reconnaît là un effet du pivot que Barack Obama avait souhaité placer au cœur de sa stratégie, consistant à favoriser le basculement du dispositif d’engagement américain du continent européen vers la région Indo-Pacifique.
Le président Biden ne peut toutefois ignorer totalement les crises pendantes, mais il en parle rapidement et ne formule aucune proposition concrète.
Un discours convenu, étranger à toute ambition nouvelle
Joe Biden reconnaît les défis du moment, qui vont « de l’Ukraine à Gaza et au Soudan et bien au- delà « . Se référant au poète irlandais William Butler Yeats, qui, décrivant le monde en 1919, affirmait que, dans les désordres qui l’emportaient, « le centre ne pouvait tenir », Joseph Biden affirme, lui, en contrepoint, que, face aux défis de notre temps, « le centre a tenu bon « . Nul doute qu’il pense prioritairement à Washington, lorsqu’il parle métaphoriquement de « centre » et affirme qu’il a « tenu ». Ce faisant, il fait montre d’une autosatisfaction et d’un optimisme qui peuvent paraître paradoxaux.
Il reconnaît, toutefois, en des termes que n’eût pas renier Henry Kissinger dans World Order [5. Henry Kissinger, World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History , Penguin, 2015, 432 p.], que l’enjeu central de notre époque est celui de la stabilisation et de la pérennité de l’ordre mondial. Exprimant d’abord, non sans paradoxe, son opposition à un quelconque retrait des affaires du monde, Joseph Biden affirme clairement, se faisant aussi l’écho de la formule de Yeats :
« Notre mission, l’épreuve qui est la nôtre consiste à nous assurer que les forces qui nous tiennent ensemble sont plus fortes que celles qui nous éloignent les uns des autres, que les principes de partenariat que nous sommes venus ici soutenir chaque année peuvent résister aux défis, que le centre tient une fois encore . »
Après avoir posé ce problème, sur lequel tous ou presque s’accorderont, Joe Biden choisit de citer les cadres d’organisation qui, selon lui, peuvent structurer efficacement les relations internationales et garantir la cohésion de l’ordre mondial.
Sans originalité, ni créativité, le président des Etats-Unis se réfère aux principes de la Charte des Nations unies, qui excluent toute agression d’un Etat par un autre. Ces principes sont louables et forment le cœur de la concertation que permet l’ONU. Reconnaissons toutefois que ces principes, si généreux soient-ils, demeurent peu opérationnels sans l’appui que leur apportent les puissances.
Le président Biden s’attache ensuite à présenter l’OTAN presque comme une organisation complémentaire de l’ONU. Organisation conservatrice de l’ordre en vigueur, elle est censée, selon lui, contribuer activement à une plus grande sécurité internationale.
Bien plus novateur semble l’acquiescement du président Biden à la coopération bilatérale des États- Unis avec la Chine sur des dossiers concrets, comme la lutte contre le commerce illicite des drogues. Comme pour équilibrer cette affirmation, il s’empresse de rappeler que les États-Unis demeurent déterminés à faire échec à toute concurrence déloyale en matière commerciale mais aussi à toute tentative de force, en particulier en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan.
A l’égard de la crise qui prend une ampleur singulière au Proche-Orient, le président Biden se contente de dénoncer les violences, de mettre en garde contre une guerre à grande échelle, qui « n’est dans l’intérêt de personne », d’affirmer qu' »une solution diplomatique est toujours possible « . Il marque son soutien, en des termes plutôt conventionnels, à une solution à deux États.
L’évocation, sans plus de précision, ni d’engagement ferme de sa part, d’une réforme de l’ONU, à laquelle s’ajoute finalement l’expression de son attachement à la démocratie, complète ce panorama des lieux communs du discours diplomatique.
Ce que l’on comprend, en fait, en analysant ce discours, c’est que, du point de vue de ses auteurs, il n’est pas censé proposer de solutions : il procède bien plutôt de la figure imposée, d’un exercice quasi rituel visant à manifester un minimum d’égards pour l’Assemblée générale des Nations unies. Ce discours reflète surtout le choix délibéré de la puissance américaine de rationaliser ses interventions en les rapportant strictement à son intérêt national, l’ordre mondial dût-il perdre en cohésion.
Les conflits en cours, sur lesquels la parole du président américain ne semble plus exercer une quelconque influence modératrice, confirment le dérèglement d’un monde hors de ses gonds, en mal de légitimité.
Un retrait américain qui semble consommé
Le fait que le discours de Joe Biden soit dénué de toute portée opérationnelle tient certes au contexte dans lequel il s’insère, celui de la campagne présidentielle américaine. A supposer qu’il l’ait souhaité, le président démocrate ne pouvait prendre des positions trop affirmées au sujet des conflits en cours, en particulier à l’égard du Proche-Orient. Le brouillard de l’élection présidentielle explique l’éclipse de la puissance américaine et la réserve de ses dirigeants, mais n’en est pas une raison suffisante.
Les circonstances vont dans le sens d’une relativisation de la place des États-Unis, mais, au-delà, l’on est en droit de postuler que cette orientation est vraisemblablement délibérée. Les États-Unis seraient-ils sur le point de connaître un nouveau moment isolationniste? Cette appréciation ne semble guère appropriée. Il convient, en effet, de se défier de la grille de lecture de l’isolationnisme, qui est inadaptée de nos jours et anachronique, eu égard à la place que donnent aux États-Unis, quoi qu’il en soit, leur puissance et leur influence. Cette grille de lecture n’est donc plus pertinente, en dépit de l’usage qu’en font nombre de médias. Pour qualifier l’évolution en cours de la posture américaine, sans doute est-il préférable de parler d’insularité stratégique.
Cette qualification exprime, du reste, les marges de manœuvre stratégiques dont bénéficient les États-Unis du fait de leur situation géographique ; elle correspond à la manière toute obamienne dont Joe Biden conçoit la politique étrangère de son pays.
Pour synthétiser cette réalité, disons que, dans le « monde post- américain » dont les contours se dévoilent chaque jour davantage et qu’anticipait Fareed Zakaria , les États-Unis ne sont pas supplantés : nous ne nous trouvons pas au terme d’un cycle hégémonique voyant le triomphe incontesté d’une nouvelle superpuissance, qui pourrait être la Chine. Les États-Unis demeurent l’unique superpuissance du jeu international. La nouveauté de la configuration actuelle réside dans la place qu’y prennent de grandes puissances émergentes, avec lesquelles il faut compter. Dans ce monde en reconfiguration, l’insularité états-unienne de fait cohabite avec les ambitions des émergents et avec la volonté de puissance des nations situées aux marges des systèmes d’alliance. Alors que les États-Unis occupaient jusqu’alors activement la place de garant de l’ordre international, leur insularité de plus en plus marquée, couplée aux appétits des nouvelles puissances, dessine la carte d’un monde en dérèglement progressif.
Au fond, après leur expérience non concluante de l’unilatéralisme, pendant le moment unipolaire ayant suivi la chute de l’empire soviétique, les États-Unis ont pris, pas à pas, le chemin d’une sensible rationalisation de leurs engagements extérieurs, qui sont désormais rapportés strictement au critère de l’intérêt national. L’on ne saurait lire autrement les déclarations du président Biden au moment du retrait américain d’Afghanistan .
Cette ligne de force de la politique étrangère américaine est, en fait, une ligne de continuité entre les dernières administrations présidentielles. Car, par-delà la divergence affichée, les postures de Joseph Biden et de Donald Trump ne sont peut- être pas si radicalement opposées. La différence principale de leurs politiques relève de la praxis et réside notamment dans la place variable qu’ils accordent respectivement aux formats de négociation multilatéraux.
Cette réserve faite, les trajectoires de leurs politiques internationales, si elles ne sont pas identiques, sont globalement parallèles : elles tracent la voie d’un retrait des Etats-Unis sur leur insularité et sur leurs seuls intérêts. L’on pourrait parler, à ce propos, d’un engagement international de la stricte suffisance.
Plus que par la campagne présidentielle actuelle, ce moment d’oblitération de la puissance des Etats- Unis, qui prennent le visage d’un balancer empêché, s’expliquerait donc surtout par une réalité dont ils ne peuvent faire l’aveu, le choix délibéré et réaliste de demeurer en retrait tant que leurs intérêts directs ne sont pas en cause. Ce choix déterminé serait, en l’occurrence, la signature de Joe Biden dans le domaine de la politique internationale, qui connaît un décentrage, avec l’apparition de nouveaux centres de gravité, situés en dehors de la sphère occidentale.
Des affrontements aux points de contact des principales sphères d’influence
Dans World Order, où il s’interrogeait sur les défis mettant à l’épreuve l’ordre westphalien, Henry Kissinger anticipe, avec une certaine clairvoyance, un possible déplacement de la conflictualité aux points de contact des principales sphères d’influence se partageant le monde :
« La reconstruction du système international est le défi ultime lancé aux hommes d’Etat de notre époque. Leur échec en la matière sera sanctionné, non par une guerre majeure entre Etats (même si, dans certaines régions, cela n’est pas exclu), mais par la constitution de sphères d’influence identifiées par des structures internes et des formes de gouvernement particulières . »
Il poursuit :
« Chacune de ces sphères pourrait être tentée de se lancer dans une épreuve de force à ses confins, contre des entités autres, relevant d’ordres semblant illégitimes… Une lutte entre régions pourrait être bien plus éprouvante que ne l’avait été la lutte entre les nations »
Les blocs distincts qui se coagulent forment, pris individuellement, des ensembles plutôt homogènes certes, mais ils contribuent, à l’échelle mondiale, à la constitution d’un cadre de plus en plus hétérogène, à l’intérieur duquel, comme le prévoyait Kissinger, ils peuvent entrer en friction. D’une certaine manière, cette réalité pourrait être également analysée à la lumière de la catégorisation ébauchée par Raymond Aron , lorsqu’il oppose les « systèmes homogènes » et les « systèmes hétérogènes », en empruntant cette distinction à Panayis Papaligouras
L’évolution en cours nous invite à relancer un débat sur les fondements nécessaires d’une « société internationale », telle que l’envisageait dans sa thèse ce dernier. L’hétérogénéité de plus en plus marquée du monde, qui n’est plus uni qu’à travers l’universelle reconnaissance de la souveraineté des Etats et l’intérêt communément porté à un fonctionnement fluide de l’économie, rend plus difficile, en l’espèce, la concrétisation de l’idée de « société internationale », mais aussi de moins en moins stables, à une autre échelle, les zones de crise et de conflits situées aux marges des blocs. Cette hétérogénéité tient en grande partie à l’échec des prétentions universalistes des principales puissances occidentales, qui, à certains moments de leur histoire, ont envisagé ou envisagent toujours d’imposer au monde leur modèle, y compris par la force .
Les initiatives de cet acabit, dont la guerre en Irak de 2003 fournit l’archétype, concourent à affaiblir la légitimité de l’ordre international. Ainsi, sous tous leurs avatars, les occidentalistes enclins à considérer comme légitimes en soi des politiques de force faisant prévaloir leur vision du monde au mépris même de la souveraineté étatique négligent l’intérêt commun des nations à la préservation de la stabilité.
Les tenants de cette position promeuvent une lecture civilisationnelle des rapports de force, incompatible avec la recherche diplomatique de solutions politiques.
Il paraît clair que l’éclipse des Etats-Unis, l’affaissement d’un Occident aux obsessions ultra- individualistes incompréhensibles du vaste monde, le précédent constitué, dans notre mémoire récente, par l’offensive de la Russie au-delà de ses frontières reconnues ont contribué à libérer des forces centrifuges incontrôlées dans le champ international.
En témoigne également la politique de force conduite par Benjamin Netanyahou à l’égard du Liban, sans tenir compte de sa qualité d’Etat réputé souverain. Au-delà de la mobilisation de moyens de renseignement, d’intervention et de frappe puissants, l’atout central d’Israël est constitué notamment par sa vitesse. Sa tactique consiste à agir plus rapidement que ne réagissent les chancelleries. Les hésitations et les désaccords des principales puissances à l’égard de ces opérations conduisent, faute de consensus, à une forme d’acquiescement tacite. Malgré les initiatives des autorités françaises en sa faveur, le Liban semble, en fait, bien seul face aux offensives de son voisin. Pour garder l’initiative et l’avantage, le gouvernement israélien exploite les failles qu’il décèle dans son environnement en s’affranchissant des règles de comportement international communément admises et peut aller jusqu’à contester en pratique la légitimité d’acteurs reconnus, comme celle du secrétaire général des Nations unies, qu’il déclare persona non grata sur son territoire
Les déstabilisations en cours attestent que, dans le cadre toujours westphalien des relations internationales contemporaines, tous les malheurs du monde viennent d’un reflux ou d’un refus de la forme étatique. Le problème général des pays des zones de contact en proie à des déstabilisations violentes est souvent le degré imparfait de réalisation étatique auquel ils sont parvenus.
Déstabilisé par le conflit actuel, auquel les multiples crises politiques qui l’affectent l’ont mal préparé, le Liban est aujourd’hui à la croisée des chemins. Soit il trouve en lui-même et avec le sursaut de ses élites politiques la volonté de consolider son existence comme Etat et s’emploie, pour cela, à rechercher les voies d’un consensus ; soit il se résigne et se retrouve bientôt miné par la défiance, empêtré dans une situation proche de celle ayant conduit au déclenchement de la guerre civile. Le souhait de parvenir, après deux ans de vacance, à l’élection d’un président de la République, exprimé communément par le président du Conseil, Nagib Mikati, par le président de la Chambre, Nabih Berry, et par le leader druze, Walid Joumblatt, auquel ont répondu positivement le chef des Phalanges, Samy Gemayel, le chef des Forces libanaises, Samir Geagea , ainsi que le patriarche maronite , semblent témoigner d’un changement d’atmosphère.
Comme dans l’Europe centrale du XVIIe siècle, la stabilisation de ces régions en conflit et la consolidation étatique des nations concernées procéderont nécessairement d’une double mise en ordre : à l’intérieur, avec l’enracinement d’une conscience et d’usages politiques partagés sous l’égide d’une autorité communément reconnue ; à l’extérieur, par l’accès à une autonomie réelle, favorisant dialectiquement une intégration toujours plus forte dans le concert international. Sans avancées sur ces lignes, c’est la loi du plus fort qui continuera de l’emporter.
Une légitimité qui s’efface du cadre distors du monde
Les dérèglements du monde s’amplifient. En dépit de ce que peut affirmer, avec optimisme, le président Biden, l’ordre international se défait par perte progressive de légitimité.
Les Etats-Unis restent en retrait, tandis que les capacités militaires et la crédibilité manquent à l’Europe, qui ne peut être présentée comme un ensemble vraiment cohérent au plan stratégique. Cet effacement relatif et cet affaissement de la sphère euro-atlantique déséquilibrent l’ordre mondial et permettent à des acteurs périphériques de donner libre cours à leurs appétits de puissance. Sur ce point, si l’on souhaite garantir la stabilité du monde, les politiques de force décorrélées de tout rapport avec un principe de légitimité internationale ne peuvent être considérées comme anodines, ni trop facilement tolérées.
Ce que l’on peut appeler, de manière imagée, l’aplatissement médiatique, qui fait se confondre le là et l’ici, ne concourt pas, au demeurant, à rendre plus aisée la compréhension des affaires internationales par le grand public. Par les raccourcis dont il procède, il favorise généralement la confusion des plans externe et interne et conduit l’individu à projeter sa vision et ses habitudes, congruentes à l’ordre interne, sur la réalité internationale. Or, la situation externe n’est pas assimilable à la réalité vécue dans une société donnée. Il faut, de plus, se garder de toute instrumentalisation de la situation internationale à des fins de basse politique interne.
La solution aux crises multiples qui concourent à déstabiliser l’ordre mondial ne réside pas dans l’ingérence directe, violente ou non, ni même, selon la formule des libéraux et des néoconservateurs, dans une quelconque démocratisation par greffe, mais plutôt dans la consolidation étatique.
A-t-on à ce point fait le deuil de l’ordre international reposant sur la souveraineté étatique pour oublier cette réalité?
Les Etats-Unis sont, quant à eux, plus réalistes et égocentrés que jamais. Cela constitue, certes, un grand acquis depuis l’échec de l’extraversion bushienne. Dans le même temps, la réserve d’une Amérique de plus en plus insulaire donne aux autres acteurs mondiaux, affranchis de toute modération, la faculté de faire valoir leurs intérêts de manière très directe, voire violente.
En l’absence d’un véritable balancer, garant et gardien de l’ordre, la seule voie envisageable pour contribuer à la stabilité est celle d’une étatisation toujours plus aboutie du monde, qui a pour corollaires, au plan structurel, la consolidation d’équilibres régionaux et la diffusion d’usages partagés, facteurs de légitimité.
Olivier Chantriaux