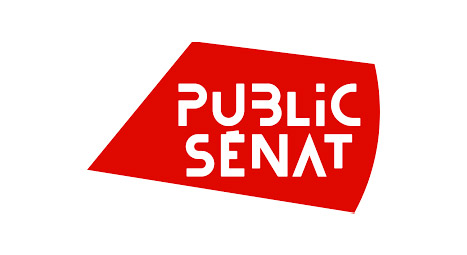Crise introspective de l’Alliance atlantique et interrogations sur la possibilité de gagner la guerre contre le djihadisme au Sahel. Les déclarations du Président de la République sur la « mort cérébrale de l’Otan » et la perte tragique de treize de nos soldats au Mali viennent relancer les débats sur la défense de l’Europe. Alain Meininger, membre du Comité éditorial de la RPP, revient sur ce sujet dont la complexité perdure depuis sept décennies en soulignant la dualité des problématiques en jeu et des réponses qu’elles appellent.
Une conjonction d’évènements dramatiques et de déclarations franches vient d’avoir le mérite de projeter un éclairage instructif sur le lancinant débat relatif à la défense du continent européen. Dans un premier temps le président de la République, dans une longue et pertinente interview du 7 novembre à The Economist, faisait le constat amer et brutal d’une Otan en « état de mort cérébrale » : trois ans de dénigrements « trumpiens » et la récente décision d’Ankara de s’en prendre aux kurdes le long de sa frontière avec la Syrie, sans parler de son achat des systèmes russes anti-missiles S-400 avaient jeté le doute sur la viabilité de l’Alliance. Ont suivi la réplique du Président encore en exercice du Conseil européen, le polonais Donald Tusk, critiquant courtoisement en la forme mais fermement sur le fond, les propos du président français et la réponse a minima mais également réprobatrice de la chancelière allemande ; la mort au combat le 25 novembre de treize soldats français de l’opération Barkhane a donné d’un seul coup une dimension humaine et un éclairage tragique à des débats techniques souvent éloignés des préoccupations des citoyens de l’Union. Autant de raisons d’essayer de prendre un peu de recul sur des problématiques complexes qui nous concernent plus que les apparences ne le laissent à penser.
Toute défense d’un ensemble repose sur un certain nombre d’invariants au travers de l’histoire : une définition à peu près stable et consensuelle de l’objet à défendre tant en termes de contours géographiques qu’en termes de patrimoine civilisationnel ; même à l’apogée de sa domination de l’Europe et du pourtour méditerranéen, l’Empire romain n’avait pu s’abstraire de construire son limes ; souvent pour contenir les agressions des barbares, parfois pour s’isoler de peuples qu’il considérait comme non civilisables comme ce fut le cas au nord de la Bretagne (l’actuelle Grande Bretagne) avec les murs d’Hadrien puis d’Antonin. Ces caractéristiques de base font défaut à la construction européenne : le pourtour géographique à protéger fait encore débat ; il suffit de voir les récentes controverses sur l’élargissement à la Macédoine du Nord et à l’Albanie dont les négociations d’adhésion ont été ajournées sous l’impulsion du président français lors du Conseil européen du 18 octobre dernier. Le patrimoine civilisationnel à préserver n’est guère l’objet d’un consensus plus évident. En attestent les débats suscités par l’immigration et celui sur la « protection » de notre style de vie, issu de l’intitulé – amendé depuis en « promotion » – du portefeuille du commissaire européen Margaritis Schinas.
Mais dans le cas de l’Europe, une autre ligne de clivage, que l’on peut qualifier de fondatrice, certes connue mais moins souvent soulignée, fissure le dossier en deux. Elle sépare peu ou prou une Europe du Nord obsédée, non sans raisons, par la Russie, du fait de l’histoire du vingtième siècle, parfois antérieure, et une Europe du sud tournée depuis la plus haute antiquité vers la Méditerranée et qui a gardé dans ses gènes historiques la mémoire de Lépante, du siège de Candie et de la bataille de Vienne, de la défaite de Mohacs ou de Charles Martel guerroyant à Poitiers. La séparation n’est certes pas d’une linéarité rigoureuse – la Hongrie en est l’exemple qui a successivement éprouvé les deux menaces, ou même la France longtemps préoccupée par la première avant d’être obligée de se focaliser depuis quelques années sur la seconde – mais le clivage est réel entre ceux qui tels Drogo dans « Le Désert des Tartares » ont les jumelles rivées sur les imperceptibles frémissements venant de l’Est et du Septentrion et ceux qui, imprégnés de Jean Raspail et de son « Camp des saints », veulent avoir la prescience d’un danger venant de la Méditerranée. S’est installé dès lors un jeu croisé de récriminations sur le partage du fardeau :
aux reproches états-uniens sur le peu d’empressement des Européens à prendre leur juste part dans l’Otan, s’ajoute aujourd’hui l’amertume de la France qui estime supporter l’essentiel des efforts de la lutte contre le djihadisme dans la bande sahélienne, au bénéfice de la sécurité de l’U.E.
« Si certains veulent voir ce qu’est le cost-sharing, ils n’ont qu’à venir aux cérémonies que la France organise lundi » ; quelques jours avant le sommet de l’Otan du 4 décembre et suite à la mort tragique de treize de nos soldats au Mali, le président de la République rappelait ainsi ce qu’est le « prix du sang ». Logique dans laquelle s’inscrivait la ministre française de la Défense qui, le 21 novembre dernier, incitait nos partenaires européens à s’engager plus avant dans la lutte, difficile et incertaine, contre le djihadisme au Sahel aux côtés des 4 500 soldats français de l’opération Barkhane. Certes les premiers et modestes signes d’une solidarité se mettent en place puisqu’outre l’aide efficace des Britanniques, des contingents allemands, espagnols, tchèques, estoniens et danois épaulent aujourd’hui les français. Depuis deux décennies les institutions n’ont par ailleurs cessé d’évoluer : Agence européenne de défense, Traité de Lisbonne, Coopérations structurées permanentes, Fonds européen de défense ou plus récemment Initiative européenne d’intervention peaufinent le cadre. La nomination d’un commissaire français dont le portefeuille recouvre largement tous ces aspects est par ailleurs de bonne augure. Mais en dépit des efforts pour concrétiser une « Politique de sécurité et de défense commune », la géopolitique est aussi affaire d’histoire et de géographie.
Il semble aujourd’hui aussi difficile de sensibiliser les maltais ou les grecs aux incursions de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises que les Baltes ou les Finlandais aux difficultés de la lutte anti-djihadiste au Sahel.
D’autant que ces deux axes d’incertitudes mettent en jeu des problématiques politiques et sécuritaires fort différentes : la Russie est certes européenne dans ses œuvres vives mais est aujourd’hui ombrageusement refermée, quelque peu imprévisible et dotée d’armes de destruction massive régulièrement modernisées ; rappelons que le retrait américain en août dernier du traité FNI de 1987 se fonde sur la conviction que le récent déploiement des missiles russes SSC-8, en menaçant l’Europe, viole l’accord, le rendant de ce fait caduc. Mais des agressions russes en deça du seuil de riposte militaire peuvent être discrètes et protéiformes et constituer de réels dangers dans le satellitaire, le cyber ou d’autres espaces, n’en nécessitant pas moins une solidarité atlantique.
Le pourtour méditerranéen, lui, est divers, démographiquement dynamique et travaillé de forces certes hostiles à l’Occident mais jusqu’ici faiblement armées. Les menaces potentielles, y sont d’une autre nature et en tous cas insusceptibles des mêmes réponses en termes de défense. Le sujet reste néanmoins traversé d’une interrogation existentielle d’essence politique : dans quelle mesure et jusqu’à quand sera-t-il acquis comme légitime que l’Europe s’y projette militairement- en son nom, en vertu d’accords bilatéraux, sous mandat otanien, onusien ? – afin d’y exercer une sorte de sécurité préventive ou de droit de suite dans un certain flou quant à l’assentiment des populations locales. Alors que l’on voit poindre ici et là-bas – notamment au Mali – les premières réticences, la réponse est peut-être dans la question, laquelle en appelle une autre : dès lors qu’une projection massive y deviendra impossible, le débat ne se reportera-t-il pas sur une sécurisation drastique de notre limes, en clair du périmètre extérieur de l’U.E. ? D’autant que le comportement de certains pouvoirs africains locaux est parfois ambigü : la tentation n’existe-t-elle pas d’inverser la problématique, de s’accommoder ça et là d’une cohabitation avec le djihadisme, de se dispenser des efforts militaires et économiques nécessaires et de solliciter les forces européennes comme recours ?
Au plan militaire, la sécurisation de notre environnement méditerranéen et sahélien relève pour l’instant de forces bien entraînées, souvent qualifiées du terme devenu extensif de « spéciales » – que la France cherche à coaliser depuis un an au niveau européen – appuyées sur des technologies de pointe englobant le numérique, le spatial, l’intelligence artificielle et le renseignement. Le fait que les moyens requis soient à la portée des capacités technologiques, industrielles et contributives de l’U.E n’exclut pas un soutien de Washington ; les forces spéciales américaines et leurs drones « Reaper » sont présents sur place et le commandement américain pour l’Afrique vient d’activer sa base d’Agadez au Niger. Il demeure, qu’au prix d’une nécessaire augmentation des budgets de défense des 27 (ou 28 ?), entamée mais trop lente, le dossier se prête à la construction d’éléments significatifs d’une capacité européenne conventionnelle de défense et de sécurité ; s’y soustraire relèverait d’une négligence coupable pour l’avenir. La France et le Royaume-Uni détenant à ce jour l’essentiel des moyens, un Brexit dur, s’il se confirme, devra préserver, voire compléter, les accords existants – type Lancaster House – mais posera inéluctablement à terme la question du renforcement et de l’harmonisation des moyens militaires de l’Union. Question plus politique que financière, l’augmentation substantielle du format de la Bundeswehr – sur le caractère opérationnel de laquelle un doute subsiste – devra être mise sur la table.
A l’inverse, notre voisinage oriental nous impose, pour longtemps encore, la solidarité atlantique à l’abri du parapluie nucléaire américain, seul capable d’exercer une dissuasion crédible à l’échelle du continent, vis-à-vis de la Russie et peut-être demain de la Chine. On sait le trouble instillé à ce sujet par Obama et son basculement stratégique vers l’Asie ; trois ans de politique étrangère trumpienne ont porté le doute jusqu’au cœur du dispositif d’assistance mutuelle qu’est l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord.
Il importe néanmoins de rester serein sur la durabilité à moyen terme de la solidarité atlantique ; la densité des liens culturels, historiques, civilisationnels est telle que l’abandon de l’Europe par les Etats-Unis est peu probable à échéance prévisible.
Les manœuvres « Defender 20 », qui verront débarquer 20 000 G.I. en mai prochain sur le vieux continent sont de nature à rassurer. Doit-on pour autant en envisager l’hypothèse ? Sans doute et dans ce cas la pérennisation d’une dissuasion nucléaire nationale du faible au fort, telle que la France l’a conçue pour elle-même depuis les années soixante, demeure la meilleure des garanties. Il faut néanmoins s’imprégner des limites de l’exercice : la menace voire la décision d’emploi, avec les risques qu’elle emporte, n’est concevable que pour une communauté nationale soudée estimant sa survie ou ses intérêts vitaux menacés ; face à de tels enjeux la délégation ou le partage décisionnel sont inconcevables et, en dépit des vaticinations journalistiques, la dissuasion à 27 n’existe pas. Juin 1940 nous a rappelé combien l’histoire peut être tragique et les nations mortelles ; on sait les deux conclusions majeures qu’en avait tirées le général De Gaulle : l’article 16 de la Constitution pour les périls intérieurs et la dissuasion nucléaire vis-à-vis des dangers extérieurs. A méditer.
Alain Meininger