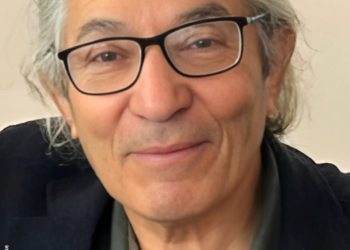« Le maintien de l’État militaire est l’ultime moyen, soit de continuer la grande tradition, soit de maintenir par rapport au type supérieur de l’homme, au type fort. Et toutes les notions qui éternisent les hostilités et les inégalités entre les États sembleront pour cette raison digne d’approbation (p. ex. le nationalisme, le protectionnisme). » La volonté de puissance XI 1887 – III 1888 (XVI, § 729). « La musique russe exprime avec une simplicité touchante l’âme du moujik, du bas peuple. Rien ne parle plus vivement au cœur que ses mélodies gaies, qui sont d’une tristesse absolue. Je donnerais tout le bonheur de l’occident pour la tristesse russe. Mais comment se fait-il que les castes dominantes russes soient absentes de cette musique ? Suffit-il de dire que méchant cœur n’a pas de chanson ? » La volonté de puissance E.-A. 1888 (XIV, 1ère partie, § 291).
Le retour de la guerre sur le sol européen a sidéré le monde, plongeant la psyché occidentale dans la stupeur et la perplexité. Le commentaire oscille entre le dédain, envers un acte jugé incongru, barbare, voire suicidaire, et l’anxiété, alimentée par une psychiatrisation de Vladimir Poutine, diagnostiqué tour à tour nosophobe, germophobe, paranoïaque, voire dément. Folie des grandeurs, complexe obsidional, dérive dictatoriale, toutes choses pouvant certainement participer au tableau explicatif, mais qui occultent aussi le principal ressort de cet acte historique. En effet, Vladimir Poutine, à l’occasion de cette geste géopolitique, effectue surtout une révolution de valeurs, augurant un virage totalitaire pour la Russie, comme la lecture de ses discours, tout autant que celle des prêches du patriarche de Moscou, peuvent l’illustrer. On y lit en effet le rejet viscéral des valeurs libérales, qu’ils associent respectivement à la décadence civilisationnelle, et à la déchéance des vertus chrétiennes, ainsi que la proclamation de la nécessaire régénérescence de la société civile russe. La guerre déclenchée par Vladimir Poutine, au-delà de l’histoire, de la géographie, des rivalités nationales, constitue donc l’acte fondateur d’une rivalité civilisationnelle, qui voit s’opposer les démocraties libérales occidentales, associées à des alliés illibéraux de circonstances comme la Pologne, aux régimes illibéraux, qu’ils soient démocratiques comme l’Inde et la Hongrie, ou autoritaires comme la Russie et la Chine.
Le vingtième siècle a vu se développer la dialectique capitalisme/communisme, fille de l’avènement de l’industrialisation et de l’économie de marché. L’affrontement sur le mode productif n’est plus, le capitalisme ayant triomphé, même au cœur de la Chine communiste.
Le vingt-et-unième siècle verra probablement grandir la dialectique libéral/illibéral, née de l’avènement de la globalisation et de l’hégémonie du logiciel libéral.
L’agon se porte donc désormais sur les valeurs sociétales, en particulier sur le rapport à la volonté de puissance. Les valeurs du libéralisme contemporain reposent en effet sur un triptyque : « Liberté, Équité, Tolérance ». Liberté tout d’abord, mais une liberté toute individualiste, posée en vertu cardinale, qui s’affranchit en plein de tout devoir naturel envers le groupe (à l’exception de celui que se choisit l’individu). L’Équité ensuite, en non l’égalité, celle-ci étant jugée comme étant mensongère et perpétuant les injustices (la méritocratie, prônée par l’universalisme, n’étant en effet que le faux-nez d’une caste cherchant à maintenir ses privilèges). L’Équité, et son corolaire, l’inclusion, visent donc à une régulation sociale administrée par la sociologie ; une régulation sociale qui réfute la compétition, source de souffrances et génératrice d’inégalités. Enfin, la Tolérance, qui a évolué en la reconnaissance et la promotion de la différence. Celle-ci nie toute prééminence entre les groupes culturels, qui sont mis à pied d’égalité. Tout en valorisant la xénophilie, et en rabaissant les groupes supposés dominants, à des fins de réparation, envers les groupes supposés dominés. Ces vertus libérales procèdent donc d’une triple abolition de la puissance. La Liberté est ici l’abolition de la puissance du groupe sur l’individu. L’Équité implique l’abolition de la puissance de l’individu sur ses semblables. La Tolérance enfin, impose l’abolition des dynamiques de puissance entre les groupes.
L’âme du libéralisme contemporain poursuit donc la quête de l’extinction de la volonté de puissance sous toutes ses formes, avec un système de valeurs promouvant l’égalitarisme et la pacification. Et ce, afin de favoriser la productivité, et d’alimenter le consumérisme, qui détourne l’être humain de ses passions tristes. Cette abolition de la volonté de puissance portée par les forces libérales, rejoint le combat de deux autres grandes forces sociétales contemporaines. La première étant le doux commerce globalisé, qui requiert une pacification des rapports entre les nations et les cultures, ainsi que l’homogénéisation de leurs systèmes de valeurs. La seconde étant l’écologisme radical, qui cherche à abolir la volonté de puissance de l’Homme sur la Nature. Toutes ces dynamiques confluent, et génèrent les passions sociétales actuelles, qui traquent la puissance et diabolisent ses incarnations, en clouant au pilori ses excès : de la chasse au « pervers narcissique » à celle de la « masculinité toxique », de la promotion de la victimisation à la prime au ressenti, du déboulonnage des statues à la déconstruction de l’Histoire… Cette idéologie libérale prend chair dans le « snowflake », ce « dernier homme », qui n’est plus que nombrilisme et ressenti, qui expose sans cesse ses fragilités, dont il use comme une arme, et qui n’aspire plus qu’au ludisme, à la sécurité, au confort psychologique et matériel. Parmi tous les pays occidentaux, le Canada constitue l’avant-garde de cette idéologie libérale, et Justin Trudeau en est le parangon de vertu.
À l’exact inverse, le mouvement illibéral est une revendication, voire une exaltation de la volonté de puissance. Il repose lui sur un triptyque : « Loyauté, Hiérarchie, Domination ». Loyauté de l’individu envers le groupe : l’individu n’est rien, le groupe est tout, ce qui explique que Vladimir Poutine puisse allégrement sacrifier ses soldats sur l’autel de la gloire de la Grande Russie. Hiérarchie, laquelle englobe toute la société, avec une organisation verticale et rigide, dominée par la figure du guide, incarnation et symbole de la société organique. Vladimir Poutine a d’ailleurs rétabli dans le texte les devoirs de l’élite envers le peuple, avec des oligarques sommés de retourner dans le giron de la société russe, sous peine d’excommunication. Domination, enfin, l’impérialisme étant ouvertement revendiqué et affiché. L’ascendant de la culture russe orthodoxe au sein de la fédération de Russie est assumé, et exige la soumission des cultures voisines ou minoritaires : juifs et musulmans, unis sous la croix orthodoxe, biélorusses et ukrainiens, contraints de rejoindre la bannière russe. Ce triptyque illibéral constitue, à l’exact inverse du triptyque libéral, une triple affirmation de puissance : celle du groupe sur l’individu, celle de l’individu sur ses semblables, celle du groupe dominant sur les groupes dominés. La virilité et la force sont ici glorifiées, la sensibilité et l’empathie conspuées, comme autant de marques de faiblesse. Le bien-être matériel est traité avec mépris, au profit d’un ascétisme martial et de la célébration de la foi, en l’Église et la patrie. Vladimir Poutine incarne plus qu’aucun autre dirigeant la volonté de puissance, et l’a fréquemment mise en scène, en posant en homme fort, qu’il soit un judoka, un chasseur dans la toundra, ou un chef hiératique. Et sa dynamique actuelle d’un brutal repli nationaliste et protectionniste, manifestement anticipé, démontre qu’il compte mettre à son diapason la société russe. Son bellicisme a d’ailleurs eu des conséquences fâcheuses sur la popularité des mouvements illibéraux occidentaux, les faisant apparaître sous un jour menaçant, comme peuvent en témoigner les disgrâces relatives d’Éric Zemmour et de Donald Trump.
Ce virage autoritaire a fort probablement trouvé un catalyseur dans l’exemple de cette dictature prospère et accomplie qu’est la Chine de Xi Jinping.
La rencontre des deux dirigeants lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver révélait d’ailleurs une inquiétante complicité. Deux camarades aux cravates mauves assorties, avec un Vladimir Poutine qui exprimait bienveillance et déférence envers le dictateur chinois ; une attitude bien éloignée de la froideur et de la défiance (et parfois de l’irrespect) qu’il peut afficher envers ses homologues occidentaux. Xi Jinping a lui aussi recadré ses milliardaires, imposé la domination chinoise aux peuples qu’il administre, et inculque à sa société civile un narratif belliciste, en rupture avec un Occident jugé décadent et menaçant. La diatribe du patriarche Kyrill envers la « gay pride » rejoint l’oukaze de Xi Jinping sur les artistes efféminés, laquelle constitue, au-delà de l’intolérance, l’illustration d’une promotion de la virilité, à des fins de conditionnement de la société à la bellicosité. Un bellicisme porté d’ailleurs par les loups combattants de la diplomatie chinoise, qui fait écho avec l’attitude des diplomates de l’ours russe. L’Occident ne devrait d’ailleurs pas sous-estimer l’atavisme impérialiste et autoritaire des cultures russes et chinoises, dotées de populations dont l’Histoire a prouvé la propension à la soumission, tout autant que les formidables capacités d’adaptation, et de résilience, face aux souffrances et aux privations.
Pour résumer, le logiciel illibéral est donc une représentation en tout point inverse du logiciel libéral, comme le capitalisme constituait l’antithèse de l’économie socialiste.
À la thématique de l’économie, a succédé celle de la volonté de puissance, qu’un libéralisme mondialisé cherche à abolir, afin d’assurer l’avènement de la « Fin de l’Histoire », urbi et orbi, générant une réaction qui s’est elle-même définie comme « illibérale ». À l’horizontalité cotonneuse du libéralisme, s’oppose donc la verticalité sanglante de l’illibéralisme. L’idéologie libérale imprègne avant tout les institutions et les dirigeants, suscitant des réserves, et parfois un franc rejet, au sein de la société civile occidentale. Espérons qu’il en soit de même au cœur de la société civile russe, face à l’illibéralisme totalitaire de Vladimir Poutine.
François-Xavier Roucaut
Psychiatre
Professeur adjoint de clinique à l’université de Montréal