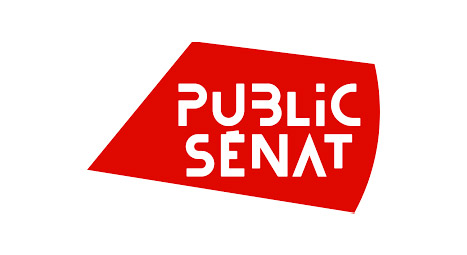Côté militantisme, je ne fréquente pas les réunions non-mixtes (ou mixtes) où l’on débat de la dure condition des femmes jusqu’au bout de la nuit ; j’ai d’autres engagements, tiers-mondistes, politiques, et de jeunes enfants à emmener à la crèche puis à l’école tôt le matin. Mais je réponds aux demandes des associations qui m’invitent à venir en province (on n’est pas encore obligé de dire région ou territoires…) parler de tous ces sujets sur lesquels je travaille. Quand dans l’assistance, souvent mixte, un dinosaure soupire qu’il vaudrait mieux laisser les choses évoluer « naturellement » (réflexion courante quand je traite de la parité), je me fais un plaisir de répondre que, de 1946 où l’Assemblée nationale comportait 5,7 % de femmes à 1993 où elle en comptait 6 %, l’évolution « naturelle » n’était pas d’une célérité bouleversante. Je participe à quelques comités Théodule et, plus tard, à des instances comme l’Observatoire de la parité ou la Haute autorité éthique du Parti socialiste. Trêve d’énumération de ces bons et loyaux services…
QUELS FÉMINISMES D’HIER À AUJOURD’HUI ?
Ces travaux et ces engagements m’ont offert, dans la durée, un champ d’observation privilégié du féminisme, sous ses divers jours, ses variétés qui, comme les bonnes et les mauvaises herbes, coexistent depuis que des militants de l’un et l’autre sexes se battent pour qu’advienne l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Pour que cessent les discriminations et injustices, pour que l’on vive dans une société où les identités (si tant est qu’il en faille) ne seraient plus dessinées par un critère unique, ici le sexe, tout aussi irrecevable à mon sens s’il est religieux, ethnique ou social.
Ces luttes de tendances ne sont pas nouvelles mais elles peuvent prendre une tournure inquiétante quand, plutôt que des débats, elles génèrent des accusations, des dénonciations, des exclusions. Si mes parents, grands résistants, m’ont transmis un réflexe, c’est bien celui du refus de la délation, celle-ci étant d’ailleurs souvent liée à un « ôte-toi de là que je m’y mette » à peine camouflé. Comment en est-on arrivé là ?
Si l’on veut dévider le fil qui a conduit à la situation actuelle, il faut remonter à 1989, lorsqu’est apparu, sous la plume de la juriste américaine Kimberlé W. Creenshaw, le concept d’intersectionnalité, bienvenu pour les travaux de recherche. Analyser les inégalités et les discriminations, nécessite sans conteste de tenir compte à la fois du genre, de la classe et de la race. D’ailleurs, dans la recherche en science politique, l’initiative est d’autant mieux reçue que, sans mettre ce mot d’intersectionnalité sur les choses, c’est ce que nous faisons depuis les années 1960, en pratiquant « l’analyse multivariée », à savoir l’étude des opinions/ attitudes/comportements des femmes et des hommes en retenant leur milieu social, leur religion, leur âge, leur niveau d’études. Nous comparons les ouvriers et les ouvrières, les agriculteurs et les agricultrices. Élémentaire mon cher Watson.