La haine des juifs
L’antisémitisme connaît une résurgence inquiétante. Confusion entre critique d’Israël et haine des juifs.
A l’occasion de la sortie du film « Dernier amour » de Benoît Jacquot, Alain Meininger s’interroge sur les destins croisés de Giacomo Casanova, Don Giovanni et Lorenzo da Ponte.
Elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire : tel est apparemment l’objectif de Marianne Charpillon, jeune courtisane qui croise à Londres, en 1763, la route de Giacomo Casanova. Le récent film de Benoît Jacquot, « Dernier amour » qui retrace cet épisode atypique tiré des mémoires de l’illustre aventurier est une occasion, une de plus, de s’adonner à l’éternelle tentation de comparer ou d’opposer les comportements amoureux du séducteur vénitien et du personnage de Don Giovanni.

Le parallèle semble par trop évident et confine à la mise en abîme des trajectoires des deux personnages. Ils se sont un peu rencontrés, fictivement certes, par l’entremise d’un homme dont la vie n’a guère à envier à la leur. Alors qu’on ne compte plus les pièces de théâtre, les opéras et les films traitant de Don Giovanni et de Casanova, à quand une œuvre majeure sur Lorenzo Da Ponte ? Ses mémoires – enjolivées diront certains mais est-ce si original – sont largement à même de fournir la matière nécessaire. Les lectures que nombre d’exégètes qualifiés ont faites des trois livrets qu’il a confectionnés pour Mozart – Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi fan tutte – permettront d’utilement compléter ou amender. En septembre 1787, Mozart et Da Ponte sont à Prague pour mettre la dernière main au Don Giovanni quand le librettiste est rappelé à Vienne par Salieri. Casanova donne alors un coup de main, modeste certes – les deux modifications de la scène 9 de l’acte 2 – à la confection du livret de l’opéra. De même, semble-t-il établi qu’il a assisté, au Théâtre des Etats de Prague, à la création de l’œuvre le 29 octobre 1787. La veille de la première, restaient quelques ajustements à faire et l’on sait que l’ouverture a été composée par Mozart dans la nuit à la villa Bertramka. Le résultat est au rendez-vous ; avec ses deux accords sublimes et glaçants en ré mineur, elle plante magistralement le décor de ce qui pourrait être une leçon de ténèbres. Ce n’est pas tout à fait l’univers du chevalier de Seingalt mais il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il ait mis la main à la pâte. L’image est en tout cas trop belle pour être laissée de côté et Da Ponte retrouvera Casanova à Dresde et à Prague en 1790.
Deux personnages si convergents et si différents ; l’un est virtuel au moins depuis Tirso de Molina et son « Trompeur de Séville » dont rien ne prouve qu’il fût jamais inspiré par un être de chair ; l’autre très réel et même bon vivant.
La première certitude est qu’ils convergent dans la fuite d’eux-mêmes et de la mort, et peut être de tout le reste, mais de manière fort différente.
Don Giovanni est dans la transgression ; c’est même, semble-t-il, son grand œuvre. Tout ce que ce XVIIIe siècle finissant comprend encore de valeurs – certains diraient de tabous – est allègrement piétiné : meurtre du père, viol de la fille, bafouement de l’ordre social, négation de l’existence de Dieu. Au sens originel comme au sens dénaturé, Don Giovanni a rendez-vous avec l’apocalypse, et le monde qui l’entoure avec la Révolution. Il le pressent, s’en moque sans doute et fait de la marche à sa rencontre une succession d’esquives et de dénis qui le rendent insaisissable de corps comme d’esprit. Il vit dans l’instant et sait qu’il n’a pas d’avenir. Le thème a rarement échappé au parallélisme avec la politique ; Molière, avec son Dom Juan, réglait ses comptes avec une censure qui s’était attaquée à son Tartuffe ; le comportement de Don Giovanni incarne la fuite en avant d’une noblesse qui ne veut – ne peut – pas voir le délitement de l’univers qui l’entoure et refuse de concevoir 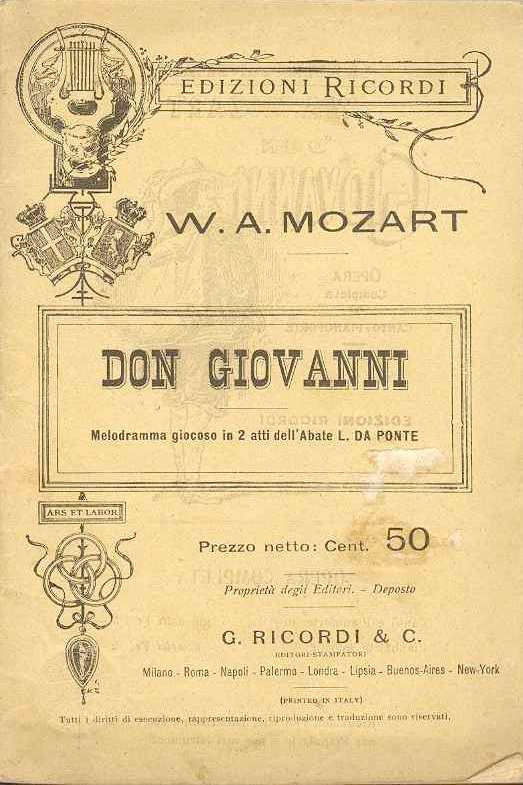 qu’elle court à sa perte. On pense aux fresques de Giandomenico Tiepolo de la Ca’Rezzonico à Venise. Désordre du monde et désordre mental : mauvaise foi, manipulations cyniques de tous, valet compris, ricanement sardonique tracent dans l’opéra de Mozart deux heures et demi durant les contours d’un nihilisme absolu destiné à se jouer de l’anéantissement inéluctable. Mais à quoi s’adonnait-on dans les salons ou les bosquets de Versailles aux premiers jours de juillet 1789 ?
qu’elle court à sa perte. On pense aux fresques de Giandomenico Tiepolo de la Ca’Rezzonico à Venise. Désordre du monde et désordre mental : mauvaise foi, manipulations cyniques de tous, valet compris, ricanement sardonique tracent dans l’opéra de Mozart deux heures et demi durant les contours d’un nihilisme absolu destiné à se jouer de l’anéantissement inéluctable. Mais à quoi s’adonnait-on dans les salons ou les bosquets de Versailles aux premiers jours de juillet 1789 ?
Dans « La nuit de Varennes », Ettore Scola nous montre Casanova suivant presque par hasard la lourde berline de la famille royale en fuite dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Notre homme s’était installé dès septembre 1785 comme bibliothécaire du comte von Waldstein au château de Dux en Bohème où il s’éteindra en 1798 ; son éminent employeur lui laissait-il, à 66 ans, le loisir de parcourir l’Europe au risque de se rompre les os sur des routes improbables ? Toujours est-il que l’occasion est belle pour Marcello Mastroianni d’incarner un Casanova crépusculaire regrettant la décadence d’une société où même le respect se perd. Cette sagesse de l’âge que Don Giovanni n’aura pas le temps d’acquérir est nouvelle chez l’ancien abbé de l’église San Samuele de Venise ; il a en effet traversé l’essentiel du XVIIIe siècle en aventurier multipliant les identités et les expédients.
Tour à tour violoniste, joueur professionnel, espion, diplomate, financier, escroc ou magicien, il s’est servi pour survivre, des failles de l’ordre social de son temps.
La façon dont il s’est joué de madame d’Urfé pour lui soutirer, des années durant, d’importantes sommes d’argent restera l’un de ses hauts faits en la matière. Son origine sociale pas plus que sa fortune ne lui autorisèrent le luxe de survoler et de mépriser l’époque à la manière d’un grand seigneur qu’il n’est pas ; Chevalier de Seingalt n’était qu’un de ses nombreux pseudonymes. « Il est fier parce qu’il n’est rien » écrivit de lui le Prince de Ligne dans ses mémoires publiés en 1828. Casanova put certes déplorer le siècle mais demeura condamné à composer avec.
Leur goût des femmes les rapprocherait dit-on ; est-ce si simple ? Le moins que l’on puisse dire est que leur commerce du beau sexe révèle des mentalités et même des conceptions de la vie fort différentes. Eros et Thanatos ; elles leur servent à maintenir à distance constante, tout au long de leur vie, le spectre de l’inéluctable. Mais Don Giovanni est dans l’ivresse de la conquête qui vise, c’est bien connu, à se prouver qu’on existe, qu’on existe encore, devrait-on préciser dans son cas. Il ne dédaigne pas la concrétisation mais n’en fait pas un drame si des obstacles imprévus l’empêchent de s’y adonner. Tout au plus revient-il à la charge si les circonstances s’y prêtent. Puisqu’il n’est point nécessaire de réussir pour persévérer, tout occupé qu’il est à élaborer la stratégie de prédation de la suivante, l’échec – ou le succès – précédent est aussitôt oublié ; amoureusement, Don Giovanni n’a pas de mémoire. Les femmes lui sont plus indispensables que l’air qu’il respire, lui fait dire le librettiste vénitien, certes prêtre défroqué mais dont il serait mal venu de contester l’expertise dans le domaine.
Mais on meurt, en principe, de ne pas respirer alors que Don Giovanni ne meurt pas d’amour, pas même de manque d’amour, pour la bonne raison qu’il ne saurait tomber amoureux.
Il n’en a pas et n’en prend pas le temps ; telle est par construction la nature du personnage. Le catalogue est là pour en attester ; Elvire, Anna et Zerline ont avec qui parler au milieu des « mille e tre » d’Espagne, et quelques centaines d’autres dont les traces laissées dans la vie du séducteur ont été, on imagine, fugaces.
Dans son « Histoire de ma vie », l’évadé de la prison des Plombs fait état de quelque cent quarante-deux conquêtes féminines dont certaines s’il advenait qu’elles se révélassent exactes – car l’homme ne dédaigne pas travestir à l’occasion la réalité – susciteraient aujourd’hui une réprobation justifiée. Il faut oublier le « Casanova » de Fellini dans lequel le réalisateur règle des comptes avec son personnage ou peut-être plus encore avec lui-même ; l’homme n’était pas le pantin fornicateur que le cinéaste se complaît à montrer. Il savait garder des liens avec ses conquêtes et pouvait à l’occasion leur venir en aide. Plus émouvant et à coup sûr plus subtil est le « Casanova, un adolescent à Venise » de Luigi Comencini qui, en interrogeant les années de jeunesse – le film est fondé sur les cinq premiers chapitres de ses mémoires – révèle une enfance où les femmes jouent un rôle primordial ; l’éducation par sa grand-mère, l’infidélité de sa mère, la rencontre avec son protecteur, le vieux marquis Malipiero, et la célèbre courtisane Millescudi ouvrent des perspectives peu explorées.
Mais, différence essentielle avec Dom Juan, Casanova pouvait tomber sous l’emprise de la belle au cas où elle lui résistait.
« Vous ne m’aurez que si vous cessez de me désirer » lui lance par défi la Charpillon dans le film de Benoît Jacquot. La méthode est certes classique pour faire passer un élégant libertin de l’autre côté du miroir amoureux ; en jouant sur la peur d’aimer et la vanité blessée, la gourgandine est pour une fois plus habile manipulatrice que le galant alors âgé de 38 ans. Cela n’en fît pas la dernière aventure sentimentale de notre séducteur impénitent. L’ultime et peut-être grand amour de sa vie, fut Maria de Liattio, fille d’un ambassadeur, avec qui il entretînt une relation qui dura trois ans avant sa mort.
Alain Meininger
Crédit photos : Wikimedia
L’antisémitisme connaît une résurgence inquiétante. Confusion entre critique d’Israël et haine des juifs.
La France est une société politiquement mature mais profondément fatiguée
Il est indispensable pour l’Europe de renforcer sa souveraineté et son indépendance face à des puissances autoritaires
En quarante ans, l’humanité est passée du premier ordinateur portable à l’ère des intelligences artificielles génératives, bouleversant nos sociétés, nos...

La Revue Politique et Parlementaire
10 rue du Colisée 75008 Paris
Email : contact@revuepolitique.fr
Téléphone : 01 76 47 09 30