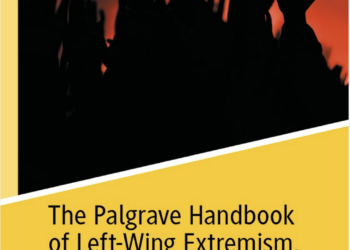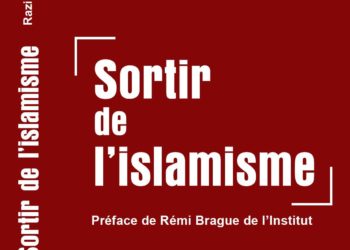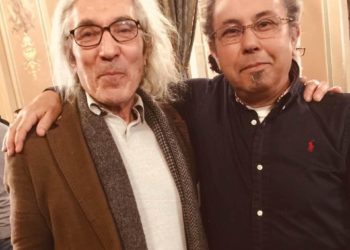« Il vous sera utile de garder Malraux. Taillez pour lui un ministère, par exemple, un regroupement de services que vous pourrez appeler « Affaires culturelles ». Malraux donnera du relief à votre gouvernement ». La recommandation faite à Michel Debré, si elle marquait l’attachement de Charles de Gaulle à celui qu’il devait définir comme son ami génial, était aussi un pari sur la capacité de l’écrivain à diriger un ministère alors qu’en 1958, le portefeuille de l’Information lui avait été retiré moins d’un mois après sa nomination.
L’écrivain-ministre
Sous la Ve République, Malraux se veut le compagnon irrationnel d’un Président en qui il voit « la dernière métamorphose du mythe de la France ». Il fut alors dans une subordination formelle comme ministre mais surtout dans une « subordination profonde du cœur et de l’esprit devant un homme et un destin dont il avait reconnu, une fois pour toutes, la supériorité ». Grâce au soutien indéfectible de son président, le ministre d’État Malraux a siégé sans discontinuer dans les conseils des gouvernements successifs, de janvier 1959 à juin 1969. En 1970, il écrivit d’ailleurs à son cher Général : « Avoir eu l’honneur de vous aider était la fierté de ma vie, et l’est davantage en face du néant ».
En 1968, l’écrivain voyait dans sa longévité ministérielle une preuve de ses capacités d’administration. Évoquant Barrès, caporal en politique et n’y faisant pas le poids, il disait : « Il voulait être ministre. Or, un ministère, c’est avant tout une organisation. Il était grand écrivain. Aurait-il été grand organisateur ? C’est douteux. Même s’il avait été ministre, ça n’aurait pas duré plus de quinze jours ». En ce qui le concerne, André Malraux a duré près de onze années dans ses fonctions ministérielles mais il n’est pas certain qu’il faille en conclure qu’il y fut un grand organisateur. Michel Debré ne se méfiait pas que de son anti-colonialisme ; il avait des doutes sur ses capacités d’administration comme sur certains membres de son premier cabinet. Au surplus, même s’il ne l’avoua que tardivement, le premier Premier ministre de la Ve République trouvait illégitime qu’existe une politique culturelle : « formule trop ambitieuse pour un ministre et même pour l’État ! ». Il a toutefois écrit qu’il considérait la protection du patrimoine et son enrichissement comme « l’apanage et une obligation de l’autorité ».
C’est pourquoi, en son temps, Matignon a veillé minutieusement sur la préparation des deux grandes lois promulguées en 1962 :
Dès l’hiver 1959, on a mesuré chichement le périmètre d’actions du futur ministère, ses crédits et les équipes qui s’en chargeraient.
Pour gérer 2,78 % des crédits de fonctionnement de l’Éducation nationale et 3,15 % de ses crédits d’équipement, ne sont affectées à l’administration centrale des Affaires culturelles que 377 personnes et leur motivation n’est pas toujours forte. Membre du premier cabinet de Malraux dont certains aspects l’épouvantèrent, Pierre Moinot m’a éclairé sur ces cruelles réalités : « Ce ministère, créé sur la chair arrachée à l’Éducation nationale, doté seulement du personnel dont ce grand ministère cherchait à se débarrasser, privé de tout le domaine du livre, écarté de celui de l’audiovisuel et des affaires culturelles extérieures, n’a dû sa survie qu’à une lutte de tous les instants contre plusieurs départements ministériels qui réfutaient jusqu’à son existence, ne croyaient qu’à ce qu’il est convenu d’appeler « les Beaux-Arts », et attendaient la chute d’une tentative qu’ils jugeaient éphémère et sans avenir. ».
Faire de l’action culturelle un impératif public
Après la publication des missions de son ministère, précisées de sa main – « Rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français ; assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent », André Malraux ne s’attendit pas longtemps à des miracles. Il comprit vite ce qu’il lui en coûtait de ne disposer que de 0,38 % du budget de l’État, lançant à ses proches « ce que je peux est nul ! ». Lorsque le plan de stabilisation restreignit encore ses marges de manœuvre, sa note pour son directeur de cabinet fut claire : « Sur le fond, il faut que le gouvernement choisisse entre attendre de nous des développements et en refuser les moyens à nos services ». Mais il ne réclama pas l’arbitrage présidentiel. Comme me l’a écrit le deuxième secrétaire général de la présidence de la République, « Malraux ne trouvait guère d’appui, ni rue de Rivoli, ni à Matignon (…), Il aurait pu faire davantage, notamment par la multiplication des Maisons de la Culture, s’il n’avait été réduit à la portion congrue, alors il se consolait avec des coups réussis ».
Étienne Burin des Rosiers, auteur de ce témoignage, n’oubliait pas qu’à partir de la fin du printemps 1961, Malraux est un homme blessé. La mort simultanée de ses deux fils, s’il ne veut pas qu’on lui en parle, le taraude et le conduira à la tentation du suicide. Sa vieille hantise du néant s’en trouve fortifiée.
Il va donc parfois seulement jouer à être ministre comme le chat de Mallarmé jouait au chat.
Dans ses Antimémoires, il s’étonnera que ses collègues puissent deviser à la table du Conseil comme si leur discussion « existait par elle-même et ne devait jamais finir ». Se souvenant de l’accueil des Kennedy à Versailles et, surtout, de la réception des souverains belges dans la semaine où il avait enterré ses enfants, il rédigera ces phrases abyssales : « Jamais, aux jours éclatants, je n’ai assisté à un dîner à l’Élysée, dans le salon d’Honneur surdoré comme les palaces du siècle dernier, sans voir ce dîner partir vers le néant ».
Un bilan conséquent
C’est à la lumière de ces réalités qu’il faut faire le bilan des années Malraux rue de Valois. Il est conséquent. Outre les grandes lois patrimoniales déjà citées, il convient d’y inscrire :
- le décret du 16 juin 1959 instituant les avances sur recettes pour les films de qualité ;
- le décret du 13 février 1961 favorisant le ré-ameublement du château de Versailles ;
- l’arrêté du 20 avril 1961 relatif à l’exportation des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ;
- le décret du 17 novembre 1961 définissant fiscalement les cinémas « art et essai » ;
- deux textes sur l’enseignement de l’architecture (un décret du 16 février 1962 et un du 6 décembre 1968 mettant fin au système des prix de Rome) ;
- la loi du 22 décembre 1961 sur la Sécurité sociale des artistes du spectacle ;
- la fondation d’un service de la Création artistique (1962) ;
- la constitution de comités régionaux des affaires culturelles (1963) ;
- le décret du 4 mars 1964 instituant la commission chargée de faire renaître un inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France ;
- la création d’un fonds de soutien du théâtre privé et d’une réunion des théâtres lyriques municipaux (1964) ;
- la loi du 26 décembre 1964 sur la Sécurité sociale des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ;
- la désignation de conseillers régionaux à la création artistique (1965) ;
- la constitution d’un service de la musique (printemps 1966) ;
- la fondation d’un service de la création architecturale dans la direction de l’Architecture (1966) ;
- une loi du 30 décembre 1966 sur le classement d’office des monuments historiques ;
- la constitution d’un Centre national d’art contemporain pour l’aide aux artistes vivants (1967) ;
- la fondation de l’Orchestre de Paris et de l’Institut de l’environnement (1967) ;
- la loi du 28 décembre 1967, programmant de nouveaux travaux sur les monuments historiques et prévoyant l’inscription de monuments naturels et de sites à protéger dans chaque département ;
- la constitution d’un service des archives du film, opérationnel en octobre 1968 ;
- la loi du 31 décembre 1968 sur les dations à l’État d’œuvres d’art pour acquitter des droits de succession.
Cet ensemble d’éléments montre qu’au- delà des discours, le ministre d’État et ses équipes ont agi et trouvé même parfois des arguments qui leur permirent de fléchir leurs interlocuteurs au ministère des Finances. Un de ses collègues a affirmé sa conviction : seul Malraux « pouvait arracher ce qui n’avait jamais été qu’un secrétariat d’État aux Beaux-Arts à la médiocrité de ses budgets et à l’étroitesse de ses habitudes ». L’appui inconditionnel de son président lui fut acquis comme l’illustre sa déclaration publique, à Bourges, en 1965 : Monsieur Malraux est « le plus qualifié pour comprendre, pour vouloir et pour faire connaître ce qui est l’esprit humain ».
Les dernières années du Ministre dans sa charge, bien qu’assombries par ses problèmes personnels, ont été fécondes grâce aux équipes issues de la France d’Outre-Mer et à l’enthousiasme de jeunes administrateurs civils passionnés par l’action culturelle. C’est avec eux que le double pari du général-président et de l’écrivain-ministre a été gagné : faire de l’action culturelle un impératif public, l’utiliser pour le rayonnement culturel de la France dans le monde.
Toutefois, malgré des injonctions présidentielles pour qu’on augmente les moyens du ministère et qu’on donne une plus grande place au ministre, des membres du cabinet ont profité de son mal-être pour pratiquer un détournement de pouvoir.
Ministre de l’irrationnel
Un conseiller d’État l’a dénoncé, citant des propos de son collègue Antoine Bernard, alors directeur du cabinet : « Le ministre ne va pas bien. On va le mettre dans son bureau, à écrire, et comme ça on pourra travailler ». Max Querrien a écrit que ce choix contribua à faire du ministère « le lieu maudit d’un psychisme déréglé » où l’ennemi n’était même pas le ministère d’en face mais procédait du ministre lui-même. « Malraux fut laissé dans son bureau transformé en turne d’écrivain en tête-à-tête avec le puzzle de sa mémoire alors qu’en le forçant à s’investir quotidiennement, dans les problèmes de la rue de Valois, on lui aurait offert des rails le long desquels il aurait accepté, par courtoisie, par gentillesse, de faire chaque jour un bout de chemin. Et c’eût été un grand mieux pour le ministère et pour lui ». En dictant à son ministre les réponses qu’il pourrait faire à une délégation d’étudiants et surtout en diffusant à l’automne 1968, sous sa seule signature, un document sur « la mission culturelle de la collectivité », Antoine Bernard a illustré la dérive de ses responsabilités. Ceci m’apparaît comme un dévoiement du rôle d’un collaborateur de ministre tel qu’il était conçu au temps de Charles de Gaulle.
Malgré son désarroi physique et moral, remarqué par le président de l’Assemblée nationale, Malraux resta un orateur gouvernemental admiré.
Lorsqu’il vint défendre Les Paravents de Genet, la majorité conservatrice ne put dénier la force de ses propos : « La liberté, mesdames, messieurs, n’a pas toujours les mains propres : mais, quand elle n’a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder à deux fois (…) En fait, nous n’autorisons pas Les Paravents pour ce que vous leur reprochez et qui peut être légitime ; nous les autorisons malgré ce que vous leur reprochez (…) Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu’un débat dans cette enceinte, c’est de savoir où la poésie prend ses racines. Or vous n’en savez rien et moi non plus, et je reprends ce que j’ai déjà dit : la liberté n’a pas toujours les mains propres, mais il faut choisir la liberté ».
Dès 1959, le ministre qui aurait aimé s’appeler ministre du Rayonnement français, disait aux sénateurs que si la connaissance était à l’Université, son nouveau ministère des Affaires culturelles serait celui où l’on pourrait dire « L’amour, peut-être, est à nous ». C’est bien dans cette perspective qu’il parla aux foules, sans céder à la démagogie ; il n’hésita pas, à Bourges, à dissocier la Culture de ce par quoi les gens s’amusent. Il adhérait à l’affirmation de son ami philosophe Gaëtan Picon « Est culture la connaissance qui féconde celui qui la porte, et celle-là seule ».
En 1960, célébrant le centenaire de l’Alliance israélite universelle, Malraux retient l’esprit, valeur suprême dans l’histoire d’Israël, les pauvres instituteurs enseignant la dignité humaine ; le révolté mort dans la torture pour en assurer la mémoire et le vaste murmure des morts sans nom. En 1964, la panthéonisation de Jean Moulin fournit à la geste gaullienne son héros majeur, un admirable visage de la France. L’hommage à Jeanne d’Arc, les oraisons funèbres pour Georges Braque et Le Corbusier sont bien plus qu’une démonstration d’art oratoire. Au Louvre, la main de la France caressant les cheveux blancs de Braque, tout comme l’eau sacrée du Gange et la terre de l’Acropole offertes à la dépouille de l’architecte de la Cité radieuse sont au service de la grandeur française. Lorsque Charles de Gaulle, ayant lu le tapuscrit des Antimémoires, lui fait câbler, du Croiseur Colbert, « admirable dans les trois dimensions », l’écrivain-ministre sait qu’il a gagné son double pari : ré-exister comme écrivain, réenchanter la magie gaullienne en procurant, aux gouvernements du premier président de la Ve République, le relief attendu.
Grâce à son verbe qu’il déploie de cérémonies en meetings politiques, grâce à sa résurrection d’écrivain, Malraux a réussi à faire vivre son ministère et à rendre inimaginable sa suppression.
Le commis-voyageur de La Joconde, l’interlocuteur impromptu du président Mao ont paré d’un prestige accru la République gaullienne. Même si le ministre-écrivain a peu parlé à la table du Conseil des ministres, le président apprécia ce qu’il devait nommer son fulgurant jugement qui le garda du terre-à-terre. Si le général adhérait peut-être à la vision malrucienne quant à « la dérision quotidienne de la vie », il ne se voyait sûrement pas comme dressant à bout de bras le cadavre de la France « en croyant, en faisant croire au monde, qu’elle était vivante ».
C’est là que le pari de 1959 trouve une limite. Pour Charles de Gaulle, les affaires Culturelles ce sont les Beaux-Arts plus André Malraux. Sa France, princesse de légende, peut toujours être redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau. Pour l’ami génial, le gaullisme doit prendre « la pureté de la mort ». Se demandant si l’homme est « obsédé d’éternité, ou d’échapper à l’inexorable dépendance que lui ressasse la mort », Malraux ministre reste l’auteur persuadé qu’en « face du néant et de l’absurde, seule vaut une énergie extrême qui ne peut se révéler supérieure à la mort et à la souffrance que si elle est prête constamment à les affronter ». Se proclamant irrationnel, le gaulliste absolu est lucide quant aux buts les plus dignes d’être visés : ceux que l’on n’atteint jamais ! Ainsi en fut-il de ses chères maisons de la Culture, cathédrales du XXe siècle qui n’existèrent pas dans tous les départements ce qui n’empêcha pas qu’elles soient dénoncées à la fois par les parlementaires conservateurs et les révoltés du printemps 1968.
Donnons acte à Malraux d’avoir su écrire : « un destin historique est inséparable de beaucoup d’erreurs ». Admirons aussi la clairvoyance de celui qui énonça : « Le drame de la jeunesse me semble la conséquence de celui qu’on a appelé la défaillance de l’âme. Aucune civilisation ne peut vivre sans valeur suprême. Ni peut-être sans transcendance. Aucune civilisation n’a été à ce point étrangère à ses valeurs ». L’écrivain-ministre a déployé son énergie pour donner corps à la certitude qu’il avait énoncée à la Sorbonne, en 1946 : « un même destin de mort couche à jamais les hommes » mais certains se lèvent « pour tenter de fonder, en qualité victorieuse de la mort, le monde éphémère ». L’énergie passionnée de Malraux reste exemplaire.
Charles-Louis Foulon
Docteur en études politiques et en histoire
Maître de conférences honoraire à l’Institut d’études politiques de Paris1
Il est l’auteur de André Malraux, ministre de l’Irrationnel, Gallimard, 2010 et co-directeur du Dictionnaire Malraux, CNRS Éditions, 2011