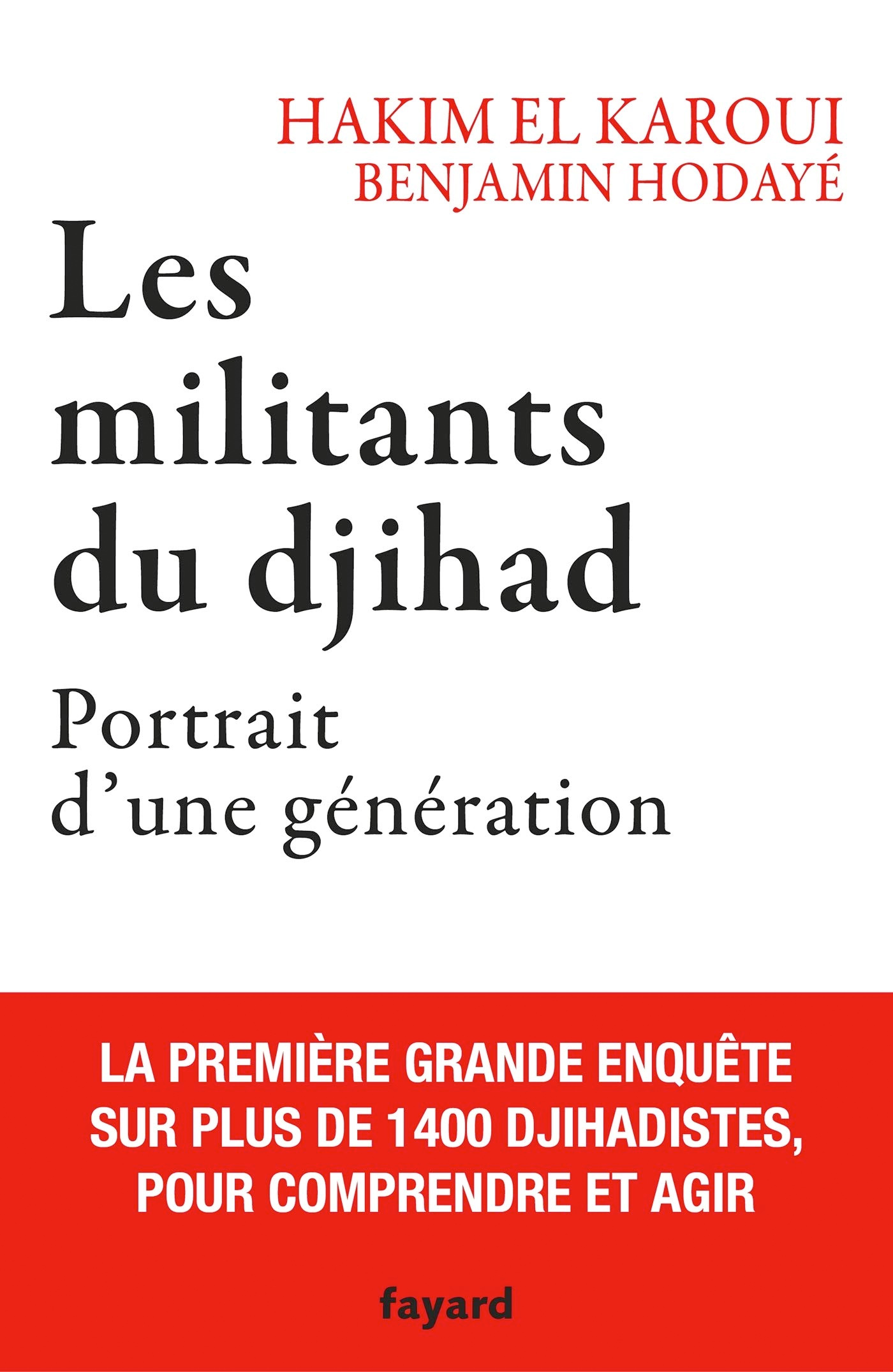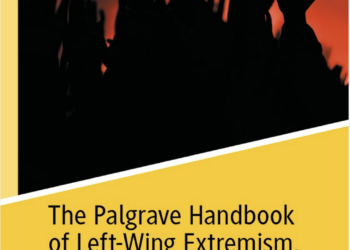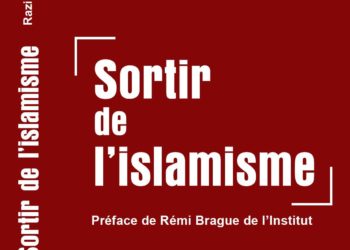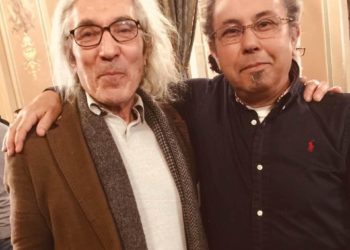Cet ouvrage, initié par l’Institut Montaigne en 2018 et réalisé par deux normaliens Hakim el Karoui, spécialiste de l’islam, et Benjamin Hodayé, historien, est le résultat d’une enquête inédite sur 1 460 djihadistes issus de quatre pays européens (France, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne) et couvrant la décennie (2010-2019).
Leur recherche est élargie au phénomène djihadiste et se penche sur l’endoctrinement qui résulte de la convergence d’un parcours sociologique, d’un cheminement intellectuel et de stratégies de recrutement. Au cœur de l’ouvrage, l’interrogation n’a pas été « pourquoi ils sont devenus djihadistes ? » mais « comment sont-ils devenus djihadistes ? » ce qui les conduit à mener une approche en « termes de militantisme ».
Le djihadisme est une idéologie et le djihadiste est un militant
Évitant tout déterminisme, les auteurs, se basant sur leur enquête et sur leur large connaissance du phénomène djihadiste, appuient l’idée que le djihadisme est une idéologie faisant partie d’une idéologie plus large, l’islamisme, qui, elle-même, emprunte à l’islam des références religieuses. Le djihadiste est donc un militant, ce terme contient le sens de l’engagement politique, à connotation religieuse, ce qui explique ses relations avec le salafisme, porte d’entrée majeure vers l’engagement politique. « Réfléchir en termes de militantisme revient à exclure les lectures déresponsabilisantes qui, trop faciles, présentent les djihadistes comme des victimes ». Leur « prosélytisme s’organise autour d’idées, d’acteurs connectés les uns aux autres et d’une géographie celle du recrutement ». Aussi, l’approche par le militantisme et l’idéologie a-t-elle permis aux auteurs de faire certaines distinctions : tous les musulmans ne sont pas djihadistes. « La majeure partie des musulmans qui descendent d’immigrés sans être immigrés eux-mêmes ou étrangers et pour certains sont des convertis, poursuivent un processus d’intégration initié il y a déjà plusieurs décennies. Ils se distinguent du reste des Français par un attachement plus fort à leur religion mais considèrent l’islam comme une affaire privée ; pour cela ils s’inscrivent dans la sécularisation générale de la société française, et pour cette raison sont peu visibles […] Bien que légitime la focalisation contemporaine sur le djihadisme, le salafisme ou le « séparatisme » occulte la réalité de la majorité des fidèles musulmans. Or les diverses formes d’islamisme se distinguent des formes traditionnelles d’islam car elles se sont constituées en idéologie et ont ainsi dépassé la définition de la religion comme simple foi pour proposer un modèle de société », soulignent les auteurs.
« La sociologie spécifique des djihadistes français et européens est plus une toile de fond de l’engagement djihadiste qu’une réelle causalité »
À partir de tableaux statistiques bien fournis et de cartographies, les auteurs dessinent le portrait-robot du militant et démontrent l’insuffisance de l’explication par les difficultés sociales.
Les djihadistes français constituent une grande homogénéité sociologique : il s’agit d’hommes jeunes, de femmes plus jeunes encore, issus d’une famille de confession musulmane, descendants d’immigrés, notamment des pays du Maghreb, Algérie en tête, suivie de la Tunisie et du Maroc. Les djihadistes sont à 94 % des Français y compris des convertis qui n’ont aucun lien avec l’immigration. Le constat est presque identique dans les autres pays européens couverts par l’étude. Ils sont concentrés territorialement dans des quartiers pauvres, leur avenir est incertain : niveau scolaire moyen, insertion difficile dans l’emploi, vulnérabilités familiales, absence de perspectives, failles personnelles et une angoisse existentielle à la recherche de repères. Ces « facteurs facilitateurs » pour l’engagement djihadiste constituent une toile de fond de cet engagement. « Le terroriste peut cumuler un profil chaotique et une conviction djihadise, leur engagement s’inscrit dans des logiques qui, de leur point de vue, sont rationnelles. La précarité, l’absence de perspectives, les questionnements identitaires, s’ils sont bien souvent indispensables à l’engagement, ne sont pas décisifs » précisent les auteurs.
Au cœur des cellules djihadistes : militantisme et recrutement
Le djihadisme est bien un militantisme qui recrute au sein de cercles précis et selon des modalités finalement spontanées. L’engagement relève parfois d’une intégration à un réseau aussi petit soit-il, comme des relations familiales, ou amicales et claniques ou un voisinage historiquement imprégné par le djihad. Internet, les réseaux sociaux, la prison alimentent aussi le prosélytisme.
Le recrutement relève de données concrètes et locales. En France, le djihadisme prospère dans les villes et dans les quartiers défavorisés. À Londres, le djihadisme reflète l’organisation communautaire britannique et l’espace de tolérance confessionnelle offert par la capitale. Le modèle multiculturel de l’État britannique et de son rapport à l’immigration et à la religion se traduit par une politique de laissez-faire en matière religieuse et facilite la propagation d’une idéologie rigoriste et intolérante. Les djihadistes sont concentrés autour de deux pôles : le Grand Londres et, dans une moindre mesure, le comté métropolitain des Midlands de l’Ouest. Bruxelles constitue le centre du djihadisme belge et européen. Quant à Bonn, l’ancienne capitale ouest-allemande, elle est la première ville allemande en termes d’engagements dans le djihadisme.
L’étude souligne un ancrage fort des djihadistes dans les formes les plus rigoristes de l’islamisme : certains sont poussés plus par la radicalité du discours que par le versant religieux du djihadisme. « La religion constitue une identité, elle s’est constituée en idéologie, dépasse la religion comme simple foi, elle devient plutôt un modèle de société concurrent notamment du modèle démocratique. Le djihadisme comme le salafisme ordonne de quitter la société « mécréante » le salafisme souhaite de se séparer de celle-ci et le djihadisme projette de mettre en œuvre sa destruction » soulignent les auteurs, affirmant que le modèle d’organisation sociale prôné par le salafisme européen n’est pas à proprement parler un communautarisme puisqu’il va au-delà jusqu’à la sécession : le salafo-djihadisme propose effectivement une violente rupture avec la société.
« Selon une acception plus neutre, le communautarisme reconnaît l’existence de communautés à l’intérieur d’une communauté englobante, à l’instar du modèle anglo-saxon de société multiculturelle. Il est prôné par les Frères musulmans européens qui, porteurs d’une vision identitaire de leur religion, font la promotion d’un système où la communauté musulmane, à l’instar d’autres communautés, serait reconnue comme un ensemble homogène et autonome au sein d’une Nation » expliquent les auteurs, précisant « Il vaut mieux parler de communautarisation plutôt que de communautarisme, car c’est un processus et non un fait finalisé. »
Par ailleurs, le syncrétisme possible entre différents courants montre qu’il ne faut pas se contenter de réfléchir en termes de frontières entre salafistes, Frères musulmans, djihadistes ; mais il faut aussi penser les continuités et les points de contact. « Leur discours va puiser dans le corpus intellectuel occidental des références et arguments : (décolonialisme, approche victimaire des minorités…) pour justifier leur combat et leur vision du monde : la déconstruction du projet laïque et républicain. Tout montre que l’islamisme s’adapte au contexte de son expression, cela ne fait pas d’eux des terroristes et change avec le temps. Il faut se préparer à les voir muter », préviennent les auteurs.
Vers une nouvelle génération de djihadistes ?
L’ouvrage identifie les principales étapes de l’entrée en action des djihadistes : entre la fin des années 2000 et 2012, le djihadisme commence à se tourner vers la France. Entre 2012-2017 nous assistons à l’émergence d’un salafisme plus agressif et provocateur coïncidant avec la montée en puissance de l’État islamique qui a en grande partie détourné les forces salafistes et djihadistes du territoire européen vers le djihad en Syrie. Depuis 2017 et l’échec du projet califal de l’État islamique, les djihadistes refluent vers l’Europe, théâtre d’avenir pour le djihadisme.
« Pour anticiper l’avenir, revenir au passé et relire les vingt dernières années d’engagement djihadiste européen afin de le mettre en perspective, d’en saisir les lignes de force, les ruptures et les continuités, le djihadisme ne doit pas être étudié en bloc ; il diffère selon le moment, le lieu, ses logiques stratégiques et le degré d’engagement de ses acteurs. Il faut donc imaginer ses mutations futures ou déjà en cours. Car la « génération Syrie » si nombreuse si agressive et combattante ne va pas s’éteindre d’elle-même avec la fin de l’État islamique. Le djihadisme a beau ne pas menacer l’existence même des sociétés européennes et ne pas constituer un motif de guerre civile, il n’en reste pas moins que le risque violent est là et il n’est pas impossible qu’il augmente » avertissent les auteurs.
Quel djihadisme pour les années 2020 ?
Les auteurs avancent deux scénarios : le premier est le djihadisme violent : cessant de regarder à l’étranger (l’Afghanistan ou la Syrie), il reprendrait son processus d’autonomisation. Sans lien direct avec une organisation internationale, il développerait des objectifs purement européens. L’interprétation agressive du salafisme s’étend et des individus isolés, se croyant investis d’une mission, passent à l’acte, sur le modèle de l’attentat contre Samuel Paty ou à la basilique de Nice. Le deuxième scénario pour le djihadisme européen, est le djihadisme idéologique : une voie plus lente et plus profonde parce qu’elle serait sociale et politique plutôt que militaire et serait en mesure d’engager un nombre plus grand d’individus. Son objectif serait de développer une forme de contre-société djihadiste constituée d’ilots localisés et fermés sur eux-mêmes, dans lesquels les normes djihadistes seraient majoritaires. « Cette nouvelle forme de djihadisme, caractérisée par une modération toute relative, signifierait le retour de l’ambiguïté dans les discours et l’action, jouant de façon provocante avec les libertés démocratiques et cherchant à exploiter les failles des sociétés libérales » alertent les auteurs.
Que faire ?
Le contre djihadisme doit s’opérer en amont et en aval. En amont : par la prévention en luttant contre la diffusion de l’idéologie djihadiste et l’extension d’un salafisme anti-républicain, c’est un chantier de longue haleine reconnaissent les auteurs. En aval : prévenir l’expansion du djihadisme en prison et sur les réseaux sociaux et, dans la mesure du possible, organiser le désengagement idéologique qui ne peut se limiter au seul enjeu sécuritaire. Sans réponse religieuse, les réponses sociales, éducatives et psychologiques risquent d’être inopérantes. La responsabilité doit être partagée entre l’État et les musulmans. Il faudrait aussi accepter de reconnaître que le djihadisme est une idéologie religieuse, contre laquelle l’une des meilleures façons de lutter est de proposer un contre-discours montrant que l’islam peut être interprété autrement. À cet effet, il faudrait que des jeunes puissent parler à leurs pairs de sujets religieux, simplement et de personne à personne et insuffler un élément fondamental, base de toute réflexion et c’est le doute qui est un véritable remède contre le fanatisme. Les auteurs semblent sceptiques quant à ce point précis.
En chercheurs avisés, Hakim el Karoui, et Benjamin Hodayé ont réalisé un travail méthodique, méticuleux, leur analyse illustrée par de nombreux tableaux statistiques, graphiques et cartes, la clarté de leurs explications reflètent le sérieux de leur enquête dépassant débats passionnés souvent basés sur des cas isolés.
Katia Salamé-Hardy
Les militants du djihad
Portrait d’une génération
Hakim el Karoui et Benjamin Hodayé
Fayard, 2021, 324 p. – 22 €