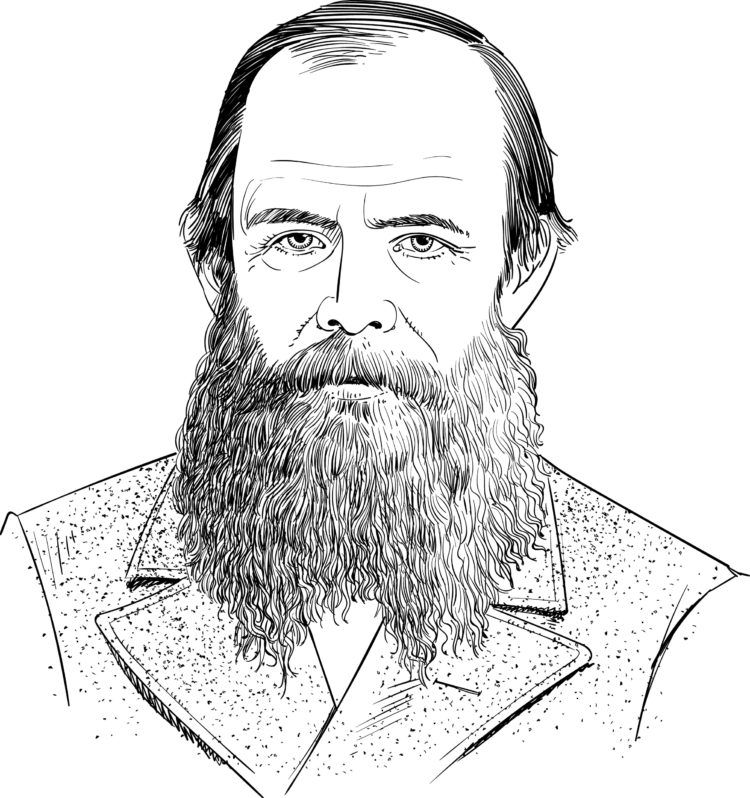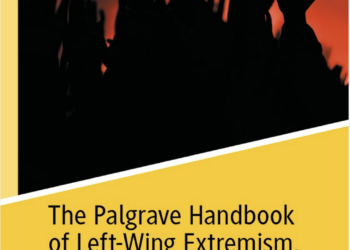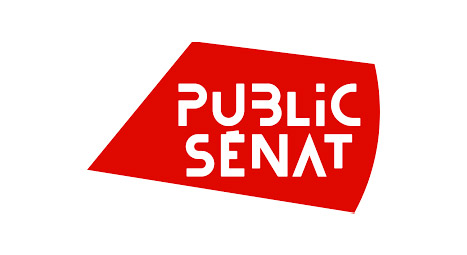La littérature consacrée à l’œuvre de Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est depuis longtemps, on le sait, considérable. Les études dostoïevskiennes, qui portent presque exclusivement sur son aspect littéraire, supposé entièrement tourné vers l’âme individuelle tourmentée, ne connaissent pas de reflux, surtout celles qui entendent apporter de nouvelles hypothèses de travail sur cette immense œuvre. Mais qu’en est-il du côté politique, à proprement parler, de son œuvre, de ses conceptions sur des thématiques telles que l’identité religieuse et/ou culturelle, la souveraineté nationale et/ou politique, qui sont présentées de façon souvent énigmatique dans ses romans, mais au contraire abondante et plus accessible dans son Journal d’un écrivain (1873-1881) ? Les réflexions qui suivent veulent proposer une première approche de notre part du caractère politique tout imprégné de théologie de certains aspects de son œuvre littéraire et « psychologique », et cela sous l’angle de son Journal, marginalisé et taxé de « chauvinisme » par certains thuriféraires de ses romans. Et ensuite, jeter un regard critique sur certains points à forte connotation politique de son Journal.
La guerre, Constantinople, le tsar
Cette perspective identitaire, mais pas ontologique chez Dostoïevski, il faut le souligner, semble présider à toute la problématique « nationaliste » développée par Dostoïevski dans son Journal concernant ladite « question d’Orient » à l’époque, la nécessité de la « conquête » de Constantinople par la Russie, l’aide militaire que le pays doit apporter aux Slaves orthodoxes des Balkans qui luttent contre les Turcs, mais aussi concernant la guerre en tant que telle et l’adoration manifestée par le romancier russe envers le souverain, le tsar. En vérité, les trois premiers sujets dont il débat avec ses adversaires libéraux-occidentalistes, à savoir la question d’Orient, Constantinople et l’aide aux peuples slaves orthodoxes, ne font qu’un. Pour Dostoïevski, ladite question d’Orient n’est que la question orthodoxe en Orient, dont Constantinople est érigée en sublime symbole, tandis que l’aide aux Slaves s’inscrit précisément dans ce cadre de libération du « joug ottoman » de tous les peuples d’Orient, pour l’unité orthodoxe.
Si la question d’Orient n’est que la question du devenir orthodoxe dans ce coin du monde, avec pour centre une Constantinople reconquise par la seule Russie, c’est pour modifier le rapport de forces entre la Russie et l’Europe et faire émerger un paradigme civilisationnel alternatif, le paradigme orthodoxe, face à l’Occident.
« Constantinople doit être à nous, tôt ou tard (…). [Puisque] notre tâche est plus profonde, éminemment plus profonde », elle présuppose, sur la base de la conquête de Constantinople, l’unité orthodoxe et « englobe en quelque sorte toutes nos tâches à venir, et surtout notre unique débouché sur la plénitude de l’histoire. Elle est le lieu d’un affrontement décisif avec l’Europe et de notre union avec elle une fois pour toutes, mais sur des principes nouveaux, puissants, féconds. » Ce clivage identitaire, à caractère polémogène, entre « eux » et « nous » est aussi axé sur la nécessité de faire la guerre à la Turquie pour libérer les frères slaves, et cela va même jusqu’à une certaine acceptation spontanée de la guerre, même si elle représente toujours un « malheur » (surtout la guerre civile) en tant que telle : la guerre, certes, mais « pour une idée » et non pour des intérêts matériels véhiculés par une violence orgueilleuse, une guerre qui va à l’encontre du pacifisme abstrait du catéchisme bourgeois, de la « trop longue paix ». C’est une telle paix, et non la guerre, qui rend l’homme « féroce et dur », qui « engendre la cruauté, la lâcheté, un égoïsme grossier, repu, et surtout la stagnation intellectuelle. Une longue paix n’engraisse que les exploiteurs des peuples. » Et en fin de compte, elle provoque même la « nécessité » de la guerre.
Vue sous cet angle, la guerre contre la Turquie, qui a suscité un mouvement véritable et donc non inventé par des gens de mauvais aloi, est un mouvement national-populaire et religieux au sein de la Russie, pour la chrétienté et pour la libération et l’unité des Slaves, et le rôle du pouvoir politique, celui du « tsar orthodoxe », est hautement assumé et revendiqué comme un fondement majeur de la distinction culturelle même du pays par rapport à l’Occident. D’abord, la Russie a prouvé qu’elle était placée au sommet de la représentation orthodoxe, elle « a relevé aussitôt le drapeau de l’Orient et placé l’aigle bicéphale de la ville impériale [Constantinople] au-dessus de ses antiques armoiries (…), [pour] préserver [l’Orthodoxie], ainsi que tous les peuples qui la confessent, d’une ruine définitive. » Dans ce cadre aussi symbolique que réel, le tsar est conçu comme le « gardien », l’« unificateur » et même le « libérateur », quand le temps divin l’ordonnera, de « tout le monde chrétien, contre la barbarie musulmane et l’hérésie occidentale ». Même si Dostoïevski n’emploie pas la notion paulienne de « katechon », une notion particulièrement récurrente, on le sait, dans la terminologie schmittienne, désignant une force qui retient le monde et résiste à la venue de l’Antéchrist, c’est de cela qu’il s’agit : le tsar incarne cette force katéchontique qui empêche la venue de l’Antéchrist, représenté ici par le « mal radical », l’ennemi en personne, qui est la « barbarie » musulmane et l’« hérésie » occidentale.
Par ailleurs, en énonçant cela, Dostoïevski ne fait que converger encore avec la thèse schmittienne centrale selon laquelle le clivage politique fondamental entre ami et ennemi est d’inspiration théologique chrétienne, et non antichrétienne et païenne, comme le prétend par exemple J. Maritain.
D’un autre côté, le tsar, toujours selon Dostoïevski, qui le considère aussi comme l’incarnation même du peuple, n’est pas une réalité extérieure à celui-ci, comme c’est le cas pour les monarchies occidentales. Il a libéré le peuple du servage par sa réforme paysanne, et il exprime ses attentes séculaires ; son rapport au peuple, au moujik, au peuple paysan qui est le seul peuple authentique, a donc été « testé » par l’histoire. La verticalité du pouvoir fonde ainsi un modèle de gouvernement, un mode de représentation fondé sur la confiance qui existe entre lui et le peuple. Cette « confiance » ne résulte pas d’un quelconque discours, dit programmatique, d’inspiration libérale, ce n’est pas une affaire contractuelle, donc constitutionnelle, comme en Occident : elle est fondée sur l’amour du peuple et sur la foi de celui-ci envers son souverain incontesté. Elle est tout d’abord une affaire de « fusion » entre le représentant et les représentés conçus comme une totalité, une unité « organique ». La représentation n’est donc qu’une affaire de foi. Dans ce contexte spirituel, si la mission du peuple est de rendre « service au Christ » et celle de tsar « le maintien de la foi dans le Christ et la libération de l’Orthodoxie », le tsar est le vrai « père » du peuple et le peuple est l’ensemble de « ses enfants ».
Plutôt que d’y voir une infantilisation du politique, il faut entendre cela comme une hiérarchie « naturelle » établie entre le haut et le bas (leur dissociation étant la source même du malheur russe) ; c’est le retour du sacré dans une société par ailleurs non conforme, voire étrangère aux expériences athéistes occidentales.
« Notre peuple, analyse Dostoïevski, n’est pas entiché de formes, surtout pas de formes toutes faites, venues de l’étranger, dont il n’a nul besoin (…) [Il est] autour du Tsar, près du Tsar, au côté du Tsar. (…) Ce sont les enfants du Tsar, de vrais, d’authentiques enfants de son sang et le Tsar est pour eux un père. (…) Il y a là un organisme vivant et puissant, le peuple ne faisant qu’un avec son Tsar. Et cette Idée est une force. (…) Pour le peuple, le Tsar est l’incarnation de lui-même, de son Idée tout entière, de ses espérances et de ses croyances. (…) [Le] Tsar est ce qui distingue le plus particulièrement notre peuple de tous les autres peuples de l’Europe et du monde ; ce n’est pas chez nous un phénomène contingent, passager, simple signe, par exemple, de l’enfance d’un peuple, de sa crise de croissance, etc., comme pourrait conclure quelque raisonneur, mais quelque chose de séculaire, de constant, et qui jamais, ou du moins de longtemps, de très longtemps encore, ne changera pas. »
Mais cette métaphore du père est-elle vraiment et obligatoirement « organique », et donc « autoritaire » ? Qu’il nous soit permis d’en douter. Elle semble plutôt en osmose paradoxale avec l’idée du parricide exposée et condamnée par le romancier dans ses Frères Karamazov, elle représente plutôt l’envers d’une image désacralisée d’un parricide amoralement, à savoir cyniquement, et physiquement programmé et exécuté. Car, comme le note P. Evdokimov, « en tuant son père, en envoyant son frère au bagne, Smerdiakov se venge du principe de l’être générateur ». Ici encore, et métaphoriquement, le fondement moral, c’est-à-dire religieux, identitaire du pouvoir souverain, celui du tsar, est affirmé, sans pour autant que ce dernier ne soit clairement défini comme vicaire du Christ sur terre comme c’était le cas du pouvoir « césaropapiste » byzantin, pas plus, évidemment, que le catholicisme papal et son institution ecclésiale ne sont définis comme médiation entre l’ici-bas et l’au-delà, comme dans la problématique schmittienne. L’ écart entre le romancier et le politiste est claire. De ce point de vue, Carl Schmitt n’a pas eu tort de remarquer que le spiritualisme orthodoxe « volatilise le concept de l’Église (…) dans un corpus mere mysticum », car il doute « de l’humanité du Fils du Dieu », à savoir qu’« il falsifie la réalité historique de l’Incarnation pour en faire un évènement mystique irréel. » Donc, la remarque dostoïevskienne sur la nécessité du père, malgré la restitution de l’autorité qu’elle établit, reste néanmoins inopérante politiquement au sens schmittien, car le père demeure à l’état de « substance », donc de fuite hors de l’histoire réelle. Or, « un conflit est toujours une lutte entre des organisations et des institutions, au sens d’ordres sociaux concrets, une lutte entre des instances et non pas entre des substances. Il faut au préalable que les substances aient trouvé une forme, il faut qu’elles se soient formées dans un sens ou dans un autre avant qu’elles puissent réellement s’affronter comme des sujets susceptibles de s’opposer, comme des parties belligérantes. »
La neutralisation du politique
Mais cette absence de « forme » n’empêche nullement Dostoïevski de formuler une critique radicale et pleinement politique à l’encontre des phénomènes d’importation européenne qui désubstantialisent la vie publique et dénaturent la communauté nationale au risque de provoquer son effondrement. Sa conception de l’État est, de ce point de vue, particulièrement éloquente. Face à la « nécessité » de le réformer, en faisant passer certaines de ses prérogatives aux collectivités locales (« autonomies locales ») et en procédant à une réduction drastique de ses effectifs (diminution du nombre des fonctionnaires), il affirme résolument son opposition en indiquant que l’État est une instance incontournable de la cohésion nationale, ce « quelque chose » qui tient la société debout, malgré ses archaïsmes et sa lourdeur bureaucratique. Inventant un dialogue imaginaire avec un « bureaucrate spirituel », Dostoïevski défend, à travers son interlocuteur fonctionnaire, la thèse que « nous qui sommes les bureaucrates », c’est « nous qui sommes l’État, et qui sommes tout » ; et que c’est ce nous bureaucratique, qui pour les modernisateurs-réformateurs est « sans vie », mort, tout en papier, qui pour le moment tient la Russie et l’empêche « de tomber en morceaux. » Une réforme prématurée et inconnue, fruit importé de l’étranger, risque de disloquer le squelette d’un organisme vivant, de dissoudre son corps, de mettre brusquement en péril une continuité historique vivante depuis le Pierre le Grand. Certes, comme Dostoïevski lui-même reconnaît l’excès de la formule employée, même si la bureaucratie n’est pas « tout », elle est néanmoins « quelque chose », et non « le zéro ». Face au « fantôme » de la réforme proposée (qui n’est pas une simple adaptation modérée à l’« esprit du siècle »), ce « quelque chose » n’est qu’une résistance imposée : « Nous opposerons à notre destruction, en quelque sorte, la force d’inertie. Cette force d’inertie en nous a sa valeur, car, à vrai dire, c’est par elle seule que tout se maintient de notre temps. » Car c’est de la violation d’un « principe » qu’il s’agit, d’un acte « immoral ». Pour la deuxième fois, nous semble-t-il, cette force d’inertie invoquée pourrait ressembler en quelque sorte à une métonymie du « katechon » schmittien, dont le lieu est identifié maintenant dans l’État comme espace du politique.
L’État devient ainsi une sorte de refuge identitaire qui retarde le temps, le représentant par excellence du peuple contre une agressivité étrangère, contre un fantôme « envahissant » et menaçant la stabilité d’un système traditionnel, le « squelette » d’une identité historique et culturelle qui, malgré toutes ses défaillances, peut encore tenir le pays vivant.
Un Dostoïevski « ennemi » de la « forme » succombe à sa « tentation » étatique face à une amorphie dépolitisante qui altère et désorganise la vie commune. Car le critère de la décision ne doit pas être d’ordre économique (la réduction des dépenses), ni une technique d’ordre administratif, donc une technique tout court, neutralisant ainsi les enjeux, un trait majeur du libéralisme dépolitisant selon Carl Schmitt, mais il doit être politique, c’est-à-dire agir au nom d’un principe qui est la cohésion de la société régie par le politique, en l’occurrence par l’État-gardien qui, même si, selon Schmitt, il ne peut pas être identifié au politique, protège néanmoins la communauté et condense toute une histoire existentielle du pays.
Le peuple et l’« extrême centre » tolstoïen
Mais ce critère politomorphe, pour parler schmittien, enraciné dans le caractère russe, se déploie aussi contre le pacifisme et le moralisme de texture bourgeoise venant, disons, d’un « extrême centre » tolstoïen, auquel Dostoïevski oppose vivement tout le mysticisme de l’âme russe orthodoxe, mais aussi un vrai réalisme politique. La critique consacrée au huitième chapitre d’Anna Karénine de Léon Tolstoï et à son héros Lévine, enfant moscovite, grand seigneur et intellectuel à la fois, appartenant à « la classe supérieure moyenne dont l’historien a été par excellence le comte Léon Tolstoï », porte principalement sur son identité ambivalente : il tente de croire en Dieu mais son raisonnement « mathématique », scientiste, l’en empêche. Une fois encore, la raison contre la foi. Mais cette fois-ci, le protagoniste tolstoïen, qui en même temps se déclare partie intégrante du peuple (« moi aussi je suis le peuple »), ne peut pas partager les sentiments populaires, notamment ceux des gens qui manifestent pour une solidarité russe active et armée, grâce à des volontaires engagés en masse, en faveur des Slaves des Balkans ; il va même jusqu’à se demander à cette occasion si les hommes mobilisés pour les Slaves dans les Balkans et leur guerre contre les Turcs (cette nation « infâme », selon Dostoïevski) représentent vraiment le peuple, et à partir de là, il en vient à s’interroger sur ce qu’est le peuple : « ce mot, “le peuple”, est tellement indéterminé (…) » dit-il. Et Dostoïevski de rétorquer à ce pacifiste inconditionnel et fervent moraliste, ennemi de la guerre, que cette incompréhension trahit une vraie impuissance à apprendre et écouter l’âme populaire, le caractère russe, l’amour chrétien du prochain, avec ce sentiment profond et « général de pieuse émotion et de pénitence, de soif de participer à quelque chose de saint, à la cause du Christ », et que ce trait-là (nous sommes complètement, nous semble-t-il, dans une christologie politique et nationale) est pour le peuple russe « une donnée de l’histoire » qui ne change pas. Même si le peuple ne connaît pas l’histoire et la géographie (sur ladite question slave), comme le proclament ses accusateurs, « ce qu’il faut qu’il sache, il le sait » : que le Turc a relevé de nouveau la tête, qu’« on a vu chez eux des spécialistes de l’extermination des bébés à la mamelle, des experts qui, saisissant l’enfant par les deux jambes, le déchirent d’un coup en deux à la joie et aux éclats de rires de leurs camarades bachibouzouks. » Que veut dire alors défendre de tuer, ne pas faire la guerre contre un tel ennemi ? « Si on ne leur arrache pas leur arme et – pour ne pas les tuer – qu’on s’en va, ils se remettront aussitôt à couper les seins des femmes et à crever les yeux des enfants. Comment faire donc ? Laissez plutôt crever les yeux, uniquement pour ne pas risquer de tuer un Turc ? Mais enfin, c’est une perversion des notions, c’est le plus stupide et le plus grossier étalage de sensiblerie, c’est d’un simplisme frénétique, c’est la plus totale dépravation de la nature ! »
Mais pourquoi Lévine ne peut-il pas comprendre ces attitudes populaires ? Pourquoi sa pitié, quand elle se déclare, va aux Turcs, se dévoyant en une compassion désincarnée, humanitariste et dépolitisante ? Pourquoi est-il si profondément ancré dans le sensibilisme centripète et neutralisant des bons sentiments, porteur de cet humanisme abstrait et aveuglant, pourquoi est-il si orgueilleusement, si cyniquement convaincu que « de sentiments spontanés pour des Slaves opprimés, il n’y en a pas et il ne peut pas y en avoir, puisque moi, je n’éprouve rien » ? Dostoïevski livre sa réponse dès le début de sa critique envers le héros tolstoïen et, par voie de conséquence, envers Tolstoï lui-même, qui instruit mal son auditoire en se distanciant surtout et fatalement du peuple, en le dépouillant « du sens principal de sa vie ».
Pour Dostoïevski, toute la question est que ce Lévine n’appartient pas au peuple ou, plus exactement, ne peut pas y appartenir. Sa provenance sociale et culturelle a décidé avant lui.
Il ne s’agit pas tant de ce personnage aussi fictif que « concret » dénommé Lévine, que d’un idéal-type représentatif d’un individu issu d’un milieu social médian aisé et cultivé, qui ne peut pas et ne veut pas réfuter ce milieu, un modèle de conformiste indigné (« gout du paradoxe », « amour-propre froissé », « hypocondre exaspéré ») du juste-milieu, porteur d’un anti-nationisme progressiste libéral, propre à l’individualisme hédoniste. Comme tel, remarque Dostoïevski, son âme est condamnée à un « vagabondage à vide » permanent. Et dans la vie réelle, un type sociologique de cette sorte se réalise dans ce vaste camp progressiste du conformisme qui va de l’extrême centre à l’extrême gauche sociale justicialiste, au « chacun pour soi… », agrémenté, le cas échéant, de l’idéologie anarcho-populiste d’un christianisme rose, en tout cas donneur de leçons pour l’innovation continue infantilisante et/ou la déconstruction sociale totalitaire. Comme l’a observé avec lucidité Alain Besançon, traçant l’un des débouchés possibles du tolstoïsme idéologisé : « Tolstoï entend démolir de fond en comble cette société mensongère et meurtrière. Il la reconstruira sur des bases populaires – et non pas nationalistes –, et c’est en cela que consiste le principal écart entre l’auteur d’Anna Karénine et celui des Frères Karamazov. C’est pourquoi Lénine, parmi tous les alliés dont il avait besoin pour accomplir son projet de destruction générale, n’en pouvait trouver de plus synthétique, de plus précieux que Tolstoï (…) ».
En guise de conclusion
S’il y a de quelque chose de commun à tout de ce qui a précède, c’est la problématique de l’identité qui y est apparue.
Chez Dostoïevski, ce « ce que nous sommes », orthodoxes, russes, peuple, père, semble jouer un rôle capital dans la vie d’une collectivité ou dans l’âme individuelle. Une identité non pas « construite », mais produite de façon historique et culturelle.
Dans tous les cas analysés, ce trait commun identitaire est d’inspiration théologique et sur lui s’élèvent le politique, la nation, toute l’organisation de la vie en commun. C’est la foi dans le Christ qui, en devenant un élément actif identitaire dans la vie réelle, permet à notre romancier et publiciste à la fois de se métamorphoser en réaliste défenseur de l’autorité, d’un pouvoir vertical (celui du père, mais aussi du tsar), par ailleurs rejeté dans son Grand Inquisiteur, en polémiste « nationaliste » pour la « cause slave », en « conservateur » anti-libéral dans le cas d’une réforme sociale « prématurée ». Son démocratisme anti-libéral, son populisme orthodoxe, qui n’est pas celui des slavophiles plutôt athées, tiennent précisément de cette source identitaire, qui fait que sa critique radicale envers la modernité « occidentale », et surtout envers les « occidentalistes » modernisateurs de son propre pays, est d’ordre civilisationnel. L’identité, véhiculée par la foi religieuse, produit la confiance politique, le politique en tant que confiance, et légitime ainsi un mode de gouvernement, une représentativité « authentique ». Certes, ce modèle de représentation est, politiquement parlant, inachevé, car il ne puise pas dans des institutions visibles, « incarnées » dans la vie réelle.
Chez Dostoïevski, s’il y a une « institution », celle de l’Eglise, celle-ci ne peut être que « spirituelle », en parfait accord avec sa foi orthodoxe. C’est pourquoi sa conduite, son manque d’incarnation comme médiation, a précisément du mal à se séculariser et la critique schmittienne en la matière est plutôt justifiée.
Mais le génie du romancier-publiciste, confronté à l’épreuve du réel, aux situations concrètes, a su corriger le tir. Sans être obligés de partager l’ensemble de ses thèses politiques, comme sa formule du « peuple théophore » (au sens littéral), son message est clair : pas de représentation sans une éthique de conviction. C’est une grande leçon politique, et très actuelle face aux errements du progressisme déconstructionniste-nihiliste dévoyé. De gauche ou de droite, centrisme radical inclus.
Andreas Pantazopoulos
Politiste, professeur associé, Université Aristote de Thessalonique
Illustration : Naci Yavuz/Shutterstock.com